dans
MICROMÉGAS
« Courrier critique et technique du livre moderne »
n° 17 - 10 février 1938
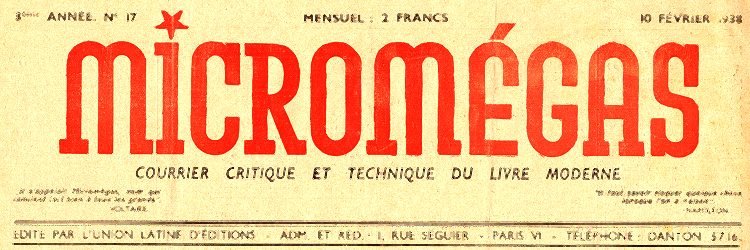
par RENÉ BARJAVEL
Les:chaumières des paysans se rapprochèrent du château. Des marchands ouvrirent boutique. C'est ainsi que naquit Moulins, capitale du Bourbonnais et berceau des rois de France. C'est aujourd'hui une vieille dame un peu voûtée. Ses maisons ne grandissent pas plus haut que deux ou trois étages. Elles sont vêtues de briques roses et noires, et coiffées de tuiles moussues. Sur leur troupeau veillent Jacquemart, bon berger de grès rose, et sa commère cathédrale au bonnet pointu. Derrière les volets presque toujours clos vivent benoîtement de bons bourgeois, et des mauvais. Des passions s'agitent à l'étouffée, des querelles sans motifs s'enveniment et durent, et des hommes meurent, sans avoir, de leur vîe, fait le mal. A son couchér, le soleil farde les vieilles pierres. Dès la nuit tombée, Moulins s'endort. La lune glace de bleu les toits cornus. Si ce n'était en travers de la rue le fil du téléphone qui barre le ciel, on pourrait se croire aans quelque bourg moyenâgeux après le couvre-feu. Moulins est une ville en paix. Capitale de riches campagnes, elle n'a jamais connu d'heures bien tragiques. Elle est restée en dehors des passions, toujours semblables à elle-même. Les révolutions y sont bénignes. Le machinisme ne l'a pas bouleversée. Autobus ni tramways n'écorchent ses rues du bruit de leur ferraille. La T.S.F. y parle à voix basse. Aussi les poètes qui naissent dans ce lieu de douce vie sont-ils disciples de Ronsard plutôt que de Villon. Ils chantent un amour sans trop de tourments, les charmes roses de leurs maîtresses, la douceur du vin mûr, et se moquent un peu des lauriers. Ainsi, de Jean de Lingendes, on ne sait pas très exactement quand il naquit, quand il mourut, et on ignore où il fut enterré. Boileau l'appréciait à l'égard de Malherbe et disait de lui qu'il avait « attrapés le vrai génie de la langue française ». On l'oublia pendant trois siècles. Valéry-Larbaud l'a ressuscité dans la mémoire des lettrés. Mais le peuple se transmettait comme un proverbe le charmant refrain d'une de ses chansons : « La faute en est aux Dieux qui la firent si belle. » Il ne nous reste pas grand chose de son œuvre. Cet oubli ne l'eut pas chagriné, II disait en effet : « Beaux esprits qui dedans ces vers Cette « lamentable histoire » n'est pas si terrible. La « bergère Iris » finit par céder à la flamme du poète, et lui donne un premier baiser : « Doux baiser le plus doux vraiment Un peu de mignardise, certes, mais c'était de mode. Jean de Lingendes a d'autre part des accents de plus véritable tendresse : « Alors de son lit m'approchant Ce n'est pas de la grande passion aux mille déchirements. Les poètes moulinois aiment la vie et ne la voient point en noir. Deux cents ans après, Théodore de Banville l'affirme de nouveau : « C'est la sagesse ! Aimer le vin Et dans sa charmante pièce intitulée « Lapins » : « Préférant les simples chansons Ces deux poètes (et le second sans doute, ignorait le premier) chantent la femme, avec les mêmes mots. Lingendes : « La pure blancheur Banville : « Laisse ton sein de neige
La tradition n'a pas disparu avec le dix-neuvième siècle. De nos jours, un autre moulinois l'a reprise, que nous tenons pour un esprit des plus charmants et que nul ne connaît, sans doute, en dehors de ses amis. Nous retrouvons chez lui la détestation du bourgeois tel que l'a défini Banville : « L'homme qui n'a d^autre culte que la pièce de cent sous, d'autre idéal que la conservation de sa peau... », et l'amour de la femme et du vers bien tournés ! « Les bourgeoises, leur couperoses, Il se nomme Hubert Pajot. Il n'a lui non plus, guère souci de la gloire, et si Banville reconnaissait : « Peut-être ai-je encore secoué lui affirme : « Je n'ai pas le souci d'éterniser mon nom
Aussi n'avons d'autre but que de lui créer quelques amis nouveaux en publiant ci-contre quelques-uns de ses poèmes. Nous pensons qu'il est bon, en notre siècle noir, de rappeler le conseil de Banville, et de faire connaître ceux qui l'ont suivi : « Souris même au destin sévère, On reprochera à Hubert Pajot d'être simple et compréhensible, et de ne point clamer. C est pour ceh que nous l'aimons. A nous qui subissons la vie exaspérée de la capitale, il rappelle qu'il existe en notre France de douces villes au bord des rivières, où le soleil a conservé toutes ses couleurs. RENÉ BARJAVEL |
Notes :
- La revue Micromégas, "Courrier critique et technique du livre moderne", fut fondée en octobre 1936. Editée par l'Union Latine d'Éditions (dirigée par Maurice Robert), elle parut jusqu'en avril 1940, puis réapparut en juillet 1959. Son rédacteur en chef était Maximilien Vox. Journal grand format (30 x 47 cm) de douze pages, et se voulant organe de la défense du livre, elle commentait l'actualité du monde des lettres et de l'édition. Présentant des écrivains et leurs oeuvres, ainsi que des conseils de lectures, certains articles avaient un ton quelque peu polémique visant surtout à promouvoir l'indépendance des Lettres d'avec la Politique. Ce numéro 17 commentait les récents débats au Palais Bourbon relatifs à l'instauration d'une taxe sur l'imprimerie.
- Jean de Lingendes (1580-1616), poète de la renaissance. On pourra trouver ces oeuvres sur les pages [ http://poesie.webnet.fr/auteurs/lingendes.html ] et [ http://www.florilege.free.fr/florilege/lingende/a.htm ].
- Théodore de Banville (Moulins 1823 - Paris 1891), ami de Baudelaire, Hugo et Mallarmé (voir leurs témoignages sur la page
[ http://franceweb.fr/poesie/banvil2.htm ]), fonda l'École du Parnasse.
On poura lire ses oeuvres en ligne sur la page [ http://www.mta.ca/faculty/arts-letters/frenspan/banville/poesie.html ]. et voir aussi [ http://www.nemoclub.net/article.php3?id_article=34 ] et [ http://www.anthologie.free.fr/anthologie/banville/banville.htm ]. - Hubert Pajot (1896-1986), poète Moulinois d'origine et quelque peu oublié aujourd'hui, fut aussi sénateur-maire de Fontainebleau dans les années 1950. « Ayant fleurté avec la politique, il a garni les marges de son existence de poèmes empreints à la fois de fantaisie et de rigueur. De fantaisie quant à l'inspiration, de rigueur quant à la forme ». L'article de Barjavel qui en fait en quelque sorte l'éloge était complété de trois de ses poèmes.
 'était il y a bien longtemps. Sur le bord de l'Allier se dressait un coquet moulin habité par gente meunière.
On le nommait le moulin Bréchimbault. De son blanc logis, la meunière entendait souvent, dans la forêt voisine, les appels de cor
de la chasse du duc de Bourbon qui courait la biche ou le sanglier. Un jour, le duc de Bourbon, avec sa suite chevauchante, passa au pied du moulin
alors que la.meunière était.à sa fenêtre. Le lendemain il revint seul. Et sous peu de temps il fit dresser près du moulin Bréchimbault un grand château, pour loger plus près de sa belle.
'était il y a bien longtemps. Sur le bord de l'Allier se dressait un coquet moulin habité par gente meunière.
On le nommait le moulin Bréchimbault. De son blanc logis, la meunière entendait souvent, dans la forêt voisine, les appels de cor
de la chasse du duc de Bourbon qui courait la biche ou le sanglier. Un jour, le duc de Bourbon, avec sa suite chevauchante, passa au pied du moulin
alors que la.meunière était.à sa fenêtre. Le lendemain il revint seul. Et sous peu de temps il fit dresser près du moulin Bréchimbault un grand château, pour loger plus près de sa belle.