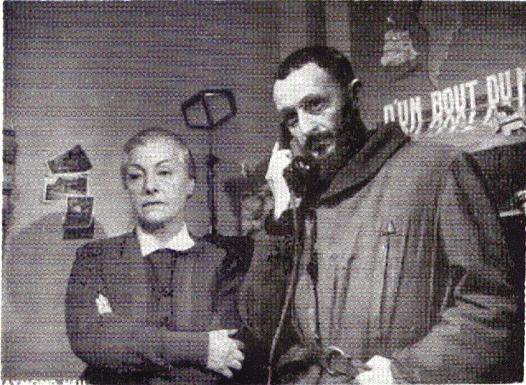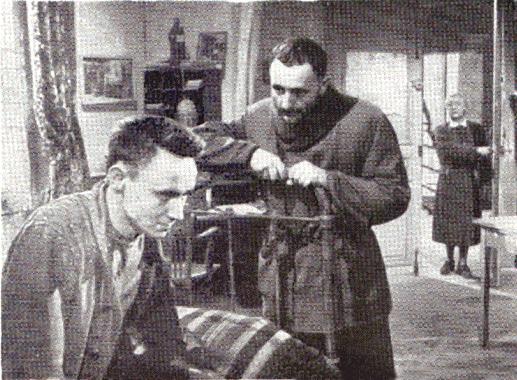Présentation et résumé du film
LES CHIFFONNIERS D'EMMAUS
dans le magazine TÉLÉ-CINÉ de mars 1955 - n°46
 |
Ce magazine, administré par la Fédération Loisirs et culture cinématographiques, proposait dix numéros par an. L'essentiel de la revue était constitué de "fiches cinématographiques" offrant des analyses détaillées et raisonnées des films récents, et complétées d'un nombre volontairement réduit de photographies. |
FICHE N° 234
SCENARIO. Par le truchement d'un voisin de l'auberge d'Emmaüs, les scénaristes ont conté les étapes de l'aventure de l'Abbé Pierre.
REMARQUES SUR LE SCENARIO. Il est indispensable de signaler qu'avant le film, l'Abbé PIERRE lui-même vient sur l'écran pour cautionner cette œuvre : « Tout ce que vous allez voir, c'est la vérité. Si nous avons changé quelques détails, c'est pour ne pas violer les secrets de la misère, mais tout est vrai. » Cette déclaration de l'Abbé PIERRE donne au film une portée d'une intensité dramatique que nul ne pourra mettre en doute. Les images qui suivront vont de ce fait nous faire toucher une misère qui existe à côté de nous, aujourd'hui même. Procédés narratifs. La grande trouvaille des scénaristes et des adaptateurs a été de nous faire raconter l'histoire par un témoin, le voisin (Thomas), gardien de nuit dans un hôtel. Thomas passe ses journées à observer tout d'abord et a participer ensuite à l'aventure. C'est un brave garçon du milieu populaire, s'étant créé une petite vie bourgeoise dans son pavillon de banlieue auprès de sa jeune épouse, ayant d'autre part un emploi tranquille et pas trop fatigant. Il est, vis-à-vis de cette aventure, dans la position de l'homme sans problème qui tout d'abord regarde avec scepticisme. Malgré lui, il sera entrainé à vivre cette aventure, puis, inconscient tout d'abord et conscient ensuite, à s'y intégrer jusqu'au point de participer profondément à la souffrance de tous. D'autre part, le fait de faire raconter le film le conjugue au passé. Tous les événements que nous verrons ont existé et nous sont retransmis à travers un homme qui les a vus, puis les a vécus. Cette habileté de construction assimile le spectateur à Thomas ; comme lui nous vivons constamment à côté de la misère sans la voir. Il suffirait qu'un Abbé Pierre vienne un jour, comme à Thomas, nous demander « de pousser la porte »... Cette référence à la première séquence du film nous parait des plus importantes. Lorsque l'Abbé arrive devant la grille d'Emmaüs, Thomas est à quelques pas derrière lui qui observe. La porte est dure à ouvrir, ce sera Thomas qui dira à l'Abbé Pierre « il faut pousser », mais aussitôt l'Abbé enchainera sur cette réaction de « spectateur » : « En effet, il faut pousser, viens pousser avec nous », et Thomas, malgré lui, entre dans l'aventure. ANALYSE DRAMATIQUE. Plusieurs problèmes sont soulevés dans « Les chiffonniers d'Emmaüs » : le problème social, le problème humain, le problème politique, le problème spirituel ainsi que la pédagogie de l'action. Problème social. II s'agit de montrer, une fois encore, tout le drame de la construction. Les auteurs du film nous donnent cependant quelques indications intéressant les victimes de cette crise; ce ne sont pas des clochards, il s'agit de familles ouvrières, de gens qui travaillent, qui ont un salaire... « mais pas de millions ». Une autre indication nous sera donnée : la nécessité d'avoir une maison est indispensable pour l'épanouissement du foyer ; cependant la maison n'est pas une fin en elle-même, elle n'est qu'un moyen. Lorsque Para s'éprendra de la jeune maman et la convoitera, Djibouti lui adressera ces paroles terribles : « Si nous construisons des maisons pour ensuite démolir des foyers, ce n'est pas la peine »... Problème politique. On a dit, non sans raison, que l'action de l'Abbé PIERRE risquait de fausser le problème en soulageant simplement quelques cas et en même temps Îa conscience des bons bourgeois et d'un gouvernement, alors que le problème de la reconstruction est un problème de réforme de structure, un problème national, un problème politique. Le film va tenter de réfuter cette objection. L'Abbé répondra au jeune ingénieur touché par le drame et qui vient offrir ses services aux chiffonniers : « Si tu viens ici pour faire une cure de misère et soulager ta conscience tu peux repartir. Il faut que tu sois là jusqu'à ce que tu en aies assez et qu'ensuite tu restes. » Nous ne pouvons pas libérer notre conscience devant le problème de la reconstruction en versant une petite somme qui ne gênera en rien notre « train-train » habituel. Mais la solution sur un plan technique est encore plus loin, il faut « que cette boue éclabousse les Pouvoirs Publics afin qu'ils s'en débarbouillent »... Dans un moment de découragement, le jeune ingénieur le dira à l'Abbé : « Nous perdons notre temps, nous en logeons dix alors qu'il faudrait en loger des centaines de mille, c'est un problème de structure ». Mais en attendant, dira l'Abbé : « Est-ce qu'on laisse crever ces dix ?... C'est tout ce que nous faisons. » Problème humain. Il est intéressant de noter que le point de départ repose sur une équipe de clochards, « des déchets de l'humanité » comme les appellent les bons bourgeois. Ce sont eux qui eurent assez de courage, assez de coeur et assez d'espérance pour se lancer avec une pelle et une pioche dans cette aventure. Ce sont eux qui acceptèrent de ne faire qu'un seul repas par jour et de se priver de vin pour continuer. Il y a chez les misérables, ceux qui ont le plus souffert, une puissance humaine que l'on retrouve très rarement ailleurs. Ils sont loin cependant d'être des saints, ils se saouleront, ils se battront, ils convoiteront les femmes des autres ; c'est avec cela que l'Abbé a démarré. Mais le Seigneur ne choisit-il pas ses premiers apôtres parmi les plus humbles ? C'est avec ceux-ci qu'il bâtit son Eglise. Problème spirituel. Ce que nous venons de dire précédemment explique que le film évite de tomber dans un moralisme prédicant. L'Abbé fait appel à une charité active, à aucun moment on ne demande aux hommes des formules de prière, mais il est exigé d'eux, à tout moment, le don d'eux-mêmes : « Seigneur, donnez du pain à ceux qui ont faim et faim à ceux qui ont du pain. » La séquence de la distribution des tracts est significative sur ce point. Le mendiant noir qui remet le contenu de son écuelle à l'Abbé ne signifie-t-il pas que l'on n'a rien donné lorsque l'on n'a pas tout donné et que la véritable joie intérieure procède du don total. Pédagogie de l'action. L'Abbé est un meneur d'hommes, mais toute sa pédagogie repose sur la confiance et sur le « faire faire ». II fait confiance à ses clochards, il leur laisse l'initiative de l'action et, en fait, ce sont eux qui trouveront bien souvent les solutions aux problèmes. S'il suggère quelquefois, en fin de compte, ce sont eux qui décident et par ce fait ils sont compromis dans l'œuvre qu'ils accomplissent. REALISATION. Nous pensons avoir suffisamment défendu le film pour nous permettre quelques remarques sur le plan de la réalisation. Dans son ensemble l'œuvre a voulu être simple et sincère, mais le réalisateur n'évite pas cependant de tomber à deux ou trois moments dans le poncif. La séquence d'anniversaire dans le foyer nouvellement accueilli est traitée avec un manque assez visible de coïncidence avec le contexte ; le décor trop luxueux, la danse trop poussée, les vêtements de la jeune fille, enlèvent à cette scène, valable ou point de vue scénarique, de son authenticité. Peut-être également la scène de bagarre dans le petit bistro, trop appuyée, est-elle une concession au poncif cinématographique, diminuant par ce fait son aspect profond : le retour de Para à la communauté. Nous trouvons également d'autres erreurs sur le plan du traitement, ne serait-ce que les deux ou trois plans nous montrant la joie retrouvée de la famille que l'on vient de loger. Jeu des acteurs. Après avoir vu l'authentique Abbé PIERRE sur l'écran nous présenter le film, il faut avouer que son successeur (André REYBAZ) avait une tâche difficile à assumer; nous devons reconnaître très franchement que nous l'assimilons très rapidement dès les premières images du film. Gaby MORLAY, dans le rôle de Mademoiselle, et Madeleine ROBINSON, dans celui de la mère, les deux plus grandes vedettes du film avec Yves DENIAUD, ont su, très simplement, accepter des petits bouts de rôles apportant une grande richesse au film. Yves DENIAUD incarne un Djibouti remarquable. C'est l'homme qui a souffert, qui a tout perdu et qui a tout donné, mais qui en même temps est resté d'une simplicité et d'un effacement remarquables. Il est rentré dans son personnoge qui fût authentique avec un talent que nous ne pouvons qu'applaudir. A ces éloges, nous devons associer l'interprétation de Charles MOULIN (Kangourou), de Pierre TRABAUD (Para) et de Pierre MONDY (Thomas). Cependant les personnages secondaires ne seront pas tous réussis, le jeu d'Etienne (Pierre JAUBERT) et de Suzy (Dany CARREL) nous paraît un peu forcé dans certaines scènes. De tout ceci, il ressort, sur le plan de la réalisation, que Robert DARENE, le réalisateur, n'est pas parvenu à donner aux « Chiffonniers d'Emmaüs » un tonus constant; des séquences remarquables alternent avec d'autres plus faibles. A l'intérieur même de certaines séquences, certaines erreurs de mise en scène paraissent évidentes. A titre d'exemple nous analyserons une séquence des pJus émouvantes du film : celle de la distribution des tracts. Les plans alternent entre, le mendiant chantant son négro spiritual, l'Abbé distribuant les tracts et les gens dans le café. Puis, tout à coup, alors que nous entendons le mendiant chanter seul sous la pluie, nous le retrouvons trois plans après entouré subitement d'une foule figée qui n'est là que pour attendre la fin du chant afin de jeter quelques pièces de monnaie. Il aurait suffi, pour sauver cette scène, de voir à chaque plan du mendiant un passant jetant rapidement quelques sous dans son écuelle. Musique. Joseph KOSMA a assuré la partition musicale avec tout son talent et toute sa sensibilité au drame de la misère. Dialogues. René BARJAVEL n'est pas un nouveau venu au cinéma. Il nous avait déjà donné le dialogue de « Quelque part en Europe » et des « Dom Camillo », il a bien trouvé un ton de simplicité directe, mais qui, par moments, est mal servi par ses interprètes ; en particulier la jeune Suzy et le jeune Etienne. Après la vision du film l'on est amené à penser ce qu'auraient pu faire avec cette matière un ROSSELINI ou un Vittoria de SICA avec tout leur talent et leur sens de l'authenticité quotidienne. PORTEE DE L'ŒUVRE. Nous croyons qu'il faut renvoyer le spectateur à l'introduction de l'Abbé PIERRE. Nous y ajouterons une réaction de ce dernier après la première vision du film : « Ce qui est sûr, c'est que l'essentiel y est, et manifestement les parties les plus récentes sont de plus en plus vraies et imprégnées d'âme. Maintenant, tous à Emmaüs nous avons moins peur et même confiance; et c'est de grand cœur que je suis heureux de pouvoir dire, au nom de tous les compagnons et de tous les camarades, merci à toute l'équipe qui travaille de toute son âme et de ,tout son talent. » A notre tour nous voudrions en conclusion tirer du film même une portée symbolique. Reprenons la séquence de la distribution des tracts. L'indifférence des passants devant la feuille imprimée de l'Abbé, alors que ceux-ci jettent quelques sous dans l'écuelle du vieux chanteur noir, nous amène à poser la valeur d'accrochage de l'œuvre d'art. Insensible à la feuille de papier, l'homme va se laisser saisir jusqu'au plus profond de lui-même par la nostalgie prenante de cette magnifique prière d'un miséreux clamant son espérance au milieu de sa détresse. Inconsciemment ou non les auteurs ont posé ici toute la mission de l'œuvre d'art, sa valeur de témoignage. Marcel ROY. |
En page centrale sont présentées deux photographies extraites du film :
|
retour à la présentation du film