THÉMATIQUE
Dans la Thématique du Voyageur imprudent
- La Société Idéale
- Le M-ième Siècle
- La place de l'individu
Ou plutôt :
Dans son roman précédent, Ravage, l'auteur initiait sa quête d'une
société idéale où les individus ne seraient pas oppressés - aliéné pour reprendre une terminologie marxiste.
Il n'avait alors abouti qu'à un modèle communautaire pastoral se préservant de tout usage de machines qui intervertissent
vite au désavantage de l'homme, pensait l'auteur, le rapport maître-esclave. Cette vision de la société portait en elle de
grandes contradictions et l'une d'elles servait même à conclure le roman. Dans le Voyageur imprudent, l'auteur pousse plus
avant ses premières investigations, dans une démarche créative plus prospective qu'imaginative, comme
il s'en explique dans le Journal d'un homme simple :
Je m'excuse, je n'ai aucune imagination. J'ai seulement les yeux ouverts et un esprit simple, et assez logique. Ravage, Le Voyageur imprudent et Le Diable l'emporte ne sont que des catalogues d'éventualités. Je n'imagine pas. Je considère ce qui est possible.
Les hommes ne sont pas heureux. Dans un climat de guerre dont la fin parait incertaine,
et toujours imprégné de restrictions et d'interdits, l'auteur semble
d'abord toujours ancré dans l'idée que c'est la société défaillante
qui en est la première responsable, et avec elle son cortège de
malheurs que sont les guerres ou l'esclavagisme des populations par
le travail difficile et le manque trop peu d'argent. Le but du Voyageur et
de son mentor Essaillon est de comprendre pourquoi la société draine
les conflits et broie les populations. Ici encore, la science-fiction
est donc chez Barjavel plus un cadre permettant de loger ses interrogations et spéculations
qu'une fin propre, même avec ce thème du voyage dans le temps intrinsèquement si riche.
Dès le début, le savant prévient :
- Il ne m'est pas défendu d'espérer qu'après avoir voyagé à travers les siècles, étudié dans sa chair l'histoire passée et future, recherché les causes exactes des guerres, des révolutions, des grandes misères, il soit possible d'en éviter quelques-unes... Peut-être accélérer le progrès, emprunter à nos petits-fils des inventions ou des réformes qui les rendront heureux, pour les offrir à nos grands-pères.
Première grande rupture avec Ravage dont le Voyageur imprudent est la continuité, le progrès qui était alors figé après
un brusque retour en arrière se voit ici appelé à être, au contraire, accéléré, quoique dans d'autres directions.
C'est que l'auteur a grandement évolué dans cette voie et définitivement compris, après déjà quelques mouvements timides
en cette direction dans Ravage, que l'industrialisation, le progrès, la technologie ne sont nullement néfastes
en eux-mêmes. Seul le manquement de l'homme à les utiliser avec intelligence substitue à la prospérité
promise par les machines un asservissement supplémentaire. Il est
toujours plus facile, même avec des outils utiles et pacifiques, de
faire le mal qui est instinctif plutôt que le bien :
Toute invention peut être utilisée plus facilement au malheur des hommes qu'à leur bonheur.
Cet engagement de la responsabilité de l'homme est le thème principal qui se
dégage et s'impose dans ce roman. Embryonnaire dans Ravage où il
était en forte concurrence avec une mise en accusation directe de la
science et du progrès, il devient à partir du Voyageur imprudent le
leitmotiv incontournable de l'auteur et donc l'un de ses traits les
plus caractéristiques de sa pensée. Sur les bases de son précédent roman, il sera
constamment interprété par de nombreux critiques comme une
continuité de l'obscurantisme qui régnait dans Ravage. Cela vaudra à
Barjavel une image d'auteur anti-scientifique que son héritage
littéraire à venir - pourtant en accord avec cette direction -n'a
pas réussi à dissiper. Signe des temps, tout au plus
s'accorde-t-on aujourd'hui à voir en lui plus un auteur machiste
qu'anti-progressiste, accusations qui résultent de jugements non
moins légers mais qu'il n'appartient pas à notre Voyageur de
plaider. En même temps qu'il disculpe la technique, l'auteur montre
combien la politique et les classes sociales sont autant d'autres
faux prétextes pour justifier du mal-être qui étreint l'humanité :
Chez les bourgeois et chez les misérables, il retrouvait la même immense fatigue.
Seules exceptions automatiques dans ce triste décor, les enfants,
qui, ainsi que leur aînés avec l'harassement et la futilité de
l'existence, se partagent sans distinctions de classe une béatitude
de vivre :
[...] dans la crasse d'un taudis, ou la luxueuse froideur d'un berceau de riche, le visage paisible d'un enfant. Il s'attardait sur ce miracle, se demandait comment une si belle promesse pouvait pareillement faillir.
Le thème de l'enfance reviendra souvent mais l'on comprend qu'il
n'est pas pour l'auteur une piste sérieuse sur laquelle il peut
s'engager dans sa spéculation du bonheur des hommes. Tout au plus il
est le sujet d'un vif regret ou, plus dans le tempérament de
Barjavel, occasion à se remémorer des temps où le cœur et l'esprit
étaient libres de toutes les égratignures et blessures de la vie.
En même temps que Saint-Menoux qui désespère, on croit presque
entendre l'auteur reconnaître dans un souffle las qu'il lui sera
difficile d'imaginer pour la suite de l'histoire des propositions
vraisemblables pour apaiser les maux de ses personnages, qu'il veut
cadrer avec la réalité :
Rester enfant, était-ce le grand secret du bonheur ? Saint-Menoux comprit l'énormité de la tâche qu'il venait d'entreprendre en compagnie d'Essaillon. Il douta de pouvoir faire quelque chose pour les hommes.
Sa thématique est pourtant déjà assise. L'homme doit prendre en
charge lui même d'être le garant du bonheur des siens et de son
quotidien. Avant de s'y résoudre totalement et de donner à cette
direction sa pleine amplitude dans des essais et contes philosophiques tels que le Prince
blessé, il poursuit ses spéculations qui laissent continuer l'ascension de la Société
sur ces questions. Saint-Menoux est chargé de rapporter pour nous ce qui en seraient les conséquences logiques et attendues.
Après ses premières tentatives où même le romanesque et les inventions permises par la
science-fiction furent impuissantes à assurer aux hommes un environnement
stable, prospère et respectueux des individus, Barjavel en vient
donc à ne croire possible l'adéquation entre l'Homme et la Société
qu'au prix de concessions extrêmes envers un communisme absolu.
On ne peut oublier que l'époque faisait du comunisme (soviétique - le bolchévisme)
une redécouverte plus concrète, et que le pouvoir en place le dressait en épouvantail des plus terrifiants
face à une opinion parfois ambigue. Barjavel lui-même confessait peu après la guerre dans le Journal d'un homme simple :
Le communisme m'attire et m'effraie. Il propose une justice sociale idéale. Mais la
justice sociale peut-elle exister? Depuis le commencement des siècles, l'homme
n'a jamais trouvé une solution sociale au problème du bonheur. Tout au plus
peut-il espérer, d'une meilleure répartition du travail et du profit, le bien-
être. La propagande bourgeoise nous fait du communisme un épouvantail. Il faudrait
voir. Nous ferons sans doute l'expérience, que nous le voulions ou non. (...)
Le communisme ne justifiera le sang versé pour lui, par lui et contre lui, que s'il parvient
à s'étendre au monde entier. S'il se fait écraser, il sera bien coupable.
Dans le roman, sa vision est cependant éloignée des considérations politiques,
puisque, se livrant à un exercice d'imagination dont on aurait tort de croire
qu'il tombe dans la fantaisie, il redéfinit jusqu'aux aspects les
plus inaltérables de l'être humain, sans lesquels on hésiterait
encore à le nommer ainsi. Cette population d'êtres nouveaux,
Barjavel va la chercher aux confins des temps. En l'an 100 000.
S'il se donne la liberté d'explorer le futur à des échelles
singulièrement éloignées, c'est qu'à son habitude, il veut créditer
son histoire, sinon de réalité, au moins de vraisemblance. L'auteur
n'est pas intéressé par la conception gratuite d'une civilisation
sur une planète éloignée, où il serait libre de redéfinir jusqu'aux
lois physiques s'il le voulait. Ce qui l'intéresse est de savoir en
quoi et comment l'avenir peut améliorer l'humanité. Désireux d'en
finir avec les hypothèses laissées ouvertes par Ravage - où la
technique vue comme un instrument dont un mauvais artisan ne
tirerait rien de bon -il s'essaye à une transformation biologique
pour remplacer les outils proscrits. C'est donc tout naturellement,
l'évolution comme moteur des transformations en tête, qu'il projette
son regard sur un futur géologique. À l'époque où il écrit le
roman, le voyage dans le temps est déjà, sinon une innovation, du
moins un thème en jachère, très peu exploré. En poussant la portée
de ses voyages par delà l'entendement, Barjavel donne une extension
supplémentaire à son roman, qui par ailleurs rencontrera peu
d'échos dans la S.-F. à venir, celle-ci trouvant avec aisance
l'extravagance dans d'autres mondes plutôt que sur Terre mais dans
d'autres temps.
Les considérations d'une telle société idéale future constituent le
plus gros du roman. Il est intéressant de noter que c'est aussi
cette idée du roman qu'a retenu la traductrice pour l'édition
anglaise, en mettant en relief ces voyages au delà de toute limite
dans un titre non moins exagéré : « Future Times Three » (le futur
× trois, une traduction moins littérale et plus littéraire
serait « le futur trois fois plus loin »). Le texte original retient
principalement pour le titre, l'accident qui survient en troisième
partie du roman. L'auteur ayant probablement épuisé son sujet - une
société future idéale - cherche une autre fin, et il prend un cap
tout à fait différent et plus classique pour un lecteur moderne,
celui du paradoxe temporel, dans un passé raisonnablement proche.
Il y réussit d'ailleurs admirablement, d'abord parce qu'il innove
dans un domaine promu au plus bel avenir, ensuite parce que cela lui
permet de trouver une fin au roman (c'est peut-être cette
préoccupation qui l'a incité à écrire une troisième partie) sans
laquelle il serait resté sans issue. Contrairement à son
prédécesseur Ravage, le Voyageur imprudent est un roman complet,
avec une fin que l'on peut compter parmi les meilleures de l'auteur.
Il ne l'aurait pas été s'il ne s'était appuyé sur le voyage entomologique. Celui-ci ayant
pour principale finalité la vision globale d'une société parfaite, que Saint-Menoux va expliciter
pour le lecteur dans ses rapports, il n'y avait guère d'opportunité d'y faire naître et d'y
entretenir une intrigue durable, ce qui lui sera très facile dans la dernière partie où le
voyageur se retrouve face à des obstacles psychologiques, sociaux ou de causalité pour le piéger.
Saint-Menoux constate d'ailleurs qu'il est idiot de désespérer des erreurs de l'an
100 000, telle la mort d'Essaillon, qui peuvent toujours se résoudre en les
prenant de court. Par contre, devant s'expliquer à un fonctionnaire de police du passé, ou ayant
tué son ancêtre, Saint-Menoux et avec lui le lecteur se retrouvent à la merci d'une intrigue que
l'auteur est libre de monter de toutes pièces. Barjavel jugera le paradoxe qu'il a préparé pour
la fin du roman si délectable qu'il y reviendra 15 ans plus tard pour le commenter et le
renforcer. Ce faisant, il redonne de l'importance à cette troisième partie devant la seconde.
C'est que l'auteur n'a plus d'estime pour cette possibilité entrevue d'une société idéale
moyennant une restructuration biologique complète et nouvelle distribution des comportements et sentiments humains.
Il va pour cela décrire une évolution de la biologie elle-même, qui donne son titre à la section,
en remplaçant la moitié féminie de l'Humanité par Les Mères Universelles dont le seul rôle
est d'engendrer tous les êtres humains de leur zone géographique de l'an 100 000, fécondées
par l'existence même des hommes qu'ils viennent lui sacrifier à l'appel d'un instinct qui est le
paroxysme de ce que Barjavel chantera avec tant de poésie dans d'autres ouvrages.
J'ai fait le tour du géant. Je l'ai trouvé pareil de partout. Il avale par toutes ses bouches, à la cadence de plusieurs centaines par minute, la foule des hommes ravis. Ses milliers de lèvres qui s'ouvrent et se ferment composent un bruit mou, un clapotis de mer d'huile.
La foule impatiente qui se presse au-dehors ne doit pas connaître la mort abominable qui l'attend, le piège affreux vers lequel l'attire le mirage. Mais ces êtres ont-ils seulement la notion de la mort ?
Car la Mort et l'Amour, ou du moins ce qui en est le vestige sous forme de pur intinct, sont déjà étroitement liés chez l'auteur :
L'être-montagne blotti dans sa carapace de terre, c'est - je n'ose écrire la femme - c'est la femelle, c'est la reine. Et les homoncules qui piétinent d'impatience dans la poussière, ce sont les mâles.
Je comprends maintenant leur joie. C'est vers la vie, et non pas vers la mort, qu'ils se précipitent. Comme mes contemporains, mes frères, me paraissent misérables à côté d'eux !
Le mirage à mille visages, qui attire les petits mâles vers la femme unique est peut-être le seul trait commun entre leurs amours et les nôtres. (...)
Tout en haut de l'énorme masse, sous la voûte de la coupole, dans un lit de cheveux d'or repose la tête de la reine. A peine plus grande qu'une tête de femme nôtre, elle s'incline en arrière, les yeux clos.
Ses cheveux l'entourent de leurs vagues, viennent battre mes pieds de leur flot blond.(...)
Comme un orage, une expression violente bouleverse parfois la face baignée d'or, tord sa bouche, ravage son front. Sans ouvrir les paupières, elle se tourne à droite et à gauche dans l'oreiller de ses cheveux, se débat, puis peu à peu retrouve son calme, sans que j'aie pu deviner si c'est la joie de l'épouse ou la souffrance de l'accouchée qui a un instant troublé son ineffable repos... "
Si la pensée philosophique sur l'Amour, la Vie et la Mort est bien présente, l'extrême aboutissement
- ou extrapolation - a mené l'auteur jusqu'à une inspiration entomologique
dont les sources profondes dans la pensée de Barjavel restent mystérieuses.
Il serait possible d'y voir une réaction à la politique et propagande nataliste et
"matriarchique" de l'époque - le Maréchalisme est à sa période triomphante en ses années d'occupation allemande -
ou de manière plus "littéraire", un pendant à la répartition de l'humanité en Morlock et Elois telles que Wells
la décrit dans son roman (répartition tout aussi "fonctionnelle" et "sentimentale" : aux uns les plaisirs, aux autres la nourriture, le paiment se faisant...en nature).
Il est aussi intéressant de noter que le début du siècle vit la publication des Souvenirs entomologiques
du provençal J.H.Fabre, qui fut le premier à décrire avec précision et aussi poésie les mœurs intimes des abeilles en paritculier.
Mais si la solution ne reviendra plus, le problème lui sera une grande constante, et
il se plaira des années plus tard à ré-imaginer le monde et le vivant dans Si j'étais Dieu.
Pour ce qui est du voyage dans le temps en lui-même, qui constitue le reste du roman,
il ne sera plus jamais mis à l'honneur par l'auteur, et cela montre bien combien cette
préoccupation ne fut que momentanée et seulement destinée aux besoins directs du roman.
Revenons donc au cœur de la thématique de l'ouvrage, celui du bonheur, du bien-être d'une
civilisation, qui constitue le fil directeur pour la construction de cette société de l'an
100 000. Par bonheur d'une civilisation entendons la bienséance collective des individus
qui la composent. Or il apparaît que la notion de collectivité entrave celle du bonheur de ses
membres. Le bonheur est du ressort de l'Homme seul, et il est vain de tenter de conduire l'humanité
sur un chemin de sagesse. Son évolution nous échappe :
« Le destin de chaque individu était peut-être susceptible de modifications, mais celui
de l'humanité demeurait inexorable.[...]À force de bonté, de patience et d'amour, il est
sans doute possible de sortir un homme, une femme, du marais d'ennui et de souffrance dans lequel
nous pataugeons tous. Mais rien, personne, ne peut empêcher la multitude de se ruer vers sa fatalité. »
C'est ainsi qu'il se trouve contraint de faire évoluer la « multitude »
pour que le bonheur ne soit pas l'affaire que de quelques uns. Il propulse son voyageur à une
époque si éloignée que l'espoir d'y rencontrer la perfection est sérieux. Celui-ci ne sera pas déçu.
« Les principes de justice et de bonheur social, pensés de
façon exacte par les cerveaux des hommes, se libéraient de
l'autorité humaine qui n'avait jamais su les appliquer »,
Mais ces acquis ne sont possibles que par la rupture d'avec l'homme
tel que nous le connaissons et qui n'a pas su ou pu atteindre ces
idéaux qu'il a pu pourtant concevoir :
Les hommes perdirent leur individualité. Ils ne purent profiter de leur toute-puissance. Leur
pouvoir personnel était nul.
Dans une sorte de satire mélée d'humour et d'extravagance, Barjavel
a donc sacrifié l'homme pour ne retenir que des ressemblances
caricaturales des diverses classes sociales : les ouvriers sont une
masse docile d'une bonhomie et d'une naïveté enfantine. Les soldats
sont des brutes gigantesques et sans cervelle qui s'entre-dévorent
quand on n'a plus besoin d'eux. Les classes privilégiées ou
bourgeoises sont d'horribles excroissances charnues rivées au sol
que l'on approvisionne en lait et en vin, qui rotent et sourient
gaiement. Les serviteurs font un va-et-vient incessant et
résigné. Les centres névralgiques et décideurs sont dépouillés de
tout moyen d'action et entassés autant qu'enfermés produisent sans
discontinuer de l'« intelligence ». Les membres femelles assurant la
reproduction sont de généreuses masses de chair sur lesquelles se
ruent une population innombrable et obnubilée de petits
mâles affamés. Ces diverses « classes sociales » sont enchaînées à
leur condition, à leur rôle, ce qui toutefois est leur facilite la tâche.
Pour le bien de tous, la force nouvelle a fixé à chaque homme une
tâche précise, a modifié son corps afin de lui rendre son travail
plus facile, a diminué la puissance de ses sens dans le but de lui
éviter non seulement toute douleur, mais toute sensation inutile au
fonctionnement de la cité. Il ne voit, n'entend, ne sent que ce qui
concerne sa tâche, dont rien ne le détourne.
L'Homme d'aujourd'hui est pour Barjavel un univers de miracle, que
rien ne limite véritablement. Il a pour lui tout seul de quoi goûter
toutes les manifestations sensibles de la nature, il est doué de
conscience et d'autonomie, d'intelligence s'il en fait l'effort.
Malgré cela l'Homme n'est pas heureux, alors qu'il regroupe à lui
seul toute une population d'êtres spécialisés de ce futur entrevu
par l'écrivain. Barjavel ne critique pas cette société cellulaire du
millième siècle, où chacun est physiquement sacrifié à sa tâche dans
l'inconscience totale d'être vivant. C'est que peut-être dépité du
gâchis de voir l'Homme en pleine possession de moyens qu'il
n'utilise que contre lui, il trouve la force de les lui ôter, et de
croire que le résultat en vaut la peine. Barjavel a mesuré la portée
de l'insignifiance, de l'inutilité de l'être humain, de l'homme ou
de l'humanité toute entière. Il n'accepte pas ou ne comprend pas la
façon dont cela doit se faire : il n'accepte pas la souffrance qui
doit accompagner le vivant dans sa chair et son âme. Il y a au moins
un avantage à cette société programmée, et pour Barjavel, ce n'est
pas le moindre :
Il est certain qu'ils ne sont pas malheureux. C'est déjà beaucoup.
On doit voir dans l'amputation des cordes sensibles de l'être le
même réflexe de refoulement qui verra l'auteur agiter l'hypothèse de
la destruction nécessaire de l'humanité si celle-ci n'arrive pas à
se défaire du cortège d'horreur et de douleur qui l'accompagne. Pour
Barjavel, la disparition semble préférable à l'éternel piétinement
tortueux et sans espoir.
~THÉMATIQUE~
La Place de l'Individu
Mais dans le détail, Barjavel n'aura jamais le loisir de se
satisfaire complètement de cette conception. Il y a toujours l'issue
pour celui qui fait l'effort d'être conscient qu'il est vivant et
d'en mesurer la signification, de pouvoir s'extraire de l'absurdité
de l'humanité dont il fait pourtant partie. Pour Saint-menoux, il y
a d'abord Annette, celle qu'il aime :
Elle représentait pour lui, tout ce qui, dans notre humanité
si archaïque, agitée de si effroyables secousses, tachée de tant de
misères, donnait pourtant à la vie un goût de merveilleuse
douceur.
L'amour est-il toujours la solution ? Peut-être pas systématiquement,
en tout cas, un certain apprentissage, une prise de conscience sont
nécessaires pour y trouver un refuge à son âme meurtrie. Pour
l'auteur, le seul foyer où l'on réside un jour sans avoir de serrure
à forcer est, encore une fois, celui de l'enfance :
Il s'aperçut qu'il ressentait un bonheur extrême, une satisfaction chaude de cœur à laquelle s'ajoutait un sentiment de sécurité. Peut-être avait-il connu pareille joie au temps de son enfance, lorsqu'il venait, essoufflé par les jeux, chercher la paix dans les bras de sa mère.
Mais c'est un foyer dont il faut vite déménager. Après lui, quelle
autre terre d'accueil ? L'amour semble bien hostile et difficile à
emménager. Il est un autre hospice qui est soi-même. C'est évident
dans la symbolique que l'auteur met en place où Saint-Menoux se
rencontre physiquement, en deux entités, l'une partie dans le temps
à la rencontre de l'autre. Avec un autre corps à regarder, la
suffisance de sa seule personne éclate au grand jour, il n'y a rien
à se cacher à soi même, pas de honte, pas d'incompréhension, pas de
mensonge. Poursuivant sur l'enfance perdue, l'auteur écrit :
Il n'avait jamais, depuis, rencontré un être digne d'une semblable
confiance. Il venait, à l'instant, de le trouver, le compagnon
parfait, celui que les hommes cherchent en vain, l'âme jumelle. Entre
eux, point de mensonge, de fausse pudeur. Et leur égoïsme, c'était
justement ce qu'ils partageaient le mieux.
Bien sûr la présence matérielle de son double n'est qu'un artifice
d'image pour concrétiser le confort d'être avec soi même. D'ailleurs les
deux Saint-Menoux ne se parlent même pas, ils savent déjà tout l'un
de l'autre. Il n'y a donc nul besoin de machine à remonter le temps
pour se trouver mais simplement de prendre conscience que cela est
possible, prendre conscience de soi. Sur la fin de sa vie, pourtant,
l'auteur dira au contraire que l'immortalité doit être insupportable
car il faudrait la parcourir toujours en compagnie de soi même. Pour
l'heure il fait encore l'apologie de cette coexistence inconnue de
l'individu avec lui même, ignorée, que l'on recherche chez les
autres alors qu'il suffit de se tourner sur soi même. Il y voit même
un but ultime.
Chacun ne fait que se chercher, toute sa vie, à travers les femmes et les hommes.
L'homme doit donc assurer, par les moyens qu'il peut ou qui lui sont
offert, son propre bonheur. Il ne le peut pas toujours. Le monde
extérieur peut se montrer plus fort dans sa cruauté que les
meilleures volontés. Il faudrait donc déjà que ceux qui le peuvent
veillent à ce que rien, guerres, maladies ou autres catastrophes,
n'empêchent ceux qui en font l'effort de vivre une vie
heureuse. C'est ainsi qu'à Saint-Menoux protestant :
« Nous nous lançons dans une aventure impossible. Il n'y a certainement rien à faire. »
pour arracher les hommes à leurs misères.
le scientifique Essaillon réplique :
« Je ne prétends pas réformer les hommes et éviter à chacun les
souffrances qu'il se fabrique. Mais nous pourrions peut-être éviter
à tous quelques grands malheurs collectifs. Nous ferons ce que nous
pourrons. Nous ne sommes pas Dieu. »
C'est un objectif qui semble facilement accessible : laisser à chacun
la responsabilité de sa propre destinée et ne prendre en charge pour
la collectivité que la lutte contre les catastrophes communes qui
broient sans discernement les résignés et les vertueux, les
coupables et les justes. Mais comme nous le savons déjà, le mal
n'est jamais qu'embusqué derrière le bien. Il faut d'infinies
précautions pour que ressurgissent pas de toute entreprise
mille fléaux prêts à s'abattrent sur tout un chacun.
« Avant d'agir, il faut connaître. Le Chinois qui inventa la
poudre pour feux d'artifice aurait peut-être arrêté ses recherches
s'il avait prévu le canon »
Et quand bien même ces précautions seraient prises, la vie est d'une
telle complexité qu'il n'est jamais facile de savoir quelle est la
bonne route, la bonne décision à prendre. C'est Essaillon qui fait
ce constat, en parlant des pilules à voyager dans le temps, qui
permettent d'effacer toute erreur, de sans cesse recommencer jusqu'à
atteindre la perfection :
En réalité, je ne crois pas qu'un homme, en possession de mes pilules, si égoïste, si déterminé
fut-il, pourrait s'en servir librement. Il trouverait toujours un amour ou une haine pour l'enchaîner.
Essaillon parle de sa fille, née de la rencontre de l'infirme et de
son infirmière. En s'évitant l'accident, Essaillon sacrifie ce qui
en a résulté en même temps que la souffrance et le handicap : sa fille
chérie. S'éviter tous les désagréments, c'est aller au devant d'une
vie monotone et sans relief, sans trous et crevasses, mais sans
cimes et sommets non plus. Il n'y a pas d'idéal, seulement des
compromis, des obligations d'aller au devant des flagellations en
même temps que des sacrements. Le bonheur est indissociable de la
souffrance. Vu autrement, même les grands malheurs sont occasions à
provoquer des événements notables, précieux, importants. Il faut
donc tâcher de regarder ce qu'il y a de bon dans l'adversité. Le
savoir ne dispense pas de la fatalité.
Il faut aller chercher la morale du Voyageur imprudent dans cette
errance métaphorique qui voit Saint-Menoux traquer aux confins des
temps le bonheur des hommes, ignorant le sien propre qui était, dès
le début, à côté de lui, bien présent. Sa soif d'une délivrance par
le progrès, l'avenir et les sociétés futures ont été une fuite en
avant toujours frustrée. Ainsi en sera-t-il pour celui qui attend
les améliorations pourtant inévitables du progrès pour améliorer son
quotidien. La même erreur est possible dans l'autre sens, ainsi que
s'en aperçoit Saint-Menoux qui témoigne d'abord d'une nostalgie
amère lors de sa vision très partielle de la société du siècle
dernier :
Voilà des gens heureux, se dit le voyageur. Je suis allé chercher bien loin dans l'avenir le bonheur qui était derrière moi...
Des investigations plus poussées vont lui montrer la véritable nature de ces temps révolus
où règnent la maladie, la misère la plus noire et des notions totalement archaïques d'égalité
sociale et de justice. Prisonnier dans cette époque, il se lamente à l'idée de ne jamais
revoir son époque. Sauvé une première fois, il n'aura cesse de vouloir repartir à nouveau,
se promettant le bonheur pour plus tard, pour bientôt. La dernière leçon qu'aurait pu tirer
Saint-Menoux s'il ne devait s'hypothéquer pour les besoins du paradoxe, c'est qu'à force
d'entêtement l'on réussit toujours à fuir son bonheur.
CRITIQUES PUBLIÉES
AU SUJET DU ROMAN
En 1943 le roman paru en feuilleton dans l'hebdomadaire Je Suis Partout, publication a priori dénuée
d'arrière-pensée politique de la part de l'auteur, mais sans doute "récupérée" par ce journal fortement
"collaborationiste". Cette parution fut ensuite reprochée à Barjavel, qui s'en défendit de bonne foi comme il
l'a confié à l'écrivan Pierre Assouline auteur d'un livre sur cette période (L'Épuration des intellectuels, Éd. Complexe, 1985)
{ voir }
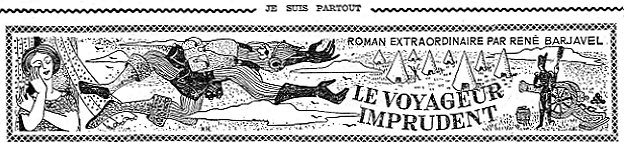
Comme on l'a vu, le Voyageur imprudent fut récompensé en 1944 par le Prix des Dix, décerné par ce jury d'humoristes et
collègues de Barjavel dans ses activités journalistiques (Jan Mara écrivait aussi et illustrait ses articles dans « Le Merle blanc »
Le roman connut un indéniable succès dès sa parution ; la revue de l'actualité littéraire "PARU" en présenta une longue critique, ou plutôt un résumé précis, dans
son numéro 4 d'avril-mai 1944 { lire cette critique complète },
La revue IDÉES, éditée à Vichy comme "Revue de la Révolution Nationale" et qui avait un an plus tôt publié
une critique de Ravage sous la plume d'Henri-François Rey, présentait Le VBoyageur Imprudent dans l'un de ses derniers
numéros (mai 1944) sous la plume de J/M/ (Jean Malabard)
{ voir cet article }.
L'ajout du post-scriptum lors de la réédition en 1958 dans la toute jeune collection Présence du futur,
coincidant avec le développement en France de la vogue de la Science-Fiction, fit redécouvrir le roman.
{ voir },
La jeune revue « Fiction », qui avait déja salué Ravage quelques années auparavant,
publia une critique dans son numéro 50 de janvier 58. La rubrique "Ici on réintègre" se proposait de
raviver le souvenir d'œuvres des "précurseurs" dela science-ficiton en établissant des rapprochements
de différentes œuvres. Ainsi la comparaison avec La Machine à explorer le temps de H.G. Wells y est développée, puis les
rapports avec L'Œil du purgatoire de Jacques Spitz, autre roman de temps devenu non séquentiel, paru à la même époque.
{ lire la critique complète },
Onze ans plus tard, dans son numéro 191 { voir ce numéro }
la même revue Fiction présentait une critique de Démètre Ioakimidis portant sur Ravage et Le Voyageur imprudent - consacrant ainsi la dualité des deux romans.
Le voyageur imprudent est un livre qui fait honneur à l'imagination de l'auteur,
et qui stimule celle du lecteur. C'est un des classiques de la science-fiction, et on applaudit à sa réédition.
Si Ravage est un roman que l'on peut lire, Le voyageur imprudent est d'autre
part un roman à lire d'urgence, au cas où cela n'est pas encore fait, et à relire dans
les autres cas
La critique complète est consultable
{ ici },
Lorsque les années 1950 virent le thème des voyages temporels connaître un succès croissant
dans la science-fiction, certains critiques et commentateurs n'ont pas manqué de saluer la
paternité de Barjavel pour le concept du Paradoxe. Depuis, le thème s'est quelque peu banalisé.
 La page "Dans l'inspiration du Voyageur imprudent"
se propose de présenter les développements ultérieurs qu'eut ce thème, ainsi que des œuvres dont la paternité
avec Le Voyageur imprudent est indéniable. On y trouvera aussi effleurées des questions plus
théoriques qui se trouvent posées.
La page "Dans l'inspiration du Voyageur imprudent"
se propose de présenter les développements ultérieurs qu'eut ce thème, ainsi que des œuvres dont la paternité
avec Le Voyageur imprudent est indéniable. On y trouvera aussi effleurées des questions plus
théoriques qui se trouvent posées.
CRITIQUES DES VISITEURS
Faites vous aussi partager par l'intermédiaire du barjaweb
votre opinion et vos analyses sur Le Voyageur imprudent.
COPYRIGHTS
- Le texte est © Éd. Denoël, 1944, et 1958 pour l'édition avec additif final.
- L'image du frontispice est © Livraphone, animation par G.M.Loup. Cette image est celle qui orne le
boîtier d'un pack contenant 4 cassettes audio, où le texte est interprété par Eric Dufay,
Thierry Leclerc, Sophie Lahayville, Pierre Val, Nicolas Mead, Fabienne Chaudat,
Marie-Christine Letort, Paul Lerat, Florance Vignon, Jean-François Dupas, Jean-Claude Rey
et Fréderique Wojek. Production et réalisation Arnaud Mathon (1983). (Note : il s'agit de la seule œuvre
de Barjavel éditée commercialement sur support sonore en texte intégral. Il existe cependant d'autres cassettes de "livres
lus" uniquement disponibles auprès d'associations pour mal-voyants.)
- Le petit voyageur entre les onglets est inspiré par la couverture de Jean Pierre Rosier pour l'édition Brodard et Taupin, traitement d'images et animation par G.M.Loup.
- Le diable vert dans la section Personnages est extrait de l'illustration par Sylvie Selig pour les éditions Folio.
- Tout ce qui n'est pas mentionné ci-avant est © G.M. Loup.