 |
RADIOSCOPIE de René BARJAVEL |  |
Le 11 mars 1981, René Barjavel était reçu sur France-Inter par Jacques Chancel dans son émission "Radioscopie".
| 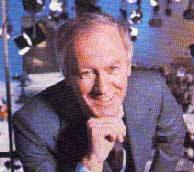
|
Un nombre non négligeable de ces entretiens fut par ailleurs retranscrit et rendu disponible en quatre recueils aux éditions Robert Laffont, puis dans la collection de poche J'ai Lu ; le témoignage de notre auteur n'y figure pas non plus...
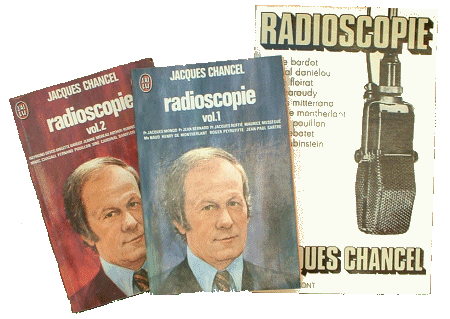
Je n'ai trouvé qu'une seule mention de cet entretien, sous la plume de Barjavel lui-même dans son (article au Journal du Dimanche du 15 mars 1981).
Ce point de départ donne la mesure de l'intérêt que peut présenter ce document, et ce n'est que récemment qu'un
enregistrement presque complet m'en a été confié par la filleule de Barjavel amicalement rencontrée lors de la
préparation des Journées Barjavel 2004 à Nyons.
Enregistré à la radio pendant sa diffusion, la qualité en est moyenne, et les premières minutes manquent, ainsi que
les dizaines de secondes correspondant au retournement de la cassette. Mais ce sont bien là de minimes désagréments pour ce document
inestimable qui aurait pu disparaître, comme tant d'autres, à jamais. Ces "confidences" de l'auteur éclairent
remarquablement sa pensée, exprimée de faàon vivace, chaleureuse, spontanée et à la fois réfléchie.
C'est le texte de cet entretien, jamais réédité par Radio-France, et donc quasiment introuvable, qui se trouve ci-après retranscrit par mes soins.
Cette transcription reprend telles quelles les expressions et les tournures de phrases, spontanées et parfois hésitantes, du dialogue parlé en direct ; on ne trouvera donc pas de "sic", les expressions parfois un peu "bizarres" qu'on pourra rencontrer sont bien celles employées par l'auteur dans ce qui est parfois sa réflexion à voix haute. La ponctuation et la typographie adoptées s'efforcent modestement de rendre le rythme et les intonations des locuteurs. De mineurs ajustements, entre crochets [], complètent des élisions spontanées dans le langage parlé.
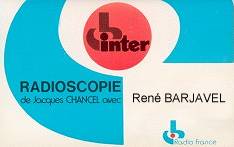
Dès le début de l'émission, il semble que René Barjavel se soit laissé entraîné sur le terrain du débat à propos de la politique, sujet pour lequel il éprouve surtout de l'agacement comme il s'en explique rapidement.
[......]
René BARJAVEL. - On est toujours enfermé entre les réalités politiques telles qu'elles existent et les idéologies politiques qui ne valent pas mieux. Alors, on oublie une chose, c'est que ces politiques sont des filles du dix-neuvième siècle, ce sont des vieilles dames rhumatisantes et des vieilles barbes mitées, n'est-ce pas, tout ce qui a été inventé comme idéologie au dix-neuvième siècle ne tenait aucun compte de cette réalité fantastique qu'est la technologie. La technique d'aujourd'hui, qui peut délivrer demain l'homme de cette malédiction du travail qui pèse sur lui depuis des milliers d'années.
Jacques CHANCEL - Il faut également reconnaître que, aujourd'hui, on leur a tordu un peu le cou, aux idéologies, même les choses ont changé...
R.B. - Oui, c'est exact, c'est exact...
J.C. - Elles ont la vie un peu moins dure...
R.B. - Mais tout de même, enfin, je vois ce qui est proposé aux gens, c'est toujours la même chose, c'est un... Enfin, je ne suis pas venu ici pour parler politique [rire], j'essaye de m'en évader le plus possible...
J.C. - Nous sommes dans des temps de la politique
R.B. - Nous sommes, nous sommes... eh là ! nous sommes baignés dedans, nous sommes abreuvés...
J.C. - C'est le grand massacre d'ailleurs...
R.B. - Oui, et... j'étais dernièrement, il y a quelques jours dans un collège où les jeunes me posaient des questions, parce qu'ils étudient, ils ont la chance d'ailleurs d'étudier la littérature contemporaine, de mon temps la littérature s'arrêtait à Victor Hugo, à la rigueur ça allait jusqu'à Baudelaire sur la pointe des pieds, on n'allait pas plus loin. Aujourd'hui, ils lisent les contemporains, et de temps en temps, ils me demandent de venir parler avec eux. Et je leur parlais justement de ce monde de Gondawa, de La Nuit des temps, ce monde où l'homme est délivré du travail obligatoire par la machine, il travaille s'il veut, quand il veut, à ce qu'il aime, et il reçoit de toute façon une part du produit du travail des machines, suffisant pour lui assurer non seulement le nécessaire mais le superflu, qui est encore plus indispensable que le nécessaire. Et ils étaient quelques-uns qui avaient lu le bouquin, je leur ai demandé « Est-ce que vous auriez, est-ce que vous aimeriez vivre à Gondawa ? », oh ! ça a été un cri unanime : « oui ! », alors je leur ai dit « il faut le faire, il faut le faire, c'est le monde de demain, il faut l'inventer, il faut obliger les vieilles barbes à fabriquer ce monde. »
J.C. - Ils vous ont posé quelles autres questions, les jeunes ? Ils étaient préoccupés de quoi ?
R.B. - Ils sont très préoccupés de leur avenir. Très préoccupés de leur avenir...
J.C. - Et pessimistes ?
R.B. - Pas pessimistes, mais anxieux, inquiets : « qu'est-ce qui va se passer ? qu'est-ce qui va nous arriver ?
comment pourrons-nous faire face ? »
Voilà les questions qu'ils posent. « Qu'est-ce qu'il faut
faire ? » Sauf ceux qui s'en vont sans vouloir se poser de questions sur les rails tracés par leurs parents
ou leurs éducateurs ; mais beaucoup se posent des questions.
J.C. - René Barjavel, toute votre œuvre est bâtie sur un monde différent. Il y a Ravage, il y a La Nuit des temps, et en fait, vous revendiquez la fin du monde. Mais pas la fin du monde comme certains peuvent l'attendre. En fait vous revendiquez la naissance d'un autre monde, d'un autre territoire.
R.B. - Oui, je crois... j'ai écrit Ravage en 1942, n'est-ce pas, où je... toute l'histoire de Ravage est basée sur l'hypothèse d'un manque total d'énergie, brutalement. C'était une hypothèse folle à l'époque, complétement imbécile...
J.C. - Quarante ans déjà...
R.B. - Oui... Et les jeunes qui (re)découvrent le bouquin aujourd'hui s'imaginent que je l'ai écrit l'année dernière, n'est-ce pas, parce que malheureusement l'actualité rend cette "hypothèse" vraisemblable. Mais, je crois qu'effectivement, notre monde de technologie, si elle... s'il ne se met pas d'accord avec la technologie, s'il la subit au lieu de l'adapter aux besoins et aux désirs de l'Homme, ce monde, ce monde qui est extrêmement vulnérable et fragile, ne peut que s'écrouler et périr. C'est pourquoi j'ai écrit au fond des fins du monde, au fond chacun de mes bouquins est une histoire de la fin d'un monde, de la fin de notre monde.
J.C. - Vous êtes écrivain, René Barjavel, et vous savez la fragilité d'un livre. Un livre, on lui laisse le temps d'exister, enfin on lui accorde trois mois, quatre mois, cinq mois lorsque tout marche bien. Mais, il faut reconnaître qu'en face de cet espace quand même très limité et d'un prix très fort - les livres valent chers - il y a le Livre de poche, qui réinvente - et je pense à Ravage, et je pense à La Nuit des temps - s'il n'y avait pas le Livre de poche, vous n'auriez peut-être pas vous-même existé en tant qu'écrivain.
R.B. - C'est très possible, j'aurais, en tous cas, eu une vie d'écrivain certainement beaucoup plus limitée, et je n'aurais pas eu ce contact avec la jeunesse, avec les adolescents, qui m'emplit de joie...
J.C. - Qui est une continuité...
R.B. - Qui est une continuité, et qui est un rajeunissement pour moi. Parce que le Livre de poche, lui, réimprime constament ; au fur et à mesure qu'un livre s'épuise, on réimprime. Ce qu'on ne fait pas pour les livres ordinaires, sauf pendant les premiers mois de succès. Mais après c'est fini ! Les libraires reçoivent tellement de nouveautés que les bouquins de l'année dernière, ils les renvoient, ils ne veulent plus en entendre parler.
J.C. - Vous trouvez que l'on écrit trop ?
R.B. - Non... on n'écrit jamais trop. Mais je crois que la politique actuelle de l'édition et de la librairie, qui oblige les livres à faire leur carrière en quelques mois, est une politique néfaste et dangereuse, surtout pour les jeunes auteurs. Car les livres de poche ne prennent un bouquin que s'il a tiré au moins à trente mille exemplaires, que s'il a fait déjà son succès. Un débutant, un garçon qui débute, qui a fait un livre qui va tirer à dix-mille exemplaire, ce qui est un gros succès..
J.C. - Ce qui est déjà un succès...
R.B. - Ce qui est un gros succès pour quelqu'un qui débute - n'ira pas dans le livre de poche, ou, exceptionnellement ; donc la carrière de son livre s'arrête au bout de quelques mois, parfois de quelques semaines. Et il faut qu'il recommence l'année prochaine, s'il le peut, n'est-ce pas. Alors, dans le temps, les librairies avaient le rayon Montherlant, le rayon Mauriac, le rayon Paul Bourget, le rayon Gip, le rayon Colette, etc., et on trouvait là tous leurs titres, qui prenaient la poussière, mais de temps en temps quelqu'un venait chercher un exemplaire. Ça n'existe plus, et c'est très déplorable.
J.C. - Vous ne pensez pas que l'on trouve quelque part dans une librairie le rayon Barjavel ?
R.B. - Oh, on trouve peut-être les deux ou trois derniers titres, oui, mais enfin...
J.C. - Quelle couleur donnez-vous à la science-fiction ? Est-ce une aventure qui a commencé très tôt ? Oui, elle a toujours existé...
R.B. - Elle a toujours existé, mais elle est en train, depuis la guerre, non, même plus tôt, ça a commencé en Amérique dans les années 35, 40, elle est devenue, je ne dirais pas un nouveau genre littéraire, mais une nouvelle littérature. Je crois... je n'appelle pas la science-fiction un genre littéraire parce qu'elle comprend tous les genres. Elle a commencé par l'épopée, comme toutes les littératures : les grands chefs-d'œuvre américains, ceux de la science-fiction, sont des épopées, formidables, et ensuite, après l'épopée vient le temps du lyrisme, puis le temps du roman, alors il y a la science-fiction lyrique, la science-fiction satirique, la science-fiction politique, la science-fiction euh... et cœtera, tous les genres sont représentés dans la science-fiction. Et également le bon et le mauvais, comme dans toutes les littératures.
J.C. - Mais on ne peut pas mêler science-fiction et fantastique. Comment situez-vous Wells, par exemple ?
R.B. - Ah, Wells, pour moi, c'est le génial inventeur de la science-fiction. Pour moi... plus que Jules Verne, n'est-ce pas ; j'ai lu tout Jules Verne quand j'avais douze ans, et ensuite tout ce qui a été traduit de Wells. Et pour moi, Wells... on n'a rien inventé depuis Wells, on a brodé, on a utilisé les données fournies par la technique et par la science moderne, mais Wells avait tout inventé. Et avec un talent... formidable.
J.C. - Mais, faire de la science-fiction, en fait, c'est... trouver des raisons aux événements ? J'imagine par exemple,
R.B. - Euh, oui, ça c'est un genre un peu particulier de la science-fiction. Moi, je dois dire que dans Le Grand Secret, j'ai effectivement inventé le dialogue, enfin, pas le dialogue mais les raisons de l'entrevue entre De Gaulle et Massu : il est allé lui confier le petit flacon..
J.C. - C'est bien pour cela que je vous parle... [rires]
R.B. - Mais...
J.C. - Alors, d'après vous, par exemple De Gaulle-Massu, que s'est-il passé ?
R.B. - Moi j'ai pensé qu'il était allé lui confier la pilule qui rend immortel, n'est-ce pas. Comme il ne voulait pas l'avaler, et qu'elle tombe entre toutes... entre n'importe quelles mains, il est allé lui confier avec l'ordre de la détruire s'il lui arrivait quelque chose. Pourquoi pas ? Vous savez que je me suis aperçu, en regardant la télévision, et les films, que la reine d'Angleterre ne se séparait jamais de son sac à main. Jamais. Même quand elle est chez elle, en chignon, qu'elle reçoit des amis, elle a son sac à main... Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac à main ? je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a... Alors là j'ai de nouveau inventé, la pilule d'immortalité, n'est-ce pas...
J.C. - Et vous y croyez, en fait, à cette pilule d'immortalité, et peut-être la voudriez-vous, pas pour vous...
R.B. - Non, pas du tout, mais alors pas du tout... non, je trouve que la longueur de
la vie humaine est convenable... convenable. J'ai soixante-dix ans, j'ai commencé le compte à rebours, je vois venir la
fin sans angoisse et sans peur, et avec, je ne dirais pas satisfaction, je l'accepte, gentiment. Je voudrais
mourir... bien conscient, mais sans souffrir ; ça, la souffrance, je n'aime pas ça.
Mais la science-fiction
permet beaucoup plus, pour moi, en tout cas, non pas de réinventer le passé, mais d'essayer de deviner ce que pourrait
devenir l'espèce humaine, c'est ça mon grand souci, j'aime l'homme, j'aime cette bête merveilleuse et stupide, c'est
un... j'ai une grande, grande affection pour lui, et il semble qu'il soit lancé malgré lui dans des aventures tellement
misérables et stupides, par exemple quand vous voyez aujourd'hui ce qui se passe dans le monde, ces deux blocs, qui
sont opposés, qui ne veulent la guerre ni l'un ni l'autre, qui vont peut-être la faire malgré tout, par imbécillité, par
impuissance, et les pauvres types qui vont recevoir la bombe sur la figure, n'est-ce pas, alors j'essaie d'inventer après
cet épisode qui sera peut-être, qui sera je l'espère évité, mais qui semble menaçant, après cet épisode qu'est-ce qui
pourrait se passer, est-ce qu'on [ne] pourrait pas faire tout de même un monde agréable, un monde où on pourrait vivre ?
Par exemple dans Une rose au paradis...
J.C. - Une rose au paradis, qui est votre dernier roman... c'est Adam et Ève ; le monde a éclaté parce que chacun a sa bombe, enfin on peut même l'avoir nous-même dans notre poche...
R.B. - Oui, bien sûr...
J.C. - Et puis il ne reste plus qu'un couple... Vous avez quand même sauvé du massacre un couple.
R.B. - Oui, parce que... on dit que mes livres sont pessimistes, ce n'est pas vrai. Ils finissent tous sur l'espoir. L'espoir est menu, mais il est là. Et là cette fois-ci je crois que l'espoir est mieux que, est plus sensible que dans mes autres romans, parce que, à la fin, il ne reste que... tout est à réinventer, tout, tout, tout, tout, tout... Puisque les... la génération qui venait dans l'Arche, ne sait absolument rien du passé, puisqu'il y avait... M. Gé avait supprimé les livres, supprimé les images, et se trouve donc en...
J.C. - Qui est-ce, M. Gé ?
R.B. - Ah, M. Gé...
J.C. - On le rencontre dans beaucoup de vos livres
R.B. - Ah, c'est un personnage que j'aime beaucoup, parce que je peux lui donner des visages différents, et dans Colomb de la lune par exemple, il est policier, dans Le diable l'emporte il est déjà Deus ex machina, etc., mais c'est un... pour moi, quand je l'ai inventé, c'était à la fois une synthèse de Gulbenkian, le marchand d'armes, et de Gurdjieff. Voyez-vous c'est pour ça que je l'ai appelé M. Gé. C'est à la fois un thaumaturge, et un marchand. C'est un homme... ou c'est Merlin, si vous voulez, un peu Merlin l'Enchanteur, qui est un personnage qui me hante. Merlin l'Enchanteur est à la fois fils du Diable et fils de Dieu, n'est-ce pas, alors il y a les deux. M. Gé, c'est ça. Il a provoqué la catastrophe finale dans Une rose au paradis, mais en même temps il va sauver l'humanité et les espèces animales et végétales.
J.C. - René Barjavel, on s'aperçoit que la marge est quand même très étroite entre l'espoir et le désespoir.
R.B. - Oui... Je crois que, le désespoir, on y est amené par la considération des circonstances, de l'actualité, ou même de certaines circonstances de sa propre vie, n'est-ce pas. L'espoir, c'est un... c'est une denrée merveilleuse qui est comme une fleur sur les ruines. L'espoir et l'humour sont les deux grandes ressources des moments où l'on pourrait désespérer. Et, je finis toujours mes livres sur l'espoir et le rêve. Je crois que... et dans mon métier de journaliste, je m'efforce de donner toujours à mes lecteurs des raisons d'espérer, des raisons d'aimer la vie.
J.C. - Des raisons de s'amuser aussi...
R.B. - Et de s'amuser, mais surtout des raisons de... j'essaye de les aider à vivre. La vie est pénible, surtout en France aujourd'hui où chacun essaye de... où tout le monde essaye de convaincre les gens qu'ils sont malheureux, qu'ils sont très malheureux, que tout va mal, que ceci que cela, que... Et moi j'essaye de rappeler : « Eh bien, écoutez, il y a cette chose merveilleuse, vous êtes vivants, voile une chose qu'on oublie tout le temps, c'est un... vous êtes vivants, et vous l'êtes peut-être pour longtemps encore, mais vous l'êtes peut-être pour cinq minutes, alors, pendant ces cinq minutes, sachez que vous êtes vivant... » voila, c'est ça.
J.C. - Vous êtes écrivain, alors, on le devient écrivain, ou bien on vient au monde avec ce don ?
R.B. - Eh bien, dans mon cas, je peux vous donner une réponse très précise, parce qu'il y a une circonstance dont je me souviens, qui s'est passé quand j'étais un enfant, c'était en cinquième, j'étais un des très mauvais élèves, un cancre, oh non, pas bruyant, pas désordonné, je ne mettais pas la pagaille dans la classe, mais je [ne] foutais rien, j'étais dans le... on m'avait mis au fond de la classe parce que je donnais le mauvais exemple, j'avais le nez en l'air, j'avais de l'encre jusqu'aux yeux, mes livres étaient écornés, mes journaux, mes cahiers déchirés, etc. Et puis un jour, à ma grande stupéfaction, le professeur de français a lu ma rédaction, en classe. Alors je ne savais... je ne me rappelle plus quel était d'ailleurs le sujet, je le regrette... j'aurais bien aimé... Mais, ça a été pour moi un choc extraordinaire, et à la sortie il m'a dit « Barjavel, vous êtes intelligent, il faut travailler ». Jusque là on m'avait dit que j'étais un cancre. Alors ça été un choc, terrible
J.C. - L'étincelle...
R.B. - Et j'ai été, à partir de ce moment-là, le garçon qui écrit pour être le premier, pour être... et qui soigne ses devoirs, et qui soigne son écriture... Enfin j'ai été un écriveur, si vous voulez, dès ce jeune âge. Mais un écrivain je le suis devenu grâce à Denoël. Denoël était l'éditeur qui était, vous le savez, sans doute le plus brillant éditeur d'avant-guerre, et je l'ai rencontré à Vichy, il m'a demandé de venir travailler dans sa maison, j'étais chef de fabrication chez lui. Et j'étais quand même à ce moment-là, j'étais journaliste, je collaborais à divers journaux, dont Le Merle Blanc, de brillante mémoire, et un jour je lui ai apporté un manuscrit. En tremblant. Il l'a lu dans la nuit, et le lendemain matin il m'a consacré sa matinée pour me montrer quels étaient mes dafauts et quelles étaient mes qualités, ce que je devais gommer, et ce sur lequel je devait au contraire appuyer le pied, sur l'accélérateur. Et ça a été formidable, formidable. Je n'ai plus jamais eu besoin de lui, après. En une matinée, il avait fait de moi un écrivain.
J.C. - Il vous avait tout dit.
R.B. - Oui
J.C. - Alors il y a la politique dont nous parlions tout à l'heure, il peut y avoir la violence, dont on parlait dans les actualités, mais vous semblez, vous, René Barjavel, vous semblez aujourd'hui vouloir donner des recettes de vie, ce que vous ne faisiez pas dans votre jeunesse ; alors on peut imaginer également que vous avez mûri, comme les fleurs que vous avez inventées.
R.B. - Oui, c'est évident, j'ai appris à vivre dehors... [rires]
J.C. - Les fleurs et les animaux, parce que vous vivez dans ce monde-là...
R.B. - Je suis très amoureux de la vie, bien que je n'ai pas peur de la mort. J'aime vivre, j'aime... et j'aime tout. J'aime... tout à l'heure, avant de venir ici, j'étais sur le pont.. comment il s'appelle, Bir-Hakeim, entre la Maison de la Radio et ces étranges tours qui s'élèvent de l'autre côté, j'avais mon petit appareil photo pendu au cou, et j'ai fait une dizaine de photos, parce que la lumière était extraordinaire, le ciel déchiré, le soleil qui crevait les nuages, et je suis constament en train de regarder autout de moi, de humer, de sentir, de toucher... L'Univers est formidable, n'est-ce pas, si nous voulions bien ouvrir nos fenêtres au lieu de les fermer et de courber le dos en tournant le dos à la lumière, nous serions... Moi je suis constament émerveillé.
J.C. - On peut se demander ce que vous faites, dans notre Europe, car en fait, votre religion, ce devrait être l'Hindouisme. Vous savez que, là-bas, toute âme créée doit successivement traverser des tas de vie. Vous auriez dû être cet homme qui traverse gaiement des tas de vies...
R.B. - Il ne traverse pas gaiement, malheureusement... Ils sont tellement épouvantés par la vie. C'est ce que je reproche à l'Hindouisme, n'est-ce pas, c'est qu'il considère la vie comme une épreuve abomina-a-able, en échange, ils ne rêvent que d'une chose, c'est le Nirvana où ils ne ressentiront plus rien. Moi je trouve...
J.C. - Le trou de la serrure... Alors êtes-vous assez affiné pour justement passer par le trou de la serrure qui serait alors à ce moment-là porte du Nirvana ?
R.B. - Je ne pense pas, je ne pense pas... Je pense que, si vraiment ils ont raison, j'ai encore besoin de pas mal d'épreuves. Vous connaissez l'histoire de ces deux saints qui étaient sous un grand arbre. Alors Vishnou leur est apparu, il leur a dit :« Vous êtes tellement saints, je vais vous faire un plaisir, posez-moi une question, je vous répondrai. ». Unaniment, d'une seule vois ils ont dit :« Dieu, dis-nous, combien de temps il nous reste encore à vivre ? » Alors montrant l'immense arbre sous lequel ils étaient, il leur dit : « Oh ! à peu près autant de feuilles qu'il y a à cet arbre ! » Alors il y en a un qui dit :« Oh ! tant que ça ! » et l'autre qui dit : « Ah ! plus que ça ! » Et Vishnou lui a dit : « Toi, tu es déjà au Nirvana ! » [rires]
J.C. - Et c'est vrai, ils étaient là depuis un siècle, et le lierre avait poussé sur eux...
R.B. - Oui, c'est ça, et ils avaient des nids d'oiseaux dans les oreilles... Mais, moi, je suis plutôt celui qui dit : « Ah ! », n'est-ce pas, que celui qui dit : « Oh ! »
J.C. - Mais, René Barjavel, j'ai retenu surtout tout à l'heure que nous étions donc vivants, et que nous avions peut-être seulement cinq minutes encore à vivre, et je crois pouvoir dire, nous pouvons dire que la vie n'est faite que d'instants...
R.B. - Oui...
J.C. - Donc, il faut se saouler de la vie ; et dans le même temps on peut se dire que faisons-nous de tout ce travail ? que faisons-nous de tout nos ennuis, que faisons-nous de toutes nos occupations, puisque, finalement, il y a un moment où tout craque... cela ?
R.B. - Oui...
J.C. - C'est mal fichu tout ça...
R.B. - Si on regarde bien, n'est-ce pas, la vie n'est faite que de l'illusion du présent. Le présent n'existe pas, parce que, je suis en train de vous parler...
J.C. - Nous vivons quand même au présent...
R.B. - Non !
J.C. - Ah, si !
R.B. - Non, non, non, parce que, pendant que vous me dites « Nous vivons au présent », « nous vivons » est déjà au passé, et « présent » est encore dans le futur, n'est-ce pas... Et à mesure que vous parlez, ça glisse dans le passé, et, si vous voulez, nous vivons comme au cinéma il y a la permanence des images dans la rétine, nous avons une espèce de permanence du moment où le futur devient passé, c'est ça notre présent, c'est une illusion. Mais alors, je crois que nous pouvons quand même profiter de cette espèce de halo pour avoir une attitude qui ne soit pas négative, c'est à dire, le passé, qui est, au fond, nous sommes surtout fait de passé, de souvenirs, et nous sommes entre le passé, et le futur, notre présent est illusoire. Donc, si nous passons notre temps à nous ronger avec les souvenirs, en nous disant « Ah, là,là ! j'aurais pu faire ça ! », « Oh, là, là ! que c'était moche cette année... », et à craindre en même temps le futur, en disant « qu'est-ce qui va nous tomber sur la figure ? », alors notre présent est abominable. Tandis que si nous nous souvenons des bons instants, et si nous espérons du futur au lieu de désespérer, alors notre présent est tout éclairé.
J.C. - Nous sommes quand même de curieux optimistes, car c'est vrai qu'il faut vivre à fond l'instant, mais dans le même temps, on dit « tiens, je ne peux pas faire ça tout de suite, je ne peux pas faire ça demain, mais dans un an j'irai ; ou alors on dit « Je vais commencer un livre », comment peut-on être sûr qu'on le terminera ? Ou bien nous somes dans des moments de combats politiques, il y a des gens qui se disent « je vais engager, m'engager, et engager un monde dans un septennat, pour sept ans... » Comment peut-on être sûr d'un tel avenir ...
R.B. - Oui, oui, ça... d'ailleurs l'avenir est toujours différent de ce qu'on a espéré, ou de ce qu'on a craint, ou de ce qu'on a cru construire. C'est pourquoi il faut vivre le présent dans l'espoir du futur, et en essayant de construire le futur d'une façon agréable. Mais... surtout, surtout, savoir qu'à chaque instant, on est là, et on vit.
J.C. - Mais vous y croyez, à un monde sans travail ? Les mondes dont vous avez souvent parlé, vous dites qu'aujourd'hui il y a un mot qui désespère le monde, c'est le mot chômage, demain, ce mot n'existera plus, parce qu'on ne travaillera pas. Alors, que fera-t-on si on ne travaille pas ?
R.B. - Je ne crois pas du tout...
J.C. - On s'amusera à travailler... [rires]
R.B. - Je ne crois pas du tout à la civilisation des loisirs... Il n'y a rien de plus emmerdant que les loisirs. On ne va pas passer son temps à aller pique-niquer, ou à aller faire de la planche à voile, ou à...
J.C. - Quel boulot !
R.B. - Ou à jouer à la belote. Mais, je crois, non, ce n'est pas le travail qui sera supprimé, c'est l'obligation du travail...
J.C. - Voila...
R.B. - C'est ça, c'est ça... Actuellement nous vivons, quelque soit la forme de la société, sous la devise « travaille ou crève ! », n'est-ce pas ; c'est ça, c'est ça... or la machine peut libérer l'homme de cette obligation, parce que le boulot obligatoire, on va le faire faire par la machine, et l'homme, lui, on pourra assurer le travail agréable. Il pourra recommencer à savoir se servir de ses mains, alors qu'il ne sait plus, alors qu'il ne sait plus rien faire de ses mains...
J.C. - À réinventer l'outil...
R.B. - Réinventer l'outil... moi, j'ai connu ça dans mon enfance, la civilisation de la main et de l'outil, ça existait encore, n'est-ce pas, ça a disparu en un demi-siècle. Mais aujourd'hui, à quoi nous servent nos mains ? Moi, à moi, à utiliser un espèce de petit morceau d'ébonite qui s'appelle un feutre, l'ouvrier d'usine appuie sur des boutons, ou il fait fonctionner des leviers, il n'est qu'un organe de la machine, les dactylos, les secrétaires, appuient sur les...tapent sur la... La main ne sert plus à rien.
J.C. - Il y a quand même des artisans, il y a des compagnons encore qui travaillent très bien, et de leurs mains et de leurs outils...
R.B. - Oui, bien sûr, ce sont des merveilleux hommes...
J.C. - Ce sont des privilégiés alors ?
R.B. - Exactement. Et regardez quelle est leur joie au travail ; ils font quelque chose, et l'objet qu'ils ont, ils l'ont entre leurs mains, et quand il est fini ils le posent, là, c'est formidable...
J.C. - René Barjavel, j'ai reconnu ce que vous étiez dans un livre où vous vous livrez, cette fois-ci, où vous parlez de vous. Son titre, La Charrette bleue. On sait que vous êtes né en Provence, mais je vous ai vu surtout disant le récit d'une aventure qui est la vôtre, celle de votre enfance, dans la boulangerie paternelle...
R.B. - Oui...
J.C. - Vous auriez pu faire un excellent boulanger ? Là aussi, on travaille de ses mains...
R.B. - Je crois que j'aurais fait un bon boulanger, oui, je crois... Mais, je pense que tout de même j'aurais giclé au dessus du métier... enfin, je ne sais pas, je n'en sais rien... Tout s'est fait malgré moi : mon père était boulanger, il était fils d'un petit paysan extrêmement misérable, son père avait voulu qu'il ait au moins de quoi manger toute sa vie, il (lui) avait fait enseigner le métier de boulanger... Lui, a voulu assurer ma sécurité, en disant « il faut qu'il soit fonctionnaire », il espérait que je serais facteur, ou quelque chose comme ça, et m'a emmené au collège, pour que je fasse des études.
J.C. - Ou huissier dans un ministère...
R.B. - Oui...
J.C. - Ou gardien de la paix...
R.B. - Ou gardien de la paix...
J.C. - Pour avoir la retraite...
R.B. - Peut-être, à la rigueur, inspecteur de l'Instruction Primaire, ou quelque chose comme ça, ou instituteur, enfin, alors là ç'aurait été le comble de la gloire pour la famille...
J.C. - De la promotion sociale...
R.B. - Oui, alors, il n'a pas du tout pensé à m'apprendre son métier ; pour lui, il voulait que je fasse... que je fasse mieux, n'est-ce pas, il fallait que je fasse mieux...
J.C. - Vous le regrettez ?
R.B. - Non, je ne le regrette pas, j'aime beaucoup mon métier, j'aime beaucoup mon métier ; et surtout parce que j'ai la conviction d'être comme mon père, de m'efforcer d'être utile. Vous savez, Léon Bloy disait « Celui qui écrit pour ne rien dire, est un misérable et un prostitué ». Nous sommes tous, les écrivains, nous sommes tous des prostitués, de toutes façons, nous vendons notre cerveau par petites tranches, n'est-ce pas ; mais, il faut s'efforcer de ne pas être des misérables. Pour ça, simplement, s'efforcer de mettre quelque chose dans le livre qu'on écrit, de l'espoir, de l'amour, des... essayer de faire que ces livres soient utiles. J'ai eu comme ça deux récompenses extraordinaires il y a quelques mois. J'ai écrit un petit livre, un conte qui s'appele Le Prince blessé, qui est, si vous voulez, qui est une recette de bonheur. C'est un conte à la façon des mille et une nuits, qui montre, avec des images, comment un homme peut sombrer dans le désespoir d'une façon stupide, et s'en guérir s'il a le sursaut nécessaire. Et j'ai reçu une lettre d'un lecteur belge, d'un jeune, d'un homme de vingt-cinq ans à peu près, qui m'écrit « Monsieur, vous m'avez sauvé du suicide. Parce que j'avas un chagrin d'amour, j'étais... j'étais prêt à me suicider, j'ai lu Le Prince blessé et je me suis rendu compte à quel point j'étais idiot. » Et, j'ai reçu la même semaine, une lettre d'une vieille dame qui a lu la...
J.C. - Une Rose au paradis...
R.B. - Non, pas Une Rose au paradis, La Charrette bleue
J.C. - Ah, La Charrette bleue alors, votre autobiographie...
R.B. - Elle avait perdu son mari il y a quelques années, et elle était seule, elle sombrait dans le chagrin, et ce livre, je ne sais pas pourquoi, alors là, je ne comprends pas, ce livre l'a aidé à surmonter son chagrin, etc. Et, j'ai reçu également une lettre du fils d'un de nos confrère, d'un écrivain qui est mort, récemment, ce fils est un jeune homme, je ne vous dirai pas son nom, parce que c'est une histoire intime, il me remercie, il me dit que La Charrette bleue l'a aidé à surmonter le chagrin de la mort de son père, il me met cette formule qui m'a bouleversé, « Vous avez sauvé un enfant... » Eh bien, ça, voila, voila pourquoi j'aime être écrivain.
J.C. - Vous avez l'impression d'être utile...
R.B. - Oui, c'est ça...
J.C. - Et puis, vous souhaitez réinventer toute une civilisation, qui s'en va, c'est la civilisation artisanale, paysanne, et à un certain moment même, vous vous dites « c'était le temps où les paysans n'étaient pas encore des agriculteurs. »
R.B. - Oui, c'est un merveilleux mot, le mot paysan, oui...
J.C. - Paysan, oui, il y a « pays », d'abord...
R.B. - Oui, et oui... dire que dans le temps il a servi d'injure... Les gens de la ville disaient « Paysan ! »... Quelle honte...
J.C. - Aujourd'hui, ils vivent de manière différente.
R.B. - Aujourd'hui, ce sont des agriculteurs industriels. Il y a encore quelques paysans en Auvergne, ou dans certains coins de montagne, ou en Provence ou dans les Pyrénées, mais des agriculteurs... Je (ne) sais pas si vous vous souvenez de cet interlude que la deuxième chaîne, je crois, ou la première, il n'y en a que deux à ce moment-là, passait par moment l'amour de la Beauce... Vous savez, il y avait, je ne sais pas, trente percherons alignés qui tiraient des charrues, et c'étaient... c'étaient encore des paysans. Chacun de ces chevaux avait le type qui le soignait, qui le connaissait, qui... Ah ! enfin, maintenant, un tracteur, ça suffit...
J.C. - Oui mais il ne faudrait pas tomber aussi dans... de l'autre côté de la montagne, c'est à dire dire ouvertement et fortement que les tracteurs ça fait du bruit, ce n'est pas beau, et que les paysans doivent travailler plus fort, comme avant...
R.B. - Non, non, certainement pas, il [ne] faut pas... le retour en arrière c'est de la stupidité, n'est-ce pas. Mais, je pense que la crise de l'énergie peut nous aider, s'il n'y a pas une crise brutale, la crise de l'énergie peut nous aider à modifier progressivement et humainement notre civilisation. Je pense que, un jour, il y aura un accident dans une centrale atomique. C'est inévitable, on a beau dire le contraire, n'est-ce pas... Alors, à ce moment-là, il y aura une telle révolte, une telle horreur qu'on va renoncer à l'énergie atomique. Et, il faudra bien revenir à des énergies plus ponctuelles, c'est à dire renoncer à ces grandes centrales qui distribuent de l'énergie dans toute une nation, et revenir à des énergies ponctuelles, que ce soit la géothermie, que ce soit l'énergie des sources...
J.C. - Du soleil...
R.B. - Du soleil, etc., etc. Et là, on va pouvoir refleurir peut-être une civilisation, je ne dirais pas du village, mais presque. C'est à dire des petits groupes industriels autour desquels s'agglomérera la main-d'œuvre, les gens iront travailler à pied ou à bicyclette, et il n'y aura plus ces concentrations urbaines qui sont la plaie et l'horreur de notre civilisation.
J.C. - Avez-vous le sentiment, René Barjavel, d'appartenir à cette époque ? Êtes-vous de votre temps ?
R.B. - Oui, tout à fait, tout à fait, et il me passionne ; il me passionne... La seule chose qui me fait regretter de mourir bientôt, c'est que... je ne vais pas voir la suite ; c'est la curiosité. Je suis curieux, fantastiquement curieux.
J.C. - Vous pensez que vous reviendrez ? Un jour, pour voir, juste ?
R.B. - Je ne sais pas, j'espère... Mais en tout cas, ce qui va se passer dans vingt ans ou dans trente ans, je ne le verrai pas, et c'est bien dommage. J'aurais bien aimé le voir.
J.C. - La Charrette bleue, c'était un navire, c'était un vaisseau de bois, c'était une manière de partir quelque part et de fuir, enfin de prendre l'évasion comme nécessité première...
R.B. - Oui, c'était... cette charrette, pour moi, c'était... quand je l'ai vue
J.C. - Le grand large...
R.B. - Quand je l'ai vue, dans les copeaux, c'était quelque chose de formidable...
J.C. - C'était un charron, celui qui avait fait la charrette ?
R.B. - Oui, c'était un charron, le père Illy, son atelier existait encore il y a quelques mois, je crois qu'on est en train de le démolir... Et... c'était... je suis remonté sur cette charrette pour écrire ce livre, et j'ai retrouvé ce petit garçon que j'étais, avec beaucoup d'amitié, et avec une certaine distance, quand même, j'ai l'impression que... j'étais... c'était moi, mais c'était quelqu'un de différent, en même temps.
J.C. - Alors, un jour vous avez rencontré un petit garçon qui était vous, et aujourd'hui vous pouvez rencontrer un homme qui est vous ?
R.B. - Ça c'est plus difficile [rires]... c'est plus difficile...
J.C. - L'exploit...
R.B. - Je crois qu'il y a des tas de techniques pour plonger au dedans de soi-même et se rencontrer, j'en ai essayé quelques-unes... pffft... je suis revenu bredouille... Alors, on est ce qu'on parait, on est ce qu'on s'efforce d'être, on l'est pendant cinq minutes, et puis après, les réflexes, les habitdes s'emparent de vous, on est plus ou moins... une girouette.
J.C. - Avez-vous des enfants, René Barjavel ?
R.B. - Oui, j'ai deux enfants, un garçon et une fille, et j'ai sept petits-enfants.
J.C. - Qui vous ressemblent ?
R.B. - Euh... mon fils, oui, me ressemble physiquement, il est plus grand et plus beau que moi, c'est un gaillard formidable, il est très... c'est un merveilleux garçon et il est plongé, lui, dans l'informatique, vous savez, c'est encore un genre de... un genre de science-fiction. Et ma fille, me ressemble aussi, mais elle réussit quand même à être belle, c'est merveilleux. Et j'ai quatre petites-filles absolument adorables, et trois petits-fils superbes, alors de ce côté-là, ça va...
J.C. - Vous avez assuré l'avenir ?
R.B. - Oui, ça va...
J.C. - Alors il y a cette Rose au paradis, Une Rose au paradis, je dois dire d'abord que le titre est, sur [la] couverture, je ne dirai pas rouge mais rose, rose-orange-rouge, et on peut penser qu'une rose, au départ, c'est presque un acte politique... on sent percer, et fleurir la rose de François Mitterand.
R.B. - [rires] J'ai bien...
J.C. - Le livre n'a rien à voir avec ça...
R.B. - Non, non, absolument. J'ai bien recommandé à mon éditeur de ne pas employer surtout une rose [pour] figurer dans la publicité ou sur la couverture, parce que je ne voulais tout de même pas transporter tout de suite Monsieur Mitterand sur le trône de Saint Pierre, à défaut de celui de l'Elysée. Non, cela n'a absolument rien à voir avec la politique, avec les candidatures...
J.C. - Enfin, en vous lisant, on comprend tout de suite que vous ne donnez en fait qu'un véritable espoir, vous ne craignez pas, comme je vous le disais, la fin du monde, mais vous attendez la naissance d'un autre monde. Et alors, vous dites, en effet, vous avez raison, qu'il y a aujourd'hui un progrès tout à fait ahurisant, c'est l'armement. Et moi je pense qu'on veut tellement la paix, qu'aujourd'hui, on est dans l'obligation de préparer toutes les guerres.
R.B. - C'est effrayant. C'est effrayant, n'est ce pas, quand on pense...
J.C. - C'est fou...
R.B. - Quand on pense qu'il suffirait de... mais de vingt-quatre heures de bonne volonté, d'un côté comme de l'autre. Oublier tous les... toutes les habitudes intellectuelles et émotionnelles, et puis se mettre l'un en face de l'autre, là, les... ceux qui sont importants dans ce monde, et qui tiennent les bombes entre leurs mains, et puis leur... régler tous les problèmes, ça pourrait demander quelques jours... C'est formidable... Et ils ne le font pas, et ils [ne] le feront pas...ils [ne] le feront pas... ça me parait... c'est l'imbécillité fabuleuse de notre temps.
J.C. - Mais personne ne peut faire confiance à l'autre ? C'est cela, donc, l'obligation de s'armer sera plus grande chaque jour. Et alors d'ailleurs vous le dites bien, tout le monde aujourd'hui, tout le monde, ou plutôt demain, pourra fabriquer sa bombe. D'ailleurs il y a eu une expérience...
R.B. - Ça commence...
J.C. - Rappelez-vous aux États-Unis... Alors vous allez très loin, vous dites que tout le monde pourra l'avoir dans la poche, enfin vous dites « la C.G.T aura la sienne, l'archevêché aura la sienne », enfin... alors ça complique singulièrement les choses...
R.B. - [rires] Oui, mais, ce jour-là viendra.
J.C. - Vous imaginez s'il l'avait dans les partis politiques, aujourd'hui, hein ?
R.B. - C'est effrayant...
J.C. - Pour la prochaine éventualité...
R.B. - Ou une bande de pirates... Mais, vous savez, il faut exagérer la vérité pour la rendre vraie. Dans un livre, c'est ça. Pour faire sentir à quel point elle peut être vraie. Et je crois qu'effectivement, d'ici dix ans, la fabrication artisanale de la bombe sera possible. Et on a déjà vu des fuites d'uranium, n'est-ce pas, on le sait très bien, il y a eu des histoires plus ou moins étouffées, d'autres dont on a beaucoup parlé, il y a de l'uranium qui manque, un peu partout, où est-il passé ? Donc, un jour ou l'autre, un type va se trouver à la tête d'une bombe, et puis il y en aura un autre, et puis, etc. Alors... Donc je suppose que tout pète, finalement, et là aussi, il faut exagérer la vérité...
J.C. - Et demain il y aura des traficants d'uranium...
R.B. - Oui, sans doute, oui, il y en a peut-être déjà.
J.C. - Alors il y a un massacre, puisque la bombe, comme c'est...c'est l'explosion universelle, tout le monde va faire péter sa bombe, alors il y a massacre. Mais, quand même, parce que vous avez du goût pour l'optimiste, vous êtes ainsi, vous sauvez la générosité, vous sauvez un couple. Un couple qui, d'ailleurs, deviennent, pour moi, Adam et Ève, et ça recommence
R.B. - C'est Adam et Ève...
J.C. - Ça recommence, et vous y croyez faussement, car Adam et Ève ne pouvaient pas savoir...
R.B. - Adam et Ève ne pouvaient pas savoir, eux, ils savent. n'est-ce pas...
J.C. - Oui, oui
R.B. - Eux, ils savent. donc, il y a peut-être l'espoir qu'ils commenceront d'une façon différente. Et, il y a des passages que j'aime beaucoup dans mon livre, [rires] le...
J.C. - Dialogue amoureux, d'abord...
R.B. - Oui, il y a le dialogue entre les jeunes amoureux ; il y a aussi la séduction du jeune mari par la femme la nuit, que je me suis délecté à cette séduction discrète, la façon dont elle s'introduit dans le lit de l'homme dont elle est tombée amoureuse, avec une telle discrétion...
J.C. - Oui, mais on voit là, René Barjavel, que vous aimez les jeux de l'amour, hein ?
R.B. - Oui, bien sûr, bien sûr, ça fait partie des bonheurs de la vie, n'est-ce pas, j'aime la femme - je ne dirais pas « j'aime les femmes », moi je [ne] suis pas un homme à femmes, je trouve que la femme est une des choses les mieux réussies du monde. Et, il y a aussi le... la grande manif' que j'aime beaucoup, la manif' des femmes enceintes...
J.C. - Des femmes enceintes...
R.B. - Oui, je crois que... on en a vu tellement de ces manifs... j'ai le malheur d'habiter à côté d'un ministère, et j'en vois défiler au moins une par semaine, et elles ne sont pas pittoresques, elles [ne] sont pas drôles, tandis que celle-là, elle est drôle...
J.C. - Et puis vous parlez d'une manière très particulière à la femme. Enfin, là, c'est M. Gé qui parle à Sielfried, mais je voudrais quand même dire un peu ce que peut dire un homme à une femme : « Ne te ferme pas, laisse-moi te regarder une dernière fois. Il faut toujours que vous fermiez quelque chose en vous : votre tête, votre cœur ou votre sexe, ou les trois. Vous croyez vous mettre à l'abri, vous ne faites que meurtrir les hommes qui vous aiment. Vous les obligez, pour vous connaître, à se transformer en conquérants. Alors, ils fabriquent les bombes. Ce n'est pas le monde qu'ils veulent détruire, c'est le mur derrière lequel vous vous cachez... »
R.B. - [rires] Je crois qu'il y a pas mal de...
J.C. - Hein, oui...
R.B. - C'est assez vrai... que les hommes qui vous écoutent, en jugent. S'ils ont... s'ils sont amoureux.
J.C. - Vous êtes un homme de souvenir, là ?
R.B. - Oui, bien sûr, un homme d'expérience... [rires] On rencontre toujours , même chez la femme la plus amoureuse, ce besoin de défense, ce besoin de se mettre dans une citadelle, ça c'est certain. Qu'on est obligé de... ou bien on est obligé de s'y introduire, soit par la ruse, soit par... non, la force ne vaut rien - mais par le... ou alors à la faire fondre sous l'amour... mais, ce n'est pas toujours facile...
J.C. - Très sincèrement, René Barjavel, vous pensez que demain, après-demain, dans cent ans, dans deux cents ans, il y aura comme ça un couple sauvé du massacre, c'est à dire le couple de votre roman, Une Rose au paradis...
R.B. - Oui.
J.C. - Couple sauvé du massacre, et qui réinventera un monde vrai, parce qu'il saura tout ce qui s'est passé avant, et il pourra prévoir. Vous pensez que c'est possible ? Non, allons jusqu'au bout de l'utopie. D'abord ce n'est pas croyable...
R.B. - Non, ce n'est pas croyable.
J.C. - Parce que, autrement, ce serait... on peut tout faire, on peut tout réinventer, mais je ne pense pas qu'on puisse changer l'Homme
R.B. - Je ne crois pas que ce soit possible, effectivement, je ne crois pas. Au bout d'une génération ou deux, ou trois, ils auront oublié, et tout recommencera. D'ailleurs, c'était a fin de Ravage. Dans Ravage, effectivement, ils recommencent. Et ils vont recommencer les mêmes âneries. Mais... j'ai eu besoin de le...
J.C. - De le croire...
R.B. - De le croire.
J.C. - De le dire...
R.B. - Parce que... j'ai besoin de le dire, j'ai besoin de le croire ; je voudrais tant que cette graine que j'ai semée dans La Nuit des temps, qui est... c'est une fable, mais, que cette graine germe un peu, quelque part. Vous savez qu'il y a eu un économiste, au début du siècle, qui s'appelait Jacques Dubois et qui avait inventé, ce qu'il appelait l'économie distributrice, et c'était un espèce de socialisme basé sur la distribution aux humains du travail des machines. Et moi je crois que c'est un... c'est ça l'avenir, c'est ça l'avenir, il faut pour ça que le... qu'on abandonne les vieilles pantoufles, qu'on abandonne les vieilles bicyclettes, qu'on abandonne toute cette poussière de.. d'idéologie, d'intérêts, d'égoïsme et d'imbécillité qui nous conduisent au désastre.
J.C. - Mais, depuis le commencement des temps, il n'y a jamais eu un espace de totale liberté ?
L'entretien en est venu à aborder le sujet de l'astrologie.
R.B. - L'astrologie, c'est la trace, c'est le reste d'une civilisation qui avait placé l'Homme au milieu de l'Univers, et qui connaissait les rapports entre l'Homme et l'Univers. Le grand malheur de l'homme d'aujourd'hui, c'est qu'il ne sait plus ce qu'il fait dans l'Univers. Alors, il ne pense qu'à ses petits besoins, ils ne pense qu'à ses besoins immédiats, et son égoïsme s'établit, alors qu'il ne sait pas ce qu'il fait sur la Terre et ce qu'il a à y faire, alors que, certainement, nous avons quelque chose à y faire. Alors, il y a eu des grands ancêtres qui ont su cela. Il y avait encore, je crois, en Afrique, des gens qui le savaient. Il y a eu un merveilleux livre de - comment s'appelait-il ? - il s'appelait Dieu d'eau, de Marcel Griaule Il a... il a eu... il a obtenu la confiance du sorcier des Dogons, après avoir vécu pendant vingt ans avec eux. Et ce sorcier lui a finalement expliqué ce qu'était l'Univers, ce qu'était l'Homme, ce qu'était la place de l'Homme - du Dogon, n'est-ce pas - dans l'Univers ; et pourquoi il labourait de certaines façons, et pourquoi il tissait le tissu d'une certaine façon, et pas d'une autre, parce qu'il fallait que ce soit comme ça pour que l'Univers fonctionne. L'Homme fait fonctionner l'Univers, n'est-ce pas, c'est ça. Et, vous vous rappelez, il y avait aussi, chez les Incas, je crois, je ne sais plus quelle civilisation précolombienne, tous les matins, on faisait lever le soleil ! le soleil ne se levait pas, si l'Homme ne s'en mêlait pas... Et bien, dans ces exagérations, il y a du vrai ; l'Homme a une tâche à accomplir, dans le Cosmos, dans le grand mouvement circulaire des rouages de l'Univers. Et... il ne sait plus. Il est coincé entre les rouages.
J.C. - Vous ne seriez pas loin de dire que le progrès a perverti la vérité de l'Homme.
R.B. - Le Progrès le lui a fait oublier, c'est certain ; le Progrès uniquement matériel.
J.C. - Mais d'où vous vient, René Barjavel, ce goût pour l'invention, que vous avez très profond, ou très haut, ainsi, vous estimiez à un certain moment, qu'il était tout à fait barbare, et inhumain, pour la femme, par exemple, qu'était barbare et inhumaine cette nécessité qu'elle a de porter un enfant pendant neuf mois.
R.B. - Oui, je trouve que c'est tout à fait barbare.
J.C. - Vous vouliez changer tout cela, c'est à dire que, au moment précis où il y a rencontre entre l'homme et la femme, il y ait également changement de sexe. Que l'homme devienne le porteur de l'enfant, et que la femme vive la vie de l'homme...
R.B. - Oui, j'ai inventé ça dans Si J'étais Dieu ! C'est un bonheur, d'être Dieu, de tout réinventer... J'ai inventé neuf nouvelles façons de faire les enfants...
J.C. - Oui, ou vous inventez même que tout devrait venir à un certain moment, au printemps, vous savez, lorsque les femmes fleuriront et donneront des graines.
R.B. - C'est ça, c'est ça, pourquoi pas, c'est une façon aussi... Une fleur, c'est merveilleux, non ? Et je crois que le fait de changer de sexe aussi, à chaque grossesse, ça serait pas mal, parce que comme... comme ça, les hommes et les femmes se connaîtraient mieux.
J.C. - Ah, oui, changer de sexe, d'abord, ça a des avantages, déjà, ça permet de procréer, et puis en plus l'homme, les deux partenaires, peuvent avoir des sensations sexuelles nouvelles. Ça, c'est important...
R.B. - Nouvelles, c'est ça, c'est ça...
J.C. - Car c'est toujours la nouveauté qui est importante.
R.B. - Bien sûr ! Et puis, tant de malheurs conjugaux viennent de l'ignorance de l'autre, et de ce qu'il faut donner... l'ignorance de ce qu'il faudrait faire pour l'autre...
J.C. - Alors là, est-ce de la science fantastique ?
R.B. - Non, je ne crois pas...
J.C. - Ou de la fiction, aux lisières de la réalité...
R.B. - Disons que c'est du fantastique, mais basé sur la conviction qu'effectivement les hommes sont très souvents maladroits, et les femmes aussi, ça arrive.
J.C. - Sur ce sommet qu'est celui des soixante-dix ans, ils vous arrive parfois, René Barjavel, de faire un bilan ? Vous avez l'impression d'avoir construit une œuvre ? D'avoir bien fait votre travail d'écrivain, comme faisait bien son travail de boulanger votre père ?
R.B. - Je suis allé dernièrement dans le pays de mes ancêtres paternels, à Tarendol, et je suis allé visiter le vieux cimetière, qui est un... qui est grand comme ce studio, à peu près, ce sont des cailloux, et il y a la tombe de mon grand-père, Joseph Barjavel, c'est une vieille tombe, il n'y a qu'une vieille couronne de perles qui s'effrite ; mon père est enterré dans un cimetière de la banlieue parisienne, et j'avais conçu le projet de les rassembler tous les deux, et d'y garder ma place, à côté d'eux. Et j'aurais fait une tombe tombale... une pierre tombale pour tous les trois, avec cette inscription : « Joseph Barjavel, paysan, Henri Barjavel, boulanger, René Barjavel, écrivain - Ils ont fait de leur mieux ce qu'ils avaient à faire. » Voila. Je crois que j'ai fait de mon mieux, je ne dis pas que j'ai bien fait, je me suis efforcé de faire bien, c'est autre chose. Et je crois que c'est très important, quand on a quelque chose à faire, quoi que ce soit, dans quelque métier que ce soit, même si c'est déplaisant, il faut le faire de son mieux. Parce que, en le faisant de son mieux, on sert les autres, et on se sert soi-même en même temps. Et, je crois que pour l'écrivain, c'est la même chose que pour le boulanger.
J.C. - Vous n'avez pas réussi au théâtre ?
R.B. - Non, non, il y a eu les circonstances qui ont aidé à mon échec, mais, malgré tout, je crois que je suis un romancier avant tout. Le théâtre... je crois que, pour bien réussir au théâtre, il faut avoir vécu dedans. Vous savez, les grands auteurs de théâtre, ce sont des acteurs : Molière, Shakespeare, même Anouilh a fait du théâtre quand il était jeune, Roussin, etc. Je crois qu'il faut avoir vécu dans ce monde pour sentir les planches, sentir ce langage si particulier. Moi, je me suis cassé le nez dessus.
J.C. - Et vous n'avez jamais envisagé non que vous auriez pu aller sur d'autres chemins, c'est-à-dire réinventer votre vie ? À certains moments de la vie, faut-il changer de parcours ? Je crois qu'il serait bien de se réinventer à chaque moment... bon, vingt ans, trente ans, ça va, mais à quarante ans, on va ailleurs, cinquante, on change encore de cap, soixante, on s'invente une autre vie...
R.B. - C'est très difficile...
J.C. - Hein ?
R.B. - C'est très difficile de se changer, de changer son... métier.
J.C. - Alors, vous rêvez dans vos livres, et vous ne rêvez pas tellement pour vous-même...
R.B. - Voila !
J.C. - Eh oui !
R.B. - Non, mais je fais un métier, n'est-ce pas, c'est un métier, le métier d'écrivain, et je crois que je me perfectionne chaque jour, parce que... je travaille tellement, n'est-ce pas, c'est un... Vous parliez de votre père qui était Compagnon, Compagnon du Devoir, et c'est.. je crois que... s'il y avait des Compagnons du Devoir d'écrivain, j'essaierai de briguer le titre, de le mériter. Pour moi, le chef d'œuvre, ce serait le livre dont les mots seraient totalement transparents. Je veux dire, sans aucun... on ne sente plus jamais l'effort, où le lecteur lirait, et l'image, les images, les personnages, l'histoire, passeraient directement dans sa tête, et il oublierait les mots. Voilà, pour moi c'est ça l'idéal de l'écriture.
J.C. - Il faut également dire que votre métier n'est pas seulement un bonheur, c'est aussi un travail.
R.B. - C'est un gros travail...
J.C. - Vous lui consacrez combien d'heures, chaque jour, à l'écriture ?
R.B. - C'est très inégal. J'écris quand j'ai envie, et quand je n'ai pas envie, je n'écris pas...
J.C. - Vous avez une discipline ?
R.B. - Non, sauf que, quand un livre est en train, et que je vois que ça n'avance pas, je m'oblige parfois à écrire mais, ce n'est pas possible, je crois que le bonheur de ce métier c'est que, justement, c'est la différence avec le métier de journaliste, c'est que, quand on n'a pas envie d'écrire, on n'écrit pas. Le journaliste, lui, il doit fournir sa chronique pour tel jour à telle heure, le romancier, c'est... il y a des jours où l'on est pas en forme, il y a des jours où on a envie de... dormir, des jours où l'on a envie d'aller se promener sous la pluie, faire n'importe quoi plutôt que d'écrire, il y a des jours où, au contraire, ça vous prend comme une furie, on a besoin d'écrire comme on a besoin de manger...
J.C. - Vous avez pu vivre de votre métier ? de votre métier d'écrivain ?
R.B. - Euh... il n'y a pas très longtemps, que je vis de mon métier d'écrivain. Si, si vous voulez, de mon métier d'écrivain sous toutes ses formes, c'est à dire de cinéma, écrivain de journal, écrivain de romans ; mais, maintenant, je vis de mon métier d'écrivain de romans et j'en suis très heureux ; grâce à mes lecteurs.
J.C. - René Barjavel, peut-il y avoir cette rencontre imprévue, que vous souhaitez, c'est à dire la rencontre de la rose et de son parfum ?
R.B. - On la rencontre tous les jours, la rose, on la rencontre tous les jours. Il faut la chercher, on peut la rencontrer...
J.C. - C'est la Toison d'or, c'est quoi ?
R.B. - Non, non, c'est le bonheur qui est là, c'est le bonheur qui est là... et qu'on laisse passer. Le bonheur ce n'est pas... J'ai reçu de deux lycéennes, il y a deux semaines, une carte pleine de gentillesse, et cette carte avait une devise, au recto : « Le bonheur, ce n'est pas le but du voyage, c'est la façon de voyager » Et je trouve ça merveilleux que des gamines m'aient trouvé... m'aient envoyé ça.
J.C. - La façon de voyager...
R.B. - Oui, la façon de voyager. Ça [ne] veut pas dire voyager en sleeping ou en wagon à bestiaux, ça veut dire, simplement, voyager en regardant le paysage et en jouissant du chemin, au lieu de courir, de galoper, ou de s'ennuyer...
J.C. - « Allez au Paradis, la porte elle est ouverte depuis hier à midi »...
R.B. - Oui, c'est une vieille chanson, je voulais prendre ça comme titre, et puis finalement j'ai trouvé que c'était un peu long ; mais le Paradis est là, il faut ouvrir la porte.
J.C. - Merci René Barjavel.
Notes
Les index correspondent aux notes de renvoi dans le texte. Elles visent à compléter et clarifier des "allusions" qui pourraient, avec le recul "historique", paraître aujourd'hui obscures.
Notes éditoriales
La présente page a été créée en octobre 2004 et présentée par la Lettre de G.M.Loup de cette date.
Cette émission Radioscopie avec René Barjavel est aussi mentionnée sur la page de transcription du Moulin Littéraire des Journées Barjavel 2004 à Nyons, où l'on peut en écouter un extrait sonore.