La journée Barjavel à Nyons le 22 août 2004
Le MOULIN LITTÉRAIRE
et la présentation de P.CREVEUIL :

|
Cet exposé est celui présenté dans le cadre du moulin littéraire animant la journée Barjavel du 22 août 2004 à Nyons (voir la présentation).
Animé par Pierre Creveuil, co-auteur du barjaweb et président de l'Association des Amis de René Barjavel [ http://association.barjavel.free.fr ], Le texte ci-après en est la transcription adaptée pour le barjaweb et complétée de
développements, références et bibliographie. De plus, des contacts noués à l'occasion de ces Journées ont permis de
compléter utilement certains aspects par l'apport de témoignages directs.
(de g. à dr. : Mme Marie-José Bouchet, MM. Gérard Bouchet et Pierre Creveuil
Cette version imprimée de la retranscription du Moulin Littéraire du 22 août ne permettra pas bien sûr de rendre les animations interactives offertes par la page Internet, ainsi que les documents sonores qui ont été proposés au public au pied du Pont Roman, devant le Moulin Dozol-Autrand. Apparaissent également sur la présente page des liens soulignés vers de nombreuses pages de compléments, qui n'ont bien sûr d'effet que lors de la consultation du site barjaweb.
|
 | Mais écoutons ce qu'il nous en dit lui-même en 1977. |
J'ai écrit une vingtaine de livres, mais ma première activité d'écrivain était celle de journaliste.
J'avais dix-neuf ans, je sortais... j'étais sorti à dix-sept ans du collège comme on sort du couvent, c'est à dire j'étais bon à rien, j'avais fait divers métiers bizarres, et un jour j'ai eu la chance extraordinaire de trouver une place dans un petit journal quotidien de Moulins, ça s'appelait "Le Progrès de l'Allier", on tirait à dix-mille exemplaires, mais on tirait tous les jours.
Et j'ai, dès le premier jour, écrit une chronique, un billet du matin, ça s'appelait un "billet du matin", par souci d'avoir un contact avec les lecteurs, de leur raconter des choses.
Et puis j'ai continué, enfin je continue encore aujourd'hui.
Au cours de nombreuses autres interviews il reviendra sur son goût pour ce métier et sur ce qu'il lui a apporté :
Le plus beau des métiers du monde ! Je l'ai appris sur le tas, à une époque où les techniques modernes de compositions n'avaient pas encore pris le pas sur l'artisanat. Mes chroniques étaient lues par des clients fidèles qui n'imaginaient pas que je n'avais que dix-huit ans.
et qu'il analysera en détail dans une de ses chroniques au Journal du Dimanche, le 17 Juin 1973 (Être journaliste,
qu'est-ce que c'est ?) - nous y reviendrons.
Comme je l'ai dit, il l'a exercé, pas forcément avec régularité, à travers des périodes marquantes du vingtième siècle.
Et c'est au fil de ses propres écrits que je vous propose de parcourir d'abord chronologiquement les riches facettes de son activité, illustrées par
un choix d'extraits de textes.
12 juillet 1930 : à en croire l'auteur ce fut l'un des jours les plus marquants de sa vie. Cinquante ans plus tard il en témoignait dans un magazine bien féminin, Modes et Travaux (n°959 d'octobre 1980), qui publiait à l'initiative de l'Académicien Paul Guth une série de confidences de personnalités à propos de leur "première fois"... Alors que d'autres y mettaient en avant leurs premières fois en tous genres..., pour lui :
 |
Ce jour là, pour la première fois, je vis ma prose imprimée...
Trente lignes en italique, à la deuxième page du Progrès de l'Allier. Cela s'intitulait « Billet du Matin ». J'avais dix-neuf ans.
|
C'était l'aboutissement d'un long chemin commencé à Tarendol, le hameau de mes ancêtres, au sud-est de la Drôme, pays superbe, terre pauvre sur laquelle, depuis des siècles, quelques familles subsistaient à la limite extrême de la misère.
Pourtant ces débuts sont anonymes : ses premiers Billets du matin ne sont pas signés, et se fondent parmi
divers articles d'informations purement locales qui constituent la base des pages centrales du journal... et dont il est
aussi le plus souvent le rédacteur, car l'équipe du Progrès de l'Allier ne compte en fait que deux ou trois personnes...
Mais il y aborde ces questions très locales avec des pointes d'humour - ou d'humeur - qui ne le quitteront plus...
Quelques exemples : le prix des volailles au Marché Couvert, le soleil, la pluie, les courses, l'entretien des
rues (qui laissait sérieusement à désirer...), l'atmosphère de la bonne ville de Moulins qui l'accueille mais qui lui donne
souvent la nostalgie des bords de l'Eygues, ce qu'il exprime parfois, comme dans ces articles publiés
24 octobre 1930 et
le 6 avril 1934,
ce dernier au retour d'un court séjour à Nyons :
Je viens de passer dans une petite ville de ma chère Provence quelques jours parfumés par les premières fleurs du printemps, fleurs d'amandiers et de pêchers, fleurs plus humbles des bords des ruisseaux.
Un tortillard paresseux comme un vrai méridional relie la petite ville au reste du monde. Il court dans les descentes comme un gosse qui dévale un talus, avec une joie étonnée de se voir aller si vite. Aux montées, il souffle comme un vieux qui grimpe un escalier et les voyageurs interpellent les gens qui travaillent dans leurs champs, le long de la voie.
[...] Il est même des gens qui n'ont jamais entendu parler de Stavisky ou de Prince.
On se soucie, mon Dieu, surtout de la vie quotidienne, de la santé des siens, et de savoir si on aura une bonne récolte d'olives et de lavande.
En vérité, c'est un pays où règne la sagesse.
Et rapidement se nouent avec ses lecteurs des échanges épistolaires (et sans doute aussi directs, Moulins étant quand même, comme Nyons, une « petite » ville où les gens se connaissent). C'est ainsi que le 15 octobre 1930 il est amené à abandonner l'anonymat, et pour la première fois son nom apparaît imprimé à la fin d'un article. Il s'en explique en post-scriptum de son billet de ce jour-là :
Pour éviter que certaines personnes, s'y croyant autorisées par leur anonymat, ne répondent aux « Billets du matin » par des lettres non signées, j'écrirai désormais, au bas de mes articles, mon nom en toutes lettres.
Les cinq années suivantes vont le voir écrire plusieurs centaines de ces "chroniques" qui deviendront
« À ma Fantaisie » en 1933, puis sans titre générique lorsque Barjavel se sera installé à Vichy où le
journal a aussi un bureau. On peut penser qu'à côté de ces articles signés et authentiquement barjavéliens, un bon nombre
de textes informatifs ou de commentaires d'actualité portent aussi la griffe de notre auteur malgré leur total anonymat.
Mais l'auteur lui-même l'a confirmé à plusieurs occasions dans diverses interviews.
D'abord les faits divers les plus obscurs, les rubriques "épaves" (on dirait maintenant "objets trouvés"...) que
l'on n'imaginerait même plus à présent :
Il a été trouvé, devant l'épicerie de Mme Dublin, un gant de filoselle de la main gauche : prière de le réclamer à la mairie.
On voit qu'il n'y a pas un mot de trop ! Concision et limpidité voulues et nécessaires, et qui marqueront sans doute son style ultérieur...
Citons aussi, pêle-mêle : comptes-rendus de distribution des prix des collèges, avis de contraventions à l'encontre de
cyclistes irrespectueux du code de la route, de réunions d'associations diverses, cours des denrées agricoles...
{ voir d'autres exemples... }
Ses articles eux-mêmes le montrent s'essayer en quelque sorte à de nombreux "genres littéraires" : aux simples
chroniques - non pas villageoises mais presque - qui ont une saveur de rédactions de bon élève, appliqué et
conciliant à ses débuts, vont succéder des textes offrant une palette de styles, d'esprits et de formes particulièrement
variés et sur une gamme de thèmes fort large.
Ainsi aux récurrentes considérations sur la propreté des places et des rues, l'augmentation des prix, la passion du
public pour les sports, s'ajoutent des chroniques pertinentes de la vie courante, des événements culturels et des nouvelles
techniques qui, petit à petit, se mettent à transformer le quotidien.
Avec l'assurance vont venir des commentaires de faits divers (parfois scabreux), d'événements internationaux et les
évocations de personnages publics maintenant sombrés dans l'oubli et qui, sous sa plume, redeviennent vivants et presque
actuels... (qui se souvient de Philibert Besson ? et pourtant... ce fut un précurseur...)
On notera cependant - et ce point restera une constante tout au long de sa carrière au point d'en devenir un
parti-pris - un détachement flagrant des affaires politiques : point de polémique, tout au plus des allusions un peu
ironiques (et cela même par exemple au début de 1934, alors que l'Affaire Stavisky occupe le devant de l'actualité
nationale). Le jeune journaliste laisse donc au directeur du journal le soin de politiser, et en reste pour sa part aux
scènes de la vie quotidienne qui lui fournissent, et lui fourniront toute sa vie, ample matière à réflexion et
émerveillement.
Le journalisme de Barjavel n'est pas celui d'un reporter : il n'est ni Albert Londres, ni même Tintin...
Lorsqu'il rapporte un événement, décrit une situation, on en perçoit déjà surtout le commentaire (oserait-on dire "la Moralité" ?)
au travers de la description des faits. Pourtant le jeune homme est loin d'être un journaliste en chambre : il va au
devant des événements, voyage à travers le département sur les petites lignes de chemin de fer, désaffectées de nos jours,
qui sont alors fort utiles et constituent parfois elles-mêmes l'objet de sa chronique, assiste aux foires, marchés,
expositions, spectacles en tous genres, matches, conférences, et il va en interviewer les participants.
Parmi d'autres exemples, citons les interviews d'Alex Taitard (beau-père et entraineur du champion de boxe Marcel Thil),
d'Azaïs (directeur du théâtre du Petit Casino), de René-Louis Doyon (fondateur de la revue et des éditions La Connaissance,
écrivain et érudit humaniste pour qui travailla le jeune André Malraux), et bien sûr de Robert Denoël fin août 1935.
Là encore, à une concise présentation des faits et des gens se superpose toujours l'évocation de l'ambiance
personnelle qu'il en ressent. Mais sans pour autant relever strictement du "journalisme d'opinion" : loin de là,
à cette époque tout au moins, car on serait parfois bien en peine de définir clairement ce qu'en pense l'auteur. Sa
voix - ou voie - reste déjà celle du Milieu, diplomatique, tolérante mais sans laxisme. Ainsi d'une série
d'échanges avec ses lecteurs (assez longue à retranscrire...) sur le thème "Est-ce à l'homme où à la femme qu'il appartient
de faire la vaisselle ?" on peut retenir que... "chaque couple fait comme il l'entend, pourvu qu'il soit content..."
Et ce n'est pas un hasard si, au milieu de ces chroniques, on fait la découverte de petits joyaux que sont, dès 1930,
des contes, des nouvelles, et même, le 13 janvier 1931, un texte, non pas de science-fiction puisque le mot n'existait pas encore,
mais bel et bien d'anticipation ! L'auteur y présente Moulins vu rétrospectivement en 2169 (lire l'article).
J'ai entrepris depuis plusieurs mois la "recollection" de l'intégralité de ces articles, d'abord par intérêt ponctuel lors de la préparation approfondie de certaines pages du barjaweb (la page "écrit" de Colette à la recherche de l'amour en particulier), et le charme de ces textes ainsi que leur intérêt littéraire essentiel pour l'analyse un tant soit peu poussée de la genèse de l'œuvre et de la pensée de l'auteur, m'ont convaincu de l'utilité de viser l'exhaustivité ; tâche quasi-monastique, et dont le rythme hélas trop lent compte-tenu du temps que je peux y consacrer, demandera plusieurs années... Je pourrais donc parler de ce "projet" plus en détail avec les éventuelles personnes intéressées après cette causerie, autour d'un rafraîchissement ou d'un verre d'huile d'olive...
Ce sont donc la jeunesse et le mûrissement de Barjavel qui se déroulent sur le papier maintenant fragile et jauni de
ces cinq années, avec une interruption partielle en 1931 par une période que le marquera profondément : le service
militaire. Apparement sa prose journalistique d'alors ne s'en ressent pratiquement pas, mais on sait que ses idées sur
la question en garderont une trace profonde, et que le roman qu'il écrivit peu après, François le Fayot - et qui
a fini au feu - en a été la réaction ; il en restera quelques scènes qui seront incorporées dans Tarendol.


 1935 : Paris, me voilà !
1935 : Paris, me voilà ! 


On sait que c'est le 25 octobre 1935 qu'il quitte Vichy pour rejoindre Robert Denoël à Paris. Là, son activité est plus "technique" : rédacteur d'une publication éditée par Denoël, Le Document, il prend aussi en charge diverses activités de l'imprimerie et en devient « chef de fabrication ».
- Cette revue s'appelait Le Document. C'était une sorte de Paris-Match mais mensuel et, chaque fois, un seul sujet y était traité : le Pape, le Front commun, etc. Une bonne formule pour le public, mais qui a été catastrophique pour Denoël. Je me suis alors occupé de la fabrication des livres. J'ai achevé d'apprendre mon métier d'imprimeur, la technique de l'offset, de l'héliogravure, puis, peu à peu, je suis devenu chef de fabrication. Je connaissais tous les papiers, tous les formats, tous les caractères.
Mais Denoël, esprit brillant, a pour son personnel une grande lacune : il paye... parfois ; d'autres auteurs, dont L.-F. Céline, se plaindront aussi de sa "pingrerie". Barjavel, qui a pu grâce à Denoël et d'autres amis s'introduire dans le mode de l"écrit", va alors collaborer à divers journaux, essentiellement comme critique cinématographique.
Tout d'abord au Merle Blanc, journal satirique mais politiquement plutôt neutre, fondé en mai 1919
et dirigé par Eugène Merle, également propriétaire d'autres journaux (Frou-frou et Paris-Soir).
Ce journal avait pris le titre d'un conte théatral d'Alfred de Musset (1842 : Histoire d'un merle blanc, parodie
cocasse de la Confession d'un enfant du siècle), et, du 17 octobre 1925 au 15 janvier 1927, il avait "absorbé" un autre
journal satirique, L'Assiette au beurre, ainsi que Le Loup-garou.
Dans les années 1930 sa parution est hebdomadaire, le samedi, d'où sa devise :

Eugène Merle meurt en 1939 et le jour de parution de son journal change et son titre devient

La participation de Barjavel à ce journal commence en octobre 1936, année de son mariage avec Madeleine de Wattripont
dont il avait fait la connaissance aux Éditions Denoël.
Auparavant, Le Merle blanc proposait - en 1935 - une petite chronique de cinéma tenue par "Médisande",
puis par Michel Duran jusqu'au 16 juin 1936. Elle fut remplacée pendant l'été 1936 par une rubrique T.S.F signée de "Lucrèce
Ex-Borgia", jusqu'au 17 octobre 1936.
C'est le 31 octobre qu'est publié le premier article signé G.M.Loup (Grand Méchant Loup), pseudonyme utilisé
par Barjavel pour ses avis sur les films que cette activité l'oblige à voir et à y passer donc toutes ses soirées.
Ces critiques qui se veulent "sans concession" sont parfois mordantes, car prennent l'allure de conseils parfois
sarcastiques :
Si vous êtes bien disposé, pas trop difficile, vous pouvez à la rigueur essayer d'aller rire avec...
Si vous avez un copain qui vous a fait une crasse, vengez-vous en lui conseillant vivement d'aller voir...
qui n'empêchent pas les avis enthousiastes, bien au contraire :
[...] un film exceptionnel, poignant, humain, tragique, fraternel. Un film à voir, à revoir. Et à ne pas oublier.
Tout en s'amusant à incorporer le titre du film dans l'épigramme de sa critique (comme il intègrera les titres de ses romans dans ses (envois et dédicaces...) :
Nous vous conseillons très vivement de ne pas répondre à L'appel de la vie
Vous pouvez, à la rigueur, si vous n'avez rien d'autre à faire, vous laisser entraîner à une petite excursion Sur
les toits de New-York
Si vous ne savez que faire de vos dimanches, une aimable compagnie vous invite à aller passer un Week end
mouvementé
Mais il abandonne rapidement ce pseudonyme lycanthropique pour signer de son vrai nom à partir du 30 octobre 1937 une
rubrique similaire mais présentée différement - marketing oblige ! (l'apparition de cette nouvelle formule fut d'ailleurs
précédée le 2 octobre 1937 d'une annonce : « Samedi prochain : RENE BARJAVEL »...)
On peut donc voir qu'entre le numéro 135 du 30 octobre 1936 et le numéro 180 du 11 septembre 1937 ce sont en tout
trente-sept articles qui portent la signature de G.M.Loup, bien moins que ce que les auteurs du barjaweb,
qui ont respectueusement adopté ce pseudonyme collectif, ont élaboré depuis maintenant quatre ans et demi...
En novembre 1937 il formalise quantitativement son évaluation des films au moyen d'un dessin de thermomètre, affichant la "température des films", dont les graduations numériques et fantaisistes sont, elles aussi, sans concession...




Décembre 1937 le voit prendre dans Le Merle Blanc une rubrique de portraits d'acteurs et personnalités du Cinéma.
Un texte, sur deux colonnes, s'accompagne d'une caricature par un dessinateur du journal (successivement Moisan, Pierre Devaux,
Jan Mara, Remo et Bim). Des vedettes maintenant oubliées y côtoient Marylin Monroe, Arletty, et la jeune première Danielle
Darrieux, ce qui, rétrospectivement, ne manque pas de piquant...
En plus de ces caricatures "nominatives" la même rubrique va aussi, à partir de 1939, comporter ponctuellement des
chroniques plus générales, prenant comme point de départ un film à l'affiche pour se développer en considérations sur
l'Homme, la Société et d'une manière générale les sujets qui furent ceux des Billets du matin et qui seront
trente ans plus tard ceux de ses chroniques au Journal du Dimanche. Mais n'anticipons pas !
J'ai répertorié l'intégralité de ces articles au Merle (Blanc)
{ voir la liste de ces articles }
et je dispose maintenant de la grande majorité de ceux-ci.
Dans un domaine plus littéraire, et dans des circonstances assez mal documentées, Barjavel se lance dans l'aventure de la
création de revue. Il fonde en 1937 La Nouvelle Saison avec Jean Anouilh, Jean De Beer, Jean-Louis Barrault, André Frank et le compositeur André Jolivet.
Sept numéros de la revue paraîtront de novembre 1937 à juillet 1939, et Barjavel y publiera un texte romancé, chapitre
d'un roman "en préparation", L'Apprenti, qui ne verra jamais le jour. Le passage en question, racontant l'expédition
nocturne de jeunes gens allant chaparder des fraises dans le jardin du collège, se retrouvera pratiquement tel quel dans Tarendol (la vision finale en moins cependant).
Il y publiera aussi, dans le n°2 de février 1938, une étude sur Luc Dietrich accompagnant un texte de celui-ci,
"Un Dimanche à Clamart". Mais cela nous éloigne du journalisme proprement dit...
Certaines biographies succintes indiquent également une collaboration de Barjavel à l'hebdomadaire Gringoire, "parisien, politique et littéraire" dirigé par Horace de Carbuccia. À de nombreux articles de teneur politique nettement "à droite" s'ajoutait la parution en épisodes de romans alors inédits d'auteurs devenus célèbres, tels que : François Mauriac (L'Âge d'Or), Colette (le début du Blé en herbe), Joseph Kessel (La Passante du Sans-Souci), Eugène Dabit (Les Deux Soeurs), Jack London (Adieu, Jack !, traduit par Louis Postif), Daniel Rops).

Cependant, on n'y retrouve nulle part sa signature, mais uniquement, de septembre 1935 à août 1939, une série d'articles de
critiques cinématographiques sous le titre « Pall-Mall Films » signés d'un certain René Bard.
On peut en inférer se trouver là en présence de ses écrits, l'esprit et le style de ceux-ci ne l'excluant pas. Mais la certitude fait défaut, jusqu'à confirmation que pourrait fournir un témoignage direct... |
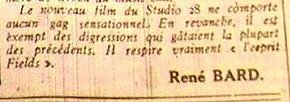 |
Dans cette hypothèse de "paternité", on peut constater que la tonalité des critiques penche dans le sens de l'esprit
du journal, avec modération cependant. Curieusement, rarissimes sont les films critiqués à la fois dans Le
Merle Blanc et dans Gringoire. Pour ces cas ponctuels, on se trouve bien en présence de deux textes différents.
Si cette collaboration à Gringoire a parfois été "reprochée" à Barjavel, par extrapolation des affinités politiques
du journal et de certaines de ses articles à notre auteur, un examen plus réfléchi montre bien l'injustification de ces
"reproches" : les articles de René Bard se cantonnent strictement à des critiques de films, sans avis franchement "politiques",
et bien d'autres auteurs d'alors ont écrit dans ce journal comme on l'a vu.
L'activité journalistique de Barjavel cesse brusquement le 1er septembre 1939 avec la mobilisation générale.
Ce jour-là, son { dernier article } au Merle, « Derniers soupirs », est inquiet et prémonitoire.
Sa { mise en page } laisse penser que la censure a pu y faire des coupes importantes...

 LES ANNÉES NOIRES
LES ANNÉES NOIRES 

On sait que Barjavel fut mobilisé comme caporal d'ordinaire, autrement dit "chef cuistot". En mai 1940, la défaite le conduit à se replier plus ou moins erratiquement dans le Languedoc, habitant un temps à Palavas les Flots, en repassant par Cusset. C'est là que son activité de journaliste reprend avec une remarquable vigueur puisqu'il s'associe à quelques amis pour fonder un journal, L'Écho des étudiants.

Ce journal était créé avec le soutien matériel d'un éditeur-imprimeur de Montpellier, Eugène Causse, qui
possédait le seul quotidien de France, et sans doute du monde, consacré au vin, « La Journée vinicole » II éditait aussi un tout petit journal, « L'école étudiante » et souhaitait qu'il devienne l'organe de presse de tous les étudiants de la zone libre. Il me l'a confié. Je ne restais que quelques mois mais ce fut formidable. J'ai fait débuter ainsi des hommes de grand talent : Jacques Laurent, François Chalais, Yvan Christ, Raymond Castans...
À cette équipe il convient d'ajouter Henri-François Rey, et surtout son ami Jean Renon, qui était témoin à son mariage et qui
avait épousé l'amie de jeunesse cussetoise de Barjavel, Edmée-Flavie Pérard dite Polaire, et qui lui resteront toujours très
proches (voir ma lettre d'avril 2004 qui recueille les
témoignages chaleureux de Catherine, la fille de Jean et Edmée Renon).
Édité et imprimé à Montpellier, en zone libre, la rédaction du journal a aussi ses bases à Cusset, près de Vichy. Il
ne faut pas voir là une quelconque allégeance au régime qui s'est installé à l'Hôtel du Parc, mais un retour de
l'auteur en cette terre Bourbonnaise où sont ancrées ses racines littéraires et amicales. La transmission des textes à
Montpellier reste un peu mystérieuse ; j'ai pu recueillir les témoignages de Madame Catherine Renon mais... elle
n'était pas encore née et n'en a donc que les souvenirs de ses parents maintenant décédés.
Conjointement, nous tentons de remettre la main sur des exemplaires de cette publication, sans grand succès jusqu'à
présent : un seul fascicule a été trouvé, sous forme de facsimile dans une publication universitaire
britannique , et il permet mal de se faire une idée précise de cette
période de la vie journalistique de l'auteur.
En 1942, Barjavel confie la direction de journal à Jean Renon et revient à Paris : R. Denoël, qui était, rappelons-le, Belge, a été démobilisé, et a
rouvert sa maison d'édition, sous le contrôle de l'occupant. Durant cette période Barjavel ne publie pas d'article dans
la Presse. Son activité est celle de chef de fabrication chez Denoël le jour, et écrivain au petit matin, puisque c'est
entre 4 et 6 heures du matin qu'il écrit Ravage et Le Voyageur Imprudent.
|
À ce point il est indispensable de faire la lumière sur une activité de Barjavel durant cette période sombre, qui lui a
valu des reproches encore parfois évoqués de nos jours : les publications dans |  |
Ces textes sont très précisément les trois nouvelles Les Mains d'Anicette, La fée et le soldat et Péniche (1943),
puis, à partir de mars 1944, son roman Le Voyageur imprudent, publié en feuilleton chapitre par chapitre, avant la
parution du livre aux éditions Denoël. Mais, à part ces œuvres purement littéraires, et qui ont été largement
On ne trouve, en date du 12 mars 1943, que son interview par Henri Poulain à l'occasion de la parution de Ravage
{ voir l'article },
interview subtilement manipulée où H. Poulain fait dire à Barjavel à peu près ce qu'il veut, par l'emploi de citations
fragmentaires et anecdotiques. Il y a donc lieu de... prononcer un non-lieu, ce que fit la Commision d'Épuration du C.N.E
(Comité National des Écrivans) en 1945 lorsque son nom fut retiré de la première liste noire. D'ailleurs les raisons
de sa "mise en examen" ne portaient pas tant sur ses écrits dans Je Suis Partout que sur la publication de
l'Écho des Étudiants qui bénéficiait de l'accord des autorités d'occupation.


 L'APRÈS GUERRE
L'APRÈS GUERRE 


Après la fin de la guerre, Barjavel est déjà un romancier. Ravage, porté en 1942 par une publicité qu'il ne demandait peut-être pas, a été un grand succès. Le Voyageur imprudent l'a suivi, et, reprenant ses projets romanesques d'avant-guerre (François le Fayot, détruit, et L'Apprenti, resté à l'état embryonaire), Tarendol paraît en 1946.
À côté de ces succès d'édition, il redémarre ses activités journalistiques :
Il reprend la plume dans Le Merle, qui reparaît après 1946, tout d'abord avec la "chronique de l'oiseau rare" (sur la Paix) dans un numéro spécial au printemps 1947 { lire cet article }, et des articles prenant comme point de départ le cinéma pour s'étendre à des thèmes plus généraux. { voir la liste de ces articles }

Divers magazines, à l'existence éphémère après la fin de la guerre, vont publier des articles ou récits que l'on aurait pu craindre de voir tomber dans l'oubli mais qui ont pu être soigneusement archivés sur le barjaweb :
- Dans Le Magazine de France, il présente à l'occasion d'un numéro spécial sur le cinquantenaire du cinéma sa vision du futur du 7ème art, dans un article qui mêle journalisme et science-fiction, Le Cinéma dans la Lune (lire cet article)
- Dans Vérités sur le cinéma français, il profite du même contexte pour faire preuve aussi d'anticipation
particulièrement lucide (lire cet article)
Il rejoint aussi l'équipe de critiques de films dans Paris-cinéma - organe libre du cinéma français, magazine hebdomadaire
(dirigé par C.A.Morsko) de grand format qui paraît pendant un an et demi
{ voir la liste des films critiqués }







À partir de 1948, il collabore assez régulièrement à l'hebdomadaire Carrefour,
où il tient la rubrique de critique de théâtre, ce qui l'oblige tous les soirs à voir les spectacles, activité qui épuisera sa santé
devenue fragile pendant la guerre. Ces critiques, au nombre d'une centaine, sont pleines de finesse et souvent
acidulées... Barjavel ne mâchent pas ses mots, et lorsqu'un spectacle ne lui a pas plu, il l'indique clairement et de
façon argumentée, tout en rendant justice aux acteurs ou metteurs en scène lorsqu'ils ont fait de leur mieux dans
l'interprétation d'une pièce "ingrate".
{ voir la liste de ces critiques }
Il y écrit aussi occasionnellement d'excellentes chroniques { voir la liste de ces chroniques }, parfois à la Une, et plutôt "en phase" avec les préoccupations de Société d'alors,
et qui seront en partie la matière de son Journal d'un homme simple qui refait vivre cette période de sa vie et de l'histoire de la
France (voir la page "écrit" qui présente cette œuvre).

|
Obligé de prendre du repos en octobre 1950, il s'installe à Sospel (06), mais il continuera son activité en anticipant le
télétravail puisque la direction de Carrefour lui confie une rubrique d'un genre bien oublié, la critique
d'émissions radiophoniques, qu'il démarre en juillet 1951 avec un savoureux commentaire du Tour de France.
{ voir la liste de ces critiques } |

|
La maladie qui l'a frappé en 1950 est finalement un obstacle sérieux pour la continuation de ses activités
journalistiques. On sait qu'il entreprend alors une toute autre carrière, celle de scénariste et dialoguiste, en
collaboration avec Julien Duvivier pour la "série" des Don Camillo, dont le succès le surprendra lui-même. Ses
activités directement liées à la création cinématographique vont donc sembler l'éloigner pendant quelques années du monde
de la Presse, mais, en cherchant bien, il semble qu'il ait aussi publié quelques articles pendant cette période.
 
   
|
Au début des années 1960, on peut considérer qu'il s'est "fait un nom" dans le monde des Arts et des Lettres, tant comme écrivain que chroniqueur, scénariste et critique. Il va collaborer aux Nouvelles Littéraires - Arts, sciences et spectacles, hebdomadaire créé dans les années 30 et alors dirigé par A. Gillon, A. Bourrin et G. Charensol, où l'on trouvera les plus savoureux de ses articles, prenant des formes d'auto-interviews ou de chroniques :
- Le 11 octobre 1962, sa première (auto-interview) à propos de la science-fiction, "genre" littéraire avec lequel il venait de renouveler en publiant Colomb de la Lune qui avait obtenu cette année-là le Prix Alphone Allais.
- L'exploration spatiale, qui a vu les Américains lancer à l'automne 1962 une sonde vers Vénus, lui inspire le jour où elle s'en approche, des réflexions sur l'Homme et l'Espace dans « Vénus et les enfants des hommes » (le 11 décembre 1962) (lire l'article)
- Dans le numéro 1951 du 21 janvier 1965, il donne son avis de téléspectateur sur la télévision dont l'essor en France commence à être significatif : « Nounours, Rocambole et De Gaulle vedettes du petit écran ». Si la forme de l'article semble être un entretien à deux voix, là encore il y a tout lieu de croire que Barjavel en est entièrement l'auteur. (lire l'article)
- Dans le numéro 2154 du 2 janvier 1969, au lendemain du retour de la première mission lunaire ayant orbité autour de la Lune, il fait part de sa pensée sur la destinée humaine et le soi-disant "pessimisme" qui lui est parfois reproché, dans l'article « Le poisson, l'homme et les étoiles » (lire l'article).
   |
|   
|
C'est en 1969 qu'un tournant de sa vie le voit entreprendre une grande carrière de chroniqueur au Journal du Dimanche. Ce qui semble bien avoir été une crise personnelle, à différents points de vue, a été suivi d'un rebondissement de son activité littéraire lors de la collaboration avec André Cayatte au scénario d'un film qui ne sera jamais tourné, La Nuit des temps, et qui devint le roman que l'on connait (voir la page qui préeente cette œuvre). Son statut de "nouvel auteur à succès ayant déjà fait preuve d'une expérience dans l'audiovisuel" lui vaut d'être invité par le Journal du Dimanche soir, alors dirigé par René Maine, à tenir une rubrique hebdomadaire de critique des programmes de télévision. C'est ainsi que démarre, le 26 janvier 1969, « MOI, TÉLÉSPECTATEUR », qui se transformera au fil des mois et des années pour devenir, à partir de septembre 1970, « René Barjavel vous fait part de ses réflexions en regardant la TV », puis « René Barjavel vous fait part de ses réflexions devant son poste » au printemps 1971.
Dès 1972, l'importance littéraire de ces centaines de chroniques n'a pas échappé à l'auteur et à son éditeur du moment. Il a supervisé leur compilation dans une suite de trois recueils, Les Années de la Lune (1969-1971), les Années de
la Liberté (1972-1973) et les Années de l'Homme (1974-1975). Son rôle dans ces éditions été non seulement de "choisir"
les textes - car ces recueils, malheureusement pour nous, ne contiennent pas TOUTES les chroniques parues sur cette
période - mais aussi de les adapter. Certains articles ne sont en effet retranscrits que partiellement, les parties trop
liées à l'activité du moment (ou, dans le cas des critiques de télévision, aux émissions qui sont rapidement peut-être
tombées dans l'oubli...), ou avec de petites modifications de style qui, d'un strict point de vue littéraire, se comprennent,
mais font un peu perdre de la saveur et surtout du piquant à ces textes.
Rapidement d'ailleurs, l'auteur s'échappe du cadre strict des considérations télévisuelles pour émettre des avis
sur bien d'autres sujets. Ce penchant lui est bien connu, et l'Humanisme de Térence est aussi le sien :
Homo sum, humani nihil a me alienum puto...
En 1971 déjà, il aborde ainsi des questions de Société dont certes la Télévision se fait aussi l'écho
(timidement car l'époque est pour le moins "pudique"), mais qu'il développe de SON point de vue :
éducation sexuelle (sujet qui faisait naître alors de nombreuses polémiques), travail des femmes, contraception,
avortement, aides contre la faim, sécurité routière...
Il profitera de la "tribune" que lui offre le journal pour interroger directement les lecteurs, par le moyens de
sondages ou questionnaires, dont il commente dans les numéros suivants les nombreuses réponses qui lui ont été
adressées (janvier 1973 Que répondre aux filles ? - avril 1973 : René Barjavel vous pose dix
questions sur l'avortement.). On voit que depuis Le Progrès de l'Allier le parti pris de "dialogue avec les lecteurs"
(on dirait aujourd'hui l'"interactivité"...) est resté intact, et a même évolué du public d'une petite ville de
province à un auditoire national et même bien au-delà, car Barjavel journaliste était aussi lu en Belgique et
d'autres pays francophones.
Il obtint le Prix de la Chronique Parisienne pour la presse “écrite” en 1973 (Léon Zitrone
recevant celui de la presse “parlée”), comme il le rappelle dans son article du 17 juin, faisant remarquer que ni Zitrone ni lui ne sont à proprement parler “parisiens”...
Au printemps 1974, sa chronique prend le titre générique de Dimanche avec René Barjavel, pour devenir le 12 mai les Libres propos, titre qui est semble-t-il le plus célèbre... En 1980, paraphrasant Victor Hugo, elle s'intitulera Les choses vues de René Barjavel, dans une page regroupant les signatures de plusieurs personnalités (Yvan Levaï, Jean Charlot...). C'est au printemps 1981 que cette activité, dont l'auteur avait en fait déjà quelque peu ralenti le rythme, prend fin sans préavis, puisqu'après la "recette de vie" fournie le 4 janvier (lire cet article), le dernier article du 15 mars (lire) montre René Barjavel toujours en verve et enthousiaste, dans une actualité nationale toutefois à la veille d'un basculement politique et social... Peut-être l'enthousiasme de la direction du journal pour la collaboration de Barjavel a-t-il été refroidi par son article du 20 avril, à propos de la mort de Jean-Paul Sartre... Article qui lui fut reproché avec une véhémence frisant la grossièreté à Nyons même par un journaliste et éditeur local, selon la méthode de citations partielles... Pourtant sa lecture complète permet de s'en faire une idée juste, et ne dit-il pas, à propos de Sartre :
Il était la générosité totale. Il s'est battu tout sa vie pour les deshérités et les victimes, toujours au premier rang du combat. Et souvent, derrière ce premier rang il n'y en avait pas d'autre. Penseur discutable, il fut un homme exemplaire.
Cette fin de sa longue carrière journalistique fut en fait bien consciemment vécue par l'auteur, qui témoignait dans une correspondance privée en août 1981 :
Dans le journalisme, au contraire [du métier de romancier], on n'en finit pas de s'user pour rien. Je viens, avec un immense soulagement, de mettre fin à cette part de mon activité que je pratiquais depuis plus d'un ½ siècle ! J'ai 3 livres sur le chantier...
Enfin, et en plus de ces contributions rédactionnelles, il faut aussi signaler une fois encore une entreprise éditoriale, avec le lancement en 1976 de la revue Ciné-Magazine avec son ami Paul Maury ; initative peu remarquée, et qui ne durera pas plus de six numéros, essentiellement à cause de la concurrence dans le même temps de la jeune revue Première qui collait sans doute plus aux attentes de l'époque à venir et bénéficiait d'un marketing plus agressif. Ce fut cependant pour Barjavel l'occasion de revoir publié, chapitre par chapitre, le début de son essai Cinéma Total accompagné, trente-deux ans après, de ses propres commentaires sur ce qu'était devenu le cinéma en regard de ses "prédictions" fort lucides de 1944.
À côté de cette riche activité de journaliste "de plume", les années 70 gardent le souvenir d'un chroniqueur radiophonique et de télévision. Mais ces souvenirs ont bien moins laissé de traces tangibles, et d'imporantes recherches restent à mener pour en retrouver des éléments concrets, car l'archivage des documents audiovisuels n'était alors que très fragmentaire. On peut cependant indiquer que Barjavel tenait sur Radio-Luxembourg (station "périphérique" devenue RTL) une chronique régulière (peut-être quotidienne, et semble-t-il le matin). Je n'ai pu retrouver que son commentaire enthousiaste et poétique du premier vol habité autour de la Lune le 22 décembre 1968 .
Elle était là, fripée, mal fardée, chancelante, folle d'envie de se montrer, et n'osant pas. Elle était là, sublime, ridicule, bouleversante, notre mère, la Terre... |
Il faisait aussi de fréquentes apparitions à la télévision... Au point d'agacer certains de ses confrères ès science-fiction (qui n'apprécient pas trop le mélange des genres...), tel Alain Dorémieux, rédacteur en chef de la revue Fiction, qui, critiquant Le Grand Secret sous le pseudonyme de Serge-André Bertrand dans le numéro 236 d'août 1973 de cette revue (lire cette critique), larmoyait :
Et puis... et puis Barjavel s'est lentement transformé en ce qu'il est devenu aujourd'hui. D'une part : un journaliste à tout faire qui parle de tout et de rien sans jamais être au courant du fond du problème, et dont on voit à tout bout de champ la tête de chien battu à la télévision chaque fois qu'il s'agit de proférer sentencieusement des lieux-communs. [...]
Dureté de ton dont on ne dira rien, faute d'éléments consistants ou de témoignages sérieux, mais cependant représentative
d'une époque, d'un "microcosme" et peut-être d'une génération.
Je ne pourrais pratiquement rien dire non plus des apparitions audiovisuelles de Barjavel dont je n'ai malheureusement pas
été témoin. Mais j'accueillerai avec le plus grand plaisir et le plus grand intérêt tous les témoignages et souvenirs les concernant.
Le propos n'est pas non plus ici de commenter les contributions à la Presse de Barjavel dans le rôle d'interviewé,
à l'exception bien sûr des savoureuses auto-interviews déjà évoquées... Indiquons seulement que les articles qui lui sont consacrés
présentent un grand intérêt, et que ceux qui ont pu être retrouvés dans diverses archives sont recueillis dans la section
"documents" du barjaweb, accessible (ici).







René Barjavel était-il journaliste ? Ces quelques cinquante années d'écrits journalistiques que nous venons
de parcourir donnent une large matière à explorer et montrent bien qu'il « a écrit dans les journaux »,
mais cela suffit-il pour le définir comme tel, et ranger les pages ainsi publiées dans cette catégorie d'écrits ?
C'est que les "genres" de ses écrits sont loin d'être tranchés ; on a pu voir que certains de ses articles, surtout
à ses débuts parisiens et dans les magazines consacrés au septième art, sont des "critiques" de films, puis de théâtre.
Et pourtant, parmi ceux-ci se trouvent, parfois intimement imbriquées au corps de l'article lui-même, des réflexions qui
font évoluer progressivement mais irresistiblement la page vers la chronique. Et dans ces chroniques elles-mêmes,
ne trouve-t-on pas des petits récits d'imagination, des contes, des nouvelles ?...
On pourrait alors contester la légitimité journalistique de l'auteur sur la base du manque de "reportages",
et pourtant;.. Que nenni !... Ceux-ci sont bien loin d'être rares et cela de ses débuts à Moulins et Vichy jusqu'aux interviews
de Brassens, de Funès ou Alain Peyrefitte dans les années 70...
Y a-t-il lieu alors de s'interroger sur le sens d'un journalisme barjavélien qui lui serait propre, ou du moins
d'une forme, ou plutôt d'esprit de journalisme dont il serait peut-être un des rares, ou des derniers, représentants ?
En fait, j'en suis arrivé à considérer que, plus que la forme, le genre, ou l'adhésion à une quelconque "école",
c'est bien la pensée et l'esprit de l'écrivain qui sous-tend toutes ses œuvres, ou plutôt toute son œuvre,
écrits journalistiques et sans doute aussi interventions audiovisuelles, comprises. Le "support" que constitue le journal
n'est qu'un moyen utilisé, la plupart du temps en parallèle avec ses autres activités, pour exprimer, communiquer et faire
partager sa pensée, plus que ses idées. Et ce moyen est pour lui privilégié, car facilement bidirectionnel : l'abondance du courrier
qu'il recevait de ses lecteurs, et auquel il répondait, si j'ai bien compris, très obligeament, donne la mesure de l'importance que
représentait pour lui ces contacts (non exclusivement d'ailleurs, car il ne négligeait pas non plus les échanges avec
les lecteurs de ses romans.)
À dire vrai, dans la plupart de ses articles, Barjavel parle essentiellement... de lui-même (et n'est-ce pas aussi le cas de ses romans ?) On est plus proche des Pensées de Marc-Aurèle ou d'un journal intime (ce qu'est d'ailleurs le Journal d'un Homme Simple) que des discours de Cicéron ou des reportages militaires de Jules César... On pourrait presque les voir en précurseurs
Ce journalisme barjavélien, dans sa diversité de thèmes et de formes, quelle unité peut-on lui trouver ?
D'abord, si l'on se contente de ce que les éditeurs ont rendu disponible "a posteriori", et partiellement, c'est à dire
dans les trois recueils Les Années de..., on y trouve essentiellement une curiosité universelle
Je suis dévoré par une curiosité qui ne sera jamais satisfaite, je voudrais tout savoir et tout voir. Et par une anxiété perpétuelle concernant le sort de ceux et de ce que j'aime. Et j'aime tout.
La curiosité est la plus grande qualité de l'homme. Elle l'a fait sortir de ses cavernes et l'a conduit jusque sur la Lune. Elle le poussera peut-être jusqu'aux confins de l'univers. A moins que demain, ce soir, elle ne le fasse sauter ou cuire à petit feu...
Curiosité universelle, certes, mais non sans discernement :
Il faut écouter avec une grande curiosité - et garder l'esprit sceptique mais ouvert. Ouvert, mais sceptique...
J'ai pu dire l'année dernière que cette curiosité constituait les fondations d'un émerveillement au monde dont les romans constituent l'expression directe : Barjavel ne dit-il pas,dans l'interview L'homme en question :
Cette curiosité s'exprime aussi dans un grand nombre d'articles, car l'écrit, tout particulièrement journalistique, vise à y faire participer le lecteur, en lui faisant partager ses coups de cœurs, les livres qu'il a appréciés, les personnes qu'il a rencontrées, tout cela "gratuitement" car il ne s'agit que de démarches de bonne camaraderie et non de publicité mercantile : personne ne devait payer pour être mentionné dans un article de Barjavel...
On a vu que l'œuvre globale de Barjavel journaliste déborde de beaucoup ce que nous en montrent les trois recueils Les Années de... Une vue plus complète met bien en lumière son imbrication étroite avec son œuvre globale.
La phrase :
la meilleure forme du journalisme, ça a encore été le roman.
donne toute la mesure du génie barjavélien, une fois replacée dans son contexte (hors duquel elle peut paraître pour le moins "bizarre"), et dégagée de l'ambiguïté que peut lui trouver une vision soucieuse de "politiquement correct". Car si l'auteur dit bien justement dans l'Homme en question :
il ne se donne pas un satisfecit s'autorisant toutes les falsifications ou "bidonnages", mais bien au
contraire un souci de qualité d'information. Cette distinction, assez innovante pour l'époque, entre information et savoir
a été depuis développée dans plusieurs études théoriques sur la sociologie des médias et de l'information.
Dans la préface du troisième recueil de la collection Omnibus,
Demain le Paradis, qui reprend l'ensemble des articles conservés sous forme livresque et en constitue à présent
la seule source disponible en librairie, Jacques Goimard fait remarquer avec
beaucoup d'à-propos :
Il ne s'agit pas de raconter les nouvelles mais de les commenter - tout en restant bien ancré dans le présent, le concret, l'imagé. Ni au Progrès de l'Allier ni au Journal du Dimanche, on n'aurait accepté qu'il [Barjavel] prenne la parole sans dire de quoi il parle ; de là sans doute la merveilleuse clarté qui baigne les "Libres propos" publiés dans le présent volume : même s'il s'agit en gros des années Pompidou (1969-1975) - c'est-à-dire, pour le lecteur actuel, d'un avant-hier (...) -, l'auteur incorpore à son discours le détail des événements ; et le miracle se produit : à un quart de siècle de distance, il nous tient encore la main.
J'ai cependant pu noter anecdotiquement quelques rares occasions où Barjavel "prend la parole sans dire de quoi il parle"... en 1950, quelques critiques de représentations théâtrales dans Carrefour donnent force détails sur la mise en scène, le jeu des acteurs, les éclairages, etc., mais il y omet simplement de mentionner le titre de la pièce... qui était probablement évident pour le lecteur d'alors, mais cela plonge dans la perplexité le lecteur d'aujourd'hui, ou du moins ne facilite pas le travail d'inventaire...
C'est cette vision "participative" du roman, ou plutôt du récit, et de la chronique journalistique qui est son point de départ et qui constitue cette unité inestimable.
Sont finalement assez rares les confrères de Barjavel qui ont suivi cette "double voie". Son ami Paul Guth s'y est risqué, avec un succès rétrospectivement
mitigé en ce qui concerne les œvres d'imagination, et son autre ami Georges Charensol, qui a dirigé les Nouvelles
Littéraires pendant de nombreuses années, avait bien une vision du journalisme assez similaire
(quoique plus centrée en ce qui le concerne sur la critique littéraire et cinématographique), mais reconnaît, dans
ses entretiens avec Jérôme Garcin, ne s'être jamais lancé dans le roman
ou le récit de fiction en général, par "manque d'imagination".
On sait que pour Barjavel ce n'est pas l'imagination qui est le "moteur" de sa créativité littéraire, mais la
logique la plus simple possible, comme il l'écrivait dans son Journal d'un homme simple :
Je m'excuse, je n'ai aucune imagination. J'ai seulement les yeux ouverts et un esprit simple, et assez logique. Ravage, Le Voyageur imprudent et Le Diable l'emporte ne sont que des catalogues d'éventualités. Je n'imagine pas. Je considère ce qui est possible.
Logique qui prend comme point de départ un événement ou un faisceau d'événements réels, associés et redéployés en un récit souvent plus palpitant que la réalité elle-même. Quoi de plus journalistique en effet que La Nuit des temps et surtout Le Grand Secret... Comme il le confiait à Jacques Chancel lors de son émission Radioscopie sur France-Inter en mars 1981 :
Et si la science-fiction a constitué le domaine privilégié de ce déploiement, il faut y voir la considération la plus générale de l'auteur pour ce genre qui, parce qu'il contient tous les autres, était selon lui - avec peut-être un peu d'exagération - l'« avenir de la littérature ».
On retrouve un point de vue très similaire sous la plume de l'écrivain américain de science-fiction Brian Aldyss qui, dans Voyage au cœur du rêve, une curieuse nouvelle se terminant en forme de triple interview, dont l'une avec l"auteur, se fait dire à lui-même :
Un auteur de science-fiction s'apparente à cet égard à un journaliste - il est accroché par une
chose en cours de réalisation. Le mystère l'intrigue autant que sa solution. Pourtant je ne peux pas tricher. Loin de là.
Vivons-nous dans un monde sans mémoire ?
La recherche - qui, comme je l'ai dit, n'est pas achevée - d'archives documentaires concernant les écrits
journalistiques de Barjavel m'a plusieurs fois conduit à une réflexion, parfois teintée d'une certaine angoisse, en me
demandant : « de quoi parle-t-il, à quoi fait-il allusion ? » En effet, certains événements qui ont
constitué le point de départ des réflexions alimentant sa chronique, sont à présent bien oubliés, alors même qu'ils
ont pu passionner le public à leur époque, et que des débats dont ils ont fait l'objet ont résulté des
transformations à présent bien acquises de la société. Se souvient-on par exemple qu'en 1964 une speakerine de la
vénérable R.T.F., Noëlle Noblecourt, qui présentait Télé-Dimanche fut licenciée, dit-on, parce qu'elle avait laissé voir... ses genoux.
C'est un peu comme ces rues où l'on a vécu pendant vingt ans, passant quotidiennement devant la même mercerie, et, le
jour où les merceries disparaissent et que celle-là se trouve remplacée par une agence bancaire, on revoit la rue et
l'on se trouve incapable de se souvenir quelle boutique il y avait là, avant...
Redécouvrir ces chroniques, ces “récits des jours ordinaires”,
n'a pas sur le lecteur un effet nostalgique, mais, plus simplement, remet les choses à leur place...





En guise de conclusion
Pour finir, ou plutôt ouvrir un champ de débats et de réflexions, je vais laisser la parole à Barjavel, en citant son article du 17 juin 1973 dans lequel le Prix de la Chronique Parisienne qu'il s'est vu attribué l'amène à nous faire part de ses réflexions sur son "métier" :
Faire mon métier de journaliste, qu'est-ce que c'est ? Vous parler de l'obstination du merle ?
Ou de celle de “Skylab” qui traverse notre ciel de nuit comme une étoile dérangée ? Qu'est-ce qui
est le plus important ?
[Ma tâche] est de saisir au vol son élan de vie, de comprendre l'éclatante joie verte des
marronniers, de vous communiquer, pour les partager avec vous, mon émerveillement ou ma
détresse [...]
Mon travail de journaliste, chaque semaine, tel que je le comprends, c'est de m'efforcer de
vous rappeler que même la pluie grise sur le trottoir sale est belle si nous savons que nous
sommes, vivants, en train de la regarder. [...]
La chronique parisienne, aujourd'hui, c'est très simplement la chronique universelle. La maintenir, chaque
semaine, c'est d'abord s'efforcer de penser avec sa propre tête, puis d'écrire ce qu'on pense de la façon la plus honnête
et la plus simple, afin que chaque lecteur sache de quoi il s'agit. C'est un métier difficile. A cause des mots. Ce sont
nos outils, mais aussi nos obstacles. Celui que nous cherchons, le précieux, l'unique, celui qui dirait tout à lui tout seul,
celui-là se dérobe, et ceux dont nous ne voudrions pas, les approximatifs, les à-peu-près, les moyens, coulent à flots à
travers la plume. On doit les refuser, biffer, recommencer, jusqu'à ce qu'on ait trouvé la pépite. Mais...
... Le
journaliste, en général, n'a pas le temps. Il faut que son papier soit terminé pour un moment précis, sinon c'est le
désastre. Huit feuillets pour neuf heures trente. C'est tout. On lui a fait confiance en lui donnant ce sujet et cette
colonne. Il n'est pas question qu'il ne termine pas à l'heure. Quels que soient sa bonne ou mauvaise disposition, sa
digestion, ses ennuis personnels, son rhume des foins et ses amours triomphantes ou contrariées, ce sera prêt. Mais le mot
unique sera peut-être resté caché derrière une circonvolution cérébrale, embusqué et ricanant, affreux jojo heureux d'avoir
séché la composition. Et pour aller plus vite, pour être prêt à temps, on a laissé s'enclencher la machine automatique qui
ne demande qu'à penser à notre place. On ne s'en aperçoit même pas, ça se fait tout seul. Les réflexes d'idées se répondent
et s'enchaînent. Point final, c'est terminé, c'est bon. Il est neuf heures vingt-neuf. Le lecteur lira cela sans peine.
Quand il aura fini, il ne s'apercevra même pas qu'il a traversé un article.
Voilà le danger qui nous guette :
commenter “Skylab” et n'avoir pas le temps de regarder le ciel et le moineau.
L'autre danger, c'est de se
croire plus sage que son confrère. Ou détenteur d'une vérité. La vie bouge sans arrêt. Elle nous trompe tout le temps.
La tour Eiffel n'a pas la même hauteur pour le merle et pour l'astronaute. Et l'un et l'autre ont raison. Il n'existe,
qu'on y croie ou pas, qu'une Vérité universelle, toujours vraie depuis toujours, c'est celle de Dieu ou de Ce qu'on nomme
ainsi. Tous les hommes la cherchent, même ceux qui n'y pensent pas. Et nul ne la connaît.
J'espère que cette conclusion sera pour tous bien plutôt une introduction et une invitation à redécouvrir
René Barjavel, journaliste, dans toute l'actualité qui semble "inusable" de ses libres propos...
Merci à toutes et à tous, sans oublier...
Remerciements
Si les documents, sources et références cités ou non ici et qui sont venus étoffer ces réflexions sont le fruit de recherches personnelles, un certain nombre n'auraient pas été "découverts" sans l'amabilité et l'obligeance de plusieurs personnes qui m'en ont signalé l'existence ou me les ont communiqués :
- Madame Paulette Ylzer, filleule de René Barjavel, pour ses souvenirs personnels et ses documents sonores inestimables,
- Madame Catherine Renon de Mareuil, fille de Jean Renon, pour la gentillesse de ses souvenirs Cussetois,
- Monsieur Olivier Bex, ici présent, grand collectionneur passionné de tout ce qui a trait à René Barjavel, et de journaux rarissimes en particulier,
- Monsieur Gilles Lehmann, citoyen helvète qui, présent hier, a du retourner outre-Léman aujourd'hui pour cause de rentrée scolaire,
- Madame et Monsieur Marie-José et Gérard Bouchet, qui ont aimablement, et talenteusement refait vivre par leurs voix les citations de cette présentation à Nyons,
- et bien sûr les Nyonsaises et Nyonsais qui, par leur présence à ces Journées, ont constitué l'un des meilleurs encouragements.
- sans oublier mes co-équipiers auteurs du barjaweb qui aident, petit à petit et mois par mois, le site à se construire patiemment...
- et enfin celles et ceux qui ont participé au Concours organisé par le barjaweb à l'occasion de ces Journées, participations qui ont prouvé que le sujet intéressait




 Qui êtes-vous, René Barjavel ?
Qui êtes-vous, René Barjavel ? 1930 : les débuts au pays des sources...
1930 : les débuts au pays des sources... 
