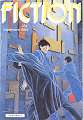La vision traditionnelle :
C'est entre 1180 et 1190 que le Graal a fait son apparition dans la littérature européenne, et cela par la grâce du
romancier champenois Chrétien de Troyes.
Du mythe nous ne retenons la plupart du temps que la version christianisée,
que rapporte l'évangile (apocryphe) de Nicomède, qui le limite à la coupe
ayant servi à la Sainte Cène, puis recueilli le sang du Christ et devenue le calice du rituel catholique.
J. Markale rappelle que c'est :
l'influence de Robert de Boron qui fait du Graal le plat, l'écuelle exactement dans lequel Jésus
mangea lors de son dernier repas avec les Apôtres
Au mieux on y voit l'objet merveilleux et mystérieux de la quête des chevaliers de la Table Ronde. Or le mythe du Graal
se compose de plusieurs éléments dont Barjavel a su exploiter toute la richesse et qui l'inscrivent définitivement parmi les
continuateurs de la Légende.
Philippe Walter (Le Livre du Graal - Éd. La Pléïade) analyse :
Le mythe du Graal est sans conteste l'un des plus riches complexes imaginaires que la littérature
ait su élaborer. Il s'est constitué par étapes successives. (...) Il n'a pas été d'emblée fixé dans son essence définitive
par un auteur dont les écrivains ultérieurs se seraient fidèlement inspirés. Il résulte au contraire de la superposition de
plusieurs strates légendaires, de la réécriture, de l'imbrication, de la contamination et de l'interaction de plusieurs
œuvres au départ totalement indépendantes les unes aux autres. (...) Il devient l'emblème poétique d'une littérature en
devenir : signe en attente de toutes ses métamorphoses imaginaires. (...) Le Graal se donne ainsi comme un mythe de
l'origine. Il conduit vers un passé perdu, un secret interdit. Il touche à l'inconscient de l'histoire sacrée et de
l'histoire profane des hommes.
C'est bien sûr la Quête en elle-même, cet élan vers l'Absolu qui pousse les chevaliers sur les routes mais également trois éléments clefs :
le Roi Pêcheur, le cortège du Graal avec la lance, et le royaume stérile et désolé.
Le Roi Pêcheur dont les deux mots accolés contiennent tout le bouleversement d'un monde où tout équilibre a disparu
(un roi chasse : pêcher c'est déroger à son rang comme le serait de travailler la terre), est le gardien du Château
magique. Blessé entre les jambes chez Chrétien de Troyes, sa souffrance est à l'image de la terre dévastée et stérile.
Le cortège du Graal se compose d'une procession de cinq jeunes gens qui traversent la salle.
Philippe Walter précise encore :
Dans ce cortège se succèdent un jeune homme porteur d'une lance blanche dont le fer saigne,
deux autres jeunes gens portant des chandeliers allumés, une belle jeune fille tenant un graal d'or fin, orné de pierres
précieuses, dont le passage illumine la salle. Une autre jeune fille ferme le cortège en tenant un tailloir d'argent,
c'est-à-dire un plat en métal précieux servant à découper la viande.
Si, dans la tradition celte, le graal s'attache au bien plus ancien chaudron magique,
Comme le relève Jean Markale, l'étymologie permet aussi de faire le lien avec le mot occitan
Gradal qui désigne un récipient servant à faire le cassoulet entre autres... La gastronomie n’est pas profane, elle est sacrée.
La femme comme vision du Graal
Elle va permettre à l'homme d'être dieu par son humanité. Le geste qui va la lier à Merlin est
un geste d'offrande et de possession
comme le Graal est don de soi sur le chemin de la pleine possession du moi. Dès les premières pages, la figure divine de Viviane est accentuée ; chez Chrétien de Troyes, l'ermite confiait à Perceval une étrange prière dans laquelle on a souvent vu, le souvenir d'incantations païennes :
une prière et la lui inculque jusqu'à ce qu'il la sache. Cette prière comportait bien des noms de Notre Seigneur
les plus efficaces et les plus importants qu'osât jamais prononcer bouche humaine si ce n'est en péril de mort"
(Le Conte du Graal, Perceval, traduit par Jacques Ribard, Paris, Éd. Honoré Champion, 1983, coll. traductions des classiques français du Moyen Age)
Chez Barjavel, Merlin donne à la femme aimée les mots qui, chez Chrétien de Troyes, doivent être dits au dieu aimé :
il prononça un mot d'une langue ancienne et lui fit répéter pendant plusieurs minutes. Il était difficile à articuler
et surtout
il faut que je te nomme maintenant un autre de tes pouvoirs, grave, important, que tu vas devoir utiliser
tout de suite.
Mais, détail important,
tout cela était en elle.
Posséder certains pouvoirs fait du simple humain un magicien mais, s'il les tire de lui-même, il a alors accès à la
divinité ; la distinction magicien/dieu est très nette.
Viviane,
riche comme la nature elle-même
symbolise le microcosme originel :
elle était l'eau limpide de la terre, la pluie neuve du ciel, la feuille transparente sortant du bourgeon, les yeux des étoiles.
Plus, elle est Dieu :
tu es Dieu... Dieu est en toi, Dieu t'habite parce que tu es belle... tu es ses miracles... les pointes de
tes seins sont ses étoiles, tes seins sont la Terre et le Ciel, tes hanches sont les balancements du monde, ta peau est la
douceur des fruits du paradis, ta bouche dit la vérité de ce qui est...
La femme, l'Amour et la Vérité se confondent et semblent être les composantes essentielles du Graal. L'image de la femme
cosmos/Graal, revient souvent :
Si un jour je suis admis à regarder dans le Graal, ce sont certainement tes seins que j'y verrai.
Ils sont la double perfection du monde, ils expliquent les mouvements et les formes et éclairent les mystères.
Au-delà de ce simple constat, surgit une autre vision du Graal. De cette adéquation femme-divin-Graal, naît en effet la
problématique concernant l'acte d'amour et ses relations avec le Sacré. La vision de la religion chez Barjavel condense
plusieurs courants, plusieurs légendes, plusieurs traditions et va dans le sens d'un Graal divin tout en refusant le point
de vue strict de l'Église. Passage essentiel, car nous avons dans ces pages, une assimilation très nette de l'Amour et de
Dieu. La référence au mythe d'Aristophane, « ils coupèrent l'Unique en deux » pour qualifier Dieu, explique les
interrogations ultérieures de l'écrivain, concernant l'acte physique et la notion même de virginité comme condition d'accès au Graal
Il fallait qu'Arthur fût chaste pour la quête du Graal et le sacrement du mariage place l'œuvre de chair
hors du péché.
Déjà la solution ne semble pas être dans l'abstinence de tout amour physique mais dans la sublimation, la transcendance
de cet amour. L'écrivain posera d'ailleurs le problème :
S'Il avait fait l'homme et la femme différents et complémentaires, pourquoi était-ce un péché pour eux de
se compléter ? (...) Pourquoi un homme et une femme qui voulaient s'élever sur le plan spirituel devaient-ils sacrifier
le plan sexuel ? La joie partagée était-elle condamnable ?
Le Graal ce n'est pas abolir le corps mais faire du corps le Graal. Le refus est celui de l'amour physique - plaisir
qui est obstacle sur le chemin du Graal,
plus qu'une faute, c'était une chute
mais il y a en revanche transcendance de l'amour physique - don qui est condition et, on peut se le demander, fin de la Quête.
La faute originelle n'en est pas une, c'est ce qu'en ont fait les hommes qui l'entache, d'où la nécessité de revenir à
l'amour à l'état pur. Merlin lui-même doit garder sa virginité et il se trouve sur le même plan que les chevaliers à la
Quête du Graal. Toute l'ambiguïté du Graal se trouve ici ; Barjavel refuse l'amour mystique.
Le mot mystérieux que Merlin garde par de vers lui est
le premier verbe qui servit à la création, la clé universelle.
Pourquoi pas « amo », harmonie de la religion et de l'amour entre les êtres ?
L'amour physique « n'est pas mal » et cependant il sera cause apparente de la chute de Lancelot
pour le Graal.
Ici le parallèle entre Viviane et Guenièvre doit être souligné. La reine ne connaît pas le plaisir, ni les joies de la
maternité
Elle n'éprouvait pas de déplaisir mais pas de plaisir non plus
et
elle tardait à être grosse et il lui semblait bien qu'Arthur lui en voulait.
Différence essentielle : Viviane a l'amour et un enfant, même né d'une autre. Tout cela parce qu'elle est Le Graal
alors que la reine est le Graal de Lancelot. La définition que Merlin donne lui-même de Viviane est profonde :
Depuis que je t'ai vue, je sais que je ne suis que la moitié de moi-même. Tu es mon autre moi qui me
demande et dont j'ai besoin (...) Un jour (...) il nous faudra choisir...
Au-delà de l'androgyne primitif et de l'Unique, perce l'idée qu'une fois devenu dieu, le divin aura accès à l'humain.
La définition du fait d'être ensemble est une vision du Graal :
On est enfin deux et un seul, l'univers a retrouvé son équilibre, on est son centre, dans le rayonnement de l'amour présent,
l'amour donné, l'amour reçu, l'amour de tout.
Elle conduit à celle de l'amour, l'amour véritable :
donner ce que l'Autre attend, prendre ce qu'il veut donner
et
Morgane est le contraire de l'amour : l'amour est don ; elle ne sait que prendre.
Là encore, la nécessité de la virginité des chevaliers trouve son pendant dans celle du couple :
voilà sans doute pourquoi celui qui est appelé à découvrir le Graal doit être vierge. Il faut qu'il
soit arraché au fleuve, libéré du désir (...) qui fait de lui un esclave. Ce n'est pas l'acte lui-même qui est proscrit,
mais l'enchaînement spirituel induit par le désir de l'acte.
La relation entre Merlin et Viviane est semblable aux deux moitiés de l'épée qui se laissent joindre mais ne s'unissent
pas. La réussite au Graal,
les deux fragments, aussitôt, ne furent plus qu'une seule lame, sans traces de la cassure
amène l'union éternelle des deux amants. La trame même du roman paraît bien être, parallèlement à la réussite au Graal,
la réussite absolue du « couple divin ». J.Markale cite :
(...) et lorsqu'ils furent l'un près de l'autre, rien ne les séparait plus, aucun interdit, aucun regret,
aucune honte, aucune peur. Ils étaient ensemble dans la nudité parfaite de la première jeunesse du monde.
Dès lors, l'enserrement est communion charnelle et spirituelle, et surtout issue voulue et attendue. Et c'est ce qui différencie
cette fin de toutes les traditions. Chez Robert de Boron, Merlin se laisse enserrer parce qu'il aime plus Viviane que sa
liberté. Barjavel écarte cette idée du choix, la relation avec Viviane étant synonyme du Tout Premier :
Ils entraient dans la joie de l'amour absolu où la chair et l'esprit se rejoignent, se confondent et emplissent
l'univers. Merlin murmura à Viviane le mot qu'il ne lui avait jamais dit, Viviane le répéta (...) L'air a tourné lentement
et s'est refermé autour d'eux, les dérobant aux regards du monde. Ils vivent depuis ce jour dans la chambre invisible,
la chambre d'air, la chambre d'amour, que le temps promène. Elle est là-bas, elle est ailleurs, elle est ici.
Le roman ne s'achève donc pas sur la « morale du Graal » mais sur la concrétisation de l'Amour.
Le texte reste d'autre part ouvert, ce n'est qu'un cycle qui aboutit et laisse ses traces dans le monde :
Un jour elle s'ouvrira (...). Au centre de l'île a poussé un pommier.
Et cependant
Le Graal s'éloigne mais reste toujours proche. Le chemin qui y conduit s'ouvre en chaque vivant,
comme un dernier message à l'intention de tous les lecteurs passés, présents et à venir.











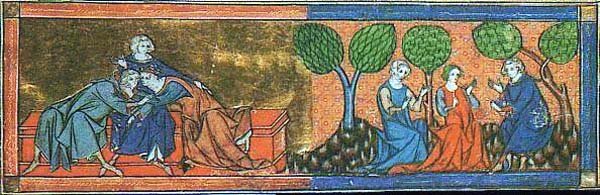




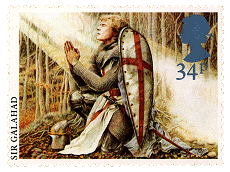






 Il écarte toutes les traditions qui font de Merlin une victime de Viviane.
Il écarte toutes les traditions qui font de Merlin une victime de Viviane.
 Lancelot et Guenièvre : un couple mythique qui a souvent éclipsé la quête du Graal et l'obstacle que leur
relation représentait vers sa réalisation.
Indissociablement liée à Arthur, l'histoire des deux amants éternels permet à Barjavel de prendre les libertés qu'il
souhaite avec la légende et de l'enrichir. La réécriture des textes premiers passe par une remise en cause particulière de
la reine. Dans les textes de Chrétien, Guenièvre, avant d'être femme, est reine. Le romancier inverse cette vision, son but
étant à travers ses pages, de donner la parole à l'humain avec ses faiblesses et ses désirs. Arthur a dix sept ans, des
boucles dorées et une carrure d'homme. Guenièvre n'a pas quinze ans, des cheveux longs tressés couleur de blé mûr et de très
grands yeux bleus mais « elle est déjà femme ».
Lancelot et Guenièvre : un couple mythique qui a souvent éclipsé la quête du Graal et l'obstacle que leur
relation représentait vers sa réalisation.
Indissociablement liée à Arthur, l'histoire des deux amants éternels permet à Barjavel de prendre les libertés qu'il
souhaite avec la légende et de l'enrichir. La réécriture des textes premiers passe par une remise en cause particulière de
la reine. Dans les textes de Chrétien, Guenièvre, avant d'être femme, est reine. Le romancier inverse cette vision, son but
étant à travers ses pages, de donner la parole à l'humain avec ses faiblesses et ses désirs. Arthur a dix sept ans, des
boucles dorées et une carrure d'homme. Guenièvre n'a pas quinze ans, des cheveux longs tressés couleur de blé mûr et de très
grands yeux bleus mais « elle est déjà femme ».
 Représentation post-romantique
Représentation post-romantique

























 récurrent :
c'est la forme qu'ont, dans ses romans "apocalyptiques" (pour des raisons géométriques simples), les Refuges et Arches, et en particulier
dans La Nuit des temps, l'Abri d'or du pôle Sud et son Œuf central, coque ultime abritant la mémoire du monde disparu
et ses deux survivants endormis.
récurrent :
c'est la forme qu'ont, dans ses romans "apocalyptiques" (pour des raisons géométriques simples), les Refuges et Arches, et en particulier
dans La Nuit des temps, l'Abri d'or du pôle Sud et son Œuf central, coque ultime abritant la mémoire du monde disparu
et ses deux survivants endormis.
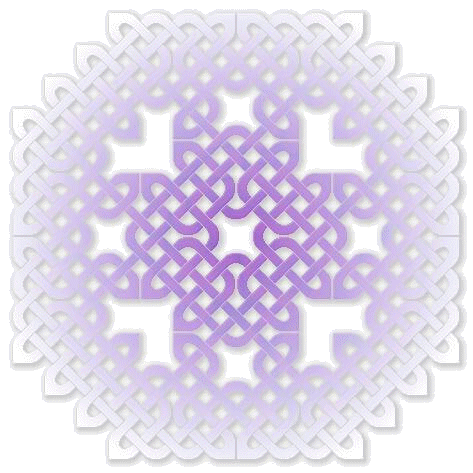


 . D'autres couleurs sont
introduites dans le texte sans pour autant avoir de sens symbolique, elles sont l'objet de lieux communs typiques de notre époque.
. D'autres couleurs sont
introduites dans le texte sans pour autant avoir de sens symbolique, elles sont l'objet de lieux communs typiques de notre époque.