Les journées Barjavel à Nyons les 20 et 21 août 2011
La présentation de Pierre CREVEUIL :
romantique malgré lui ? |
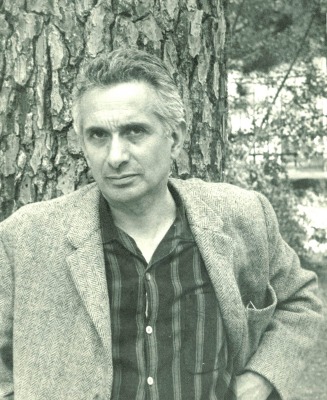
|
|
Cette conférence a été donnée dans le cadre des traditionnelles journées Barjavel, le 21 août 2011
à Nyons (voir la présentation), dans la cour de l'ancien collège Roumanille.
Le texte ci-après en est la transcription adaptée pour le barjaweb et complétée de développements, références et bibliographie. De plus, des contacts noués à l'occasion de ces Journées ont permis d'étoffer utilement certains aspects par l'apport de témoignages directs. Cette version imprimée de la transcription de la conférence du 21 août ne permettra pas bien sûr de rendre les animations interactives offertes par la page Internet, ainsi que les documents sonores qui ont été proposés au public. Apparaissent également sur la présente page des liens soulignés vers de nombreuses pages de compléments, qui n'ont bien sûr d'effet que lors de la consultation du site barjaweb. J'ai l'intention de vous parler d'un auteur de science-fiction, connu pour son humanisme et une certaine sensibilité écologique, dont les initiales sont "R.B."
Ray Bradbury, disais-je, avait des affinités certaines avec René Barjavel. Les deux écrivains s'étaient rencontrés, en particulier en juillet 1978, comme
notre auteur l'a raconté dans son article du Journal du Dimanche le 16 juillet : « La martien Bradbury existe, je l'ai rencontré »
Ceux qui connaissent Chroniques martiennes auront pu reconnaître le thème du début de l'histoire, mais ce n'est pas le lieu de commenter Ray Bradbury... La science-fiction peut-elle être romantique ? Pour Barjavel, il n'y a a priori aucune impossibilité, au contraire. Car posons encore, comme presque chaque fois, la question scolaire : « Qu'est-ce que la science-fiction ? »
On sait que, pour Barjavel, la science-fiction n'est pas un genre littéraire, car elle contient tous les genres. Il l'a maintes fois écrit, justement dans son article racontant sa rencontre avec Ray Bradbury : Écoutons-le maintenant dire à peu près la même chose, cette fois il y a déjà plus de 50 ans, au micro d'une émission de radio le 16 avril 1958 : "Les voix de l'avant-garde : La littérature de science fiction" Nous aurons encore des occasions de l'entendre exprimer ce même avis... Rien n'interdit donc à la science-fiction d'être sentimentale, romantique, voire même... érotique. Et certaines collections approfondissent cette voie (si j'ose dire),
en publiant de temps à autres des recueils de nouvelles spécifiquement constitués de textes de ce domaine. Il y a deux ans, l'auteure Sylvie Lainé (qui était présente en
2008 à l'Olicon et aux Journées Barjavel) m'a adressé une nouvelle qu'elle venait d'écrire, « Toi que j'ai bue en quatre fois », publiée dans un recueil
spécial chez ActuSF : "69"
Les fantasmes étaient-ils au rendez-vous ? Je vous laisse aller le découvrir...
Barjavel, quant à lui, a-t-il écrit des romans romantiques ? Et même plus (si affinités...) ? Qu'en pensent les lecteurs (et les lectrices) ?
Bonjour. Je tiens à vous féliciter pour votre site le BARJAWEB. Il y a quinze jours, je suis montée en haut de l'Arc de Triomphe.
J'en rêvais depuis des années et des années... après avoir lu un roman de René Barjavel : Avec cette question (je vous laisse y répondre...), le mot est dit...
Nous venons d'entendre le tout premier "livre" du jeune René Barjavel, « Colette à la recherche de l'amour ». Présenté de façon
assez détaillée sur le site barjaweb,
il est l'œuvre d'un jeune homme de 22 ans, transcription de la conférence donnée devant les bonnes gens de Vichy et de Moulins au printemps 1934.
En le lisant, ou en l'écoutant comme nous venons de le faire, on peut se sentir quelque peu interpelé par certaines scènes, et les trouver quelque peu
lestes ! Mais c'est bien le texte de Colette, et il y a lieu de saluer l'audace relative du jeune conférencier...
 La classe du collège de Nyons en 1922 - René Barjavel est le plus grand On peut dire, en continuant la lecture de La Charrette bleue, qu'Abel Boisselier fut un "professeur de romantisme" pour le jeune René. Revivons ces heures : il organisait...
Que faut-il imaginer de la vie sentimentale du jeune René Barjavel à Cusset ? Fut-il un Don Juan, séducteur ténébreux ?
Ou plutôt, je pense, une sorte d'aimable et joyeux Casanova, cherchant à faire plaisir et quelque peu “cœur d'artichaut”...
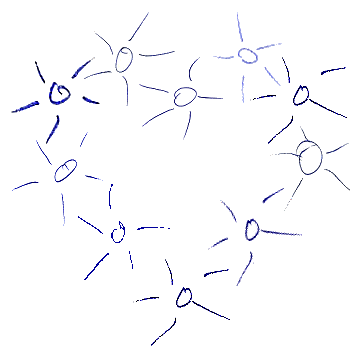
Les débuts professionnels d'écriture de Barjavel ont été, comme on le sait, ses savoureux "Billets du matin" au Progrès de l'Allier. Couvrant toutes sortes de sujets, et montrant ainsi déjà sa "curiosité insatiable", on y retrouve des élans lyriques et sentimentaux, équilibrés par ce que l'on pourrait dire "les pieds sur terre". À côté de considérations nostalgiques sur la mort d'un papillon à la fin de l'été (le 16 octobre 1930), des envolées lyriques provoquées par le renouveau printanier, et d'une poétique histoire d'amour entre une marguerite et un chèvrefeuille (20 janvier 1931), on peut y trouver (le 6 février 1934) une belle exégèse du Cantique des cantiques, audacieuse pour l'époque, car il le considère non pas comme "un poème d'amour symbolisant l'affection du Christ pour l'Église", comme l'expriment les doctrines officielles, toutes religions confondues, mais comme celui, éminemment charnel : Pour le jeune homme, en effet, l'amour n'est pas un sentiment éthéré, mais un moteur physique puissant... Déjà plus jeune, n'est-ce pas, les commères ne
surveillaient-elles pas le tour de taille de la jeune fille l'accompagnant...
Incontestablement, l'œuvre romantique de Barjavel est son roman Tarendol. Son analyse permet de comprendre beaucoup de choses.
« Tarendol, c'est moi ! »
Qu'en est-il de ce projet initial d'avant guerre ? Ecoutons-le, en 1969, au micro de Claude Archambault :
S'il prend ses distances avec les petites histoires d'amour, il garde d'autant plus son intérêt pour l'Amour. Car celui-ci, sous toutes ses formes (du moins celles admises par
l'époque, et il se montrera aussi "avant-gardiste"), restera toujours présent dans ses romans, ses contes, et ses essais : on peut dire que la question continue "à le travailler" - ce qui est sans nul doute,
pour le moins, un signe de bonne santé...
Dans ses premiers romans - de science-fiction, s'entend - l'amour aura une place très conventionelle. Car ce n'est pas, ou ce n'est plus, sa
préoccupation : il s'interroge sur le monde, les hommes en tant que genre humain, l'Homme... Dans Ravage, les personnages et leur psychologie sont
(il le reconnaîtra lui-même) "plats". Si la relation amoureuse de François Deschamps et Blanche Rouget est un des éléments du récit, avec la rivalité de Jérôme Seita,
rapidement éliminé par un combat métaphorique, elle ne s'encombre pas de quoi que ce soit de "romantique". Et la fin du roman attribue à "l'amour" un rôle très
prosaïque : la reproduction, et le repeuplement de la Terre, avec recours optimal à la polygamie...
Mais Barjavel construit petit à petit l'idée qu'il suffit d'un couple pour (re)peupler le monde - idée biblique s'il en est. Dans Le diable l'emporte, c'est bien un couple que veut sauvegarder M. Gé, à l'abri d'un cataclysme mondial. Sans trop se poser de questions, il est vrai, mais avec, malgré tout, intervention de l'élément amoureux in extremis. Colomb de la Lune est à la fois un roman de science-fiction, un conte humoristique (il obtint le Prix Alphonse Allais), et un bouquet d'histoires d'amour. C'était alors le roman préféré de l'auteur, et il est, dès le début, placé sous le signe de l'Amour : Il combine trois récits amoureux, celui de la femme de Colomb, Marthe - (Ça devient chaud, n'est-ce pas ?) donc, de Marthe et son jeune amant, torride ; celui - torride aussi - de la sœur de Marthe, Suzanne, et d'un journaliste, peu gâtés par la nature l'un et l'autre. Et celui, presque mystique, de Colomb et de - j'allais dire la Lune - la Princesse de ses rêves, ceux qu'il fait en voyageant vers la Lune, reprenant les histoires que sa mère lui racontait enfant... Amour poétique, silencieux et un peu contonneux, et cependant, écoutons le, mis en chanson :
Ensuite, pour des raisons personnelles, Barjavel n'écrit plus de romans pendant quelques années. C'est une période un peu sombre de sa vie, il dira lui-même
se sentir usé et désabusé, et se pose beaucoup de questions. Il les met en texte dans son essai La faim du tigre.
Toutes ses questions tournent en fait autour de l'amour... Non pas en tant qu'élément littéraire ni de moteur des "petites coliques érotico-sentimentales du couple, du trio,
du quatuor...", mais en tant qu'impulsion poussant tout être vivant à... à quoi ?
Alors pourquoi la poésie, la beauté ? Et pourquoi les "empêchements", ceux-là même qui font le romantisme, les drames de la littérature, depuis même l'Iliade
ou l'Épopée de Gilgamesh. La peste dans Roméo et Juliette, la guerre dans Tarendol, l'abîme des millénaires dans La Nuit des temps.
Et, ailleurs : |
Et c'est cette Question, cette Quête, qui est finalement plus importante pour lui que la réponse :

On l'a vu, Barjavel a "choisi" d'écrire dans le "genre science-fiction" parce que cette nouvelle littérature, plus qu'un genre, lui permettait d'exprimer tout ce qu'il voulait dans tous les domaines. Mais il va plus loin, car à propos du roman classique, il écrivait, en 1962, alors qu'il venait de reprendre la plume d'écrivain de science-fiction après une interruption de 14 ans, dans sa piquante auto-interview pour Les Nouvelles Littéraires :
Personnellement, je trouve qu'il y va fort ! Sans doute y a-t-il dans ses mots une part de provocation, et d'auto-promotion pour la science-fiction. Mais il est clair que le rejet, presque physique, d'un certain esprit de la littérature revient souvent dans ses mots. Écoutons-le encore, tout d'abord en 1970, lors d'une rencontre avec les étudiants en sciences humaines organisée par au théâtre de l'Ouest Parisien à Boulogne :
et, en 1983, dans ses Réponses au Collège de Chalais
Les choses sont donc claires :
- Barjavel professe de détester le roman romantique...
- La plupart des romans de Barjavel sont... romantiques
C'est problématique...
Mais il manque à nos considérations quelque chose d'essentiel... la définition du romantique. Or elle n'existe pas. D'une part parce que les dictionnaires tournent en rond, avec des choses telles que
Romantique (adj.) : relatif au romantisme. Romantisme (n.m.) :
On verra quand même une analyse assez complète du concept sur la page de  ikipédia
qui distingue bien deux sens, celui "étymologique" et celui "littéraire", et de nombreux sous-concepts.
ikipédia
qui distingue bien deux sens, celui "étymologique" et celui "littéraire", et de nombreux sous-concepts.
On trouve par ailleurs des points de vue fort bien exprimés tels que :
le romantisme se caractérise par le libre cours donné à l'imagination et à la sensibilité individuelle, qui le plus souvent traduisent un désir d'évasion et de rêve .
qui s'appliquerait bien à l'œuvre de Barjavel...
Je pense qu'il n'est pas prudent aujourd'hui du moins, d'aller
se perdre dans ce dédale. Restons avec Barjavel, et laissons-nous charmer par son paradoxe, qui vaut bien celui du grand-père dont il est admis qu'il est
l'inventeur. Et continuons l'exploration de son œuvre en essayant de (le) comprendre.
Au tournant d'une époque : La Nuit des temps
|
C'est en 1969 (année érotique !) que Barjavel retrouve à la fois le genre "science-fiction", et le succès littéraire, avec La Nuit des temps. Ce roman est pour lui un renouveau, à de nombreux points de vue, et le Prix des Libraires qu'il obtient cette année-là le fait rebondir. Et pour beaucoup de lecteurs (et lectrices) ce roman a une place bien particulière... |
 |
Si certains l'ont trouvé inspiré par La Sphère d'Or, d'Erle Cox (ce que Barjavel réfutera par la suite),
d'autres - plus nombreux il faut le dire - y voient une recopie de Roméo et Juliette. Mais pour tous il est une grande histoire d'amour.
Et même, osons le dire... un livre érotique !
|
|
R.B. - Moi je trouve que... il y a quelque chose d'effrayant dans le vocabulaire de la sexologie. B.P. - Ah !?... R.B. - L'orgasme B.P. - Ben oui... R.B. - Que de mots horribles... B.P. - Et vous diriez quoi ? R.B. - Je ne sais pas... C'est terrible, n'est-ce pas, dans ce domaine, ou bien on a affaire à un vocabulaire scientifique qui est épouvantable, qui vous couperait les... vos élans d'une façon affreuse, ou bien alors il y a le vocabulaire populaire qui, du fait de la honte qui s'attachait à cette fonction jusqu'à maintenant, a quelque chose d'ordurier. Ce qui fait qu'on est totalement démuni de vocabulaire dans le domaine de l'amour. Alors... B.P. - Comment en parler ? R.B. - Je ne sais pas... Chaque couple est obligé de tout réinventer. | |
Et il complètera : | |
|
R.B. - Je crois que là, je me permets d'entrer en conflit avec vous, vous venez de prononcer le mot "amour" pour la première fois, depuis le début de cette soirée. C'est la première fois qu'on parle d'amour. Jusqu'ici on a neaucoup parlé de sexe et de tout ce... et de l'activité sexuelle, mais justement, ce qui fait, de tous ces gens que vous avez étudiés dans le présent ou dans le passé, des infirmes, c'est qu'il n'est jamais question d'amour. Or l'amour c'est la solution. Parce que le sexe sans amour c'est une supercherie. Suit un petit débat... puis Barjavel reprend : R.B. - L'amour c'est l'accomplissement du couple. C'est ce qu'on trouve dans la fleur. C'est l'accomplissement, l'accord, et l'équilibre. C'est la seule chose qui puisse apporter la paix au point de vue sexuel, c'est l'amour. Parce que, lorsque - c'est assez rare - lorsqu'un homme et une femme abordent la sexualité avec de l'amour, mais attention, ce que j'appelle amour ce n'est pas celui qui a comme vocabulaire « je te veux, je te prends, tu es à moi, tu m'appartiens. » C'est à dire l'amour... une espèce d'exaspération de l'égoïsme et de la possession. C'est le contraire. Et lorsque deux êtres s'aiment, et avec assez de force pour que chacun puisse penser à l'autre avant de penser à lui-même, alors s'établit un équilibre où il n'y a plus de problèmes sexuels, parce que toutes les barrières tombent. Toutes les timidités s'en vont. Tous les nœuds qu'on a pu subir pendant son adolescence ou son enfance se défont. Et, alors là, ce sont des gens dont on n'entend pas parler, ces couples-là. Parce qu'ils sont enfermés dans leur bonheur et dans leur réussite, ils sont comme une pomme qui a retrouvé ses deux moitiés et qui s'est bien enfermée dans sa peau. | |
Puis, la suite du débat apporte une révélation ! Parmi les invités, une sociologue, Marie-Françoise Hans, présente son livre Les femmes, l'érotisme et la pornographie, résultat d'une enquête sur le sujet. Elle précise les conditions de cette enquête : | |
|
Marie-Françoise Hans - Nous avons pris une cinquantaine de femmes, qui vont de seize
à quatre-vingts ans. Et... d'ailleurs l'une d'entre elles, celle de seize ans, j'y pense parce que René Barjavel est à
côté de nous, à une question sur le livre érotique, enfin « quel est votre premier souvenir
érotique ? », elle a répondu : « La Nuit des temps de René Barjavel. »
R.B. - Tiens, je pensais que c'était plutôt des scènes d'amour qu'il y avait dans mon livre, plutôt que des scènes d'érotisme. M.-F.H. - Eh bien c'est ce qui l'avait troublée, mais troublée érotiquement. R.B. - Érotiquement... | |
Barjavel, érotique... Il y a en effet dans son œuvre de quoi constituer une jolie anthologie de passages que l'on peut qualifier, selon le point de
vue, lestes, érotiques, torrides. J'ai d'ailleurs le projet de les regrouper sur une page du site, dont il faudra (comme pour cette émission d'Apostrophes...)
restreindre l'accès aux "personnes averties". Est-ce nécessaire en fait ? Ces scènes, passages et se trouvent dans les romans les plus courants,
que les bibliothèques municipales placent souvent dans les rayons "jeunesse".
Et c'est parce que l'Amour fait partie intégrante de la Vie qu'il ne peut pas ne pas le rendre présent, de façon concrète, dans ses récits. Et non
par intérêt pour les “coliques sentimentalo-érotiques d'un couple enfermé dans une chambre”... Les sentiments, et l'acte en lui-même sont totalement "sains".
Il exprime cela lors d'une interview :
Et le justifie à de nombreuses occasions, en particulier, pour la scène d'Une Rose au Paradis, au micro de Jacques Chancel dans
Radioscopie
R.B. - Oui, il y a le dialogue entre les jeunes amoureux ; il y a aussi la séduction du jeune mari par la femme la nuit, que je me suis délecté à cette
séduction discrète, la façon dont elle s'introduit dans le lit de l'homme dont elle est tombée amoureuse, avec une telle discrétion...
J.C. - Oui, mais on voit là, René Barjavel, que vous aimez les jeux de l'amour, hein ?
R.B. - Oui, bien sûr, bien sûr, ça fait partie des bonheurs de la vie, n'est-ce pas, j'aime La Femme
- je ne dirais pas « j'aime les femmes », moi je [ne] suis pas un homme à femmes, je trouve que la femme est une des choses les mieux
réussies du monde. [...]
J.C. - Et puis vous parlez d'une manière très particulière à la femme.
Enfin, là, c'est M. Gé qui parle à Silfrid, mais je voudrais quand même dire un peu ce que peut dire un homme à une femme : « Ne te ferme pas, laisse-moi te
regarder une dernière fois. Il faut toujours que vous fermiez quelque chose en vous : votre tête, votre cœur ou votre sexe, ou les trois. Vous croyez vous mettre à
l'abri, vous ne faites que meurtrir les hommes qui vous aiment. Vous les obligez, pour vous connaître, à se transformer en conquérants. Alors, ils fabriquent les bombes. Ce
n'est pas le monde qu'ils veulent détruire, c'est le mur derrière lequel vous vous cachez... »
R.B. - [rires] Je crois qu'il y a pas mal de...
J.C. - Hein, oui...
R.B. - C'est assez vrai... que les hommes qui vous écoutent, en jugent. S'ils ont... s'ils sont amoureux.
J.C. - Vous êtes un homme de souvenir, là ?
R.B. - Oui, bien sûr, un homme d'expérience... [rires] On rencontre toujours , même chez la femme la plus amoureuse,
ce besoin de défense, ce besoin de se mettre dans une citadelle, ça c'est certain. Qu'on est obligé de... ou bien on est obligé de s'y introduire,
soit par la ruse, soit par... non, la force ne vaut rien - mais par le... ou alors à la faire fondre sous l'amour... mais, ce n'est pas toujours facile...
On notera au passage qu'il n'aime pas les femmes mais LA femme, ce qui semble démentir l'hypothèse de "casanovisme" à laquelle je me suis laissé aller tout à
l'heure ; à moins que ce ne soit le contraire. (comprenne qui pourra...)
Son enthousiasme pour la vie et les élans qu'elle donne, il l'exprimait au début de cette émission Apostrophes dont nous avons parlé, tant à propos des animaux que des fleurs... :
Il l'exprimera à propos de celui qui fut l'incarnation du héros romantique, Gérard Philipe : (interview pour FR3 vers 1982
- on voudra bien excuser la piètre qualité de cette archive sonore) :
Si les héros sont, disons "moins jeunes", alors ils cherchent dans l'Amour une potion de jouvence, voire d'éternel jeunesse, éventuellement aliméntée par des
"partenaires" plus jeunes. C'est le cas de la femme et de la sœur de Colomb, du patriarche François Deschamps dans Ravage, où Barjavel lui fait
suivre, est-ce sans le savoir, des préceptes de longévité orientaux. Et aussi, et surtout, Jeanne dans
Le Grand Secret.
- Je voudrais vous demander, Barjavel, ce qui vous a amené à être un auteur de science-fiction ?
R.B. - Ça c'est bien difficile, disons si vous voulez que quand j'étais un jeune garçon j'ai lu Wells et Jules Verne mais
surtout Wells avec passion, que, ensuite, lorsque j'ai eu envie d'écrire, j'ai eu comme tout le monde envie d'écrire un roman d'amour mais que je l'ai laissé de
côté pare que je ne me sentais pas encore bien capable de me séparer de mes propres souvenirs, et que je me suis surtout senti le besoin de m'évader des petits
problèmes psychologiques, romanesques, qui me barbent... Enfin, en tant que lecteur, d'abord, je ne peux plus lire un roman dit "psychologique" -
aujourd'hui d'ailleurs ces romans psychologiques sont uniquement physiologiques, par dessus le marché, n'est-ce pas, cela n'a aucune espèce
d'intérêt : faisons l'amour mais n'en parlons pas, et il y a d'autres problèmes mais beaucoup plus graves, des problèmes immenses qui se posent aujourd'hui
aux hommes, et bien moi en tant qu'écrivain, j'estime que je dois essayer d'examiner ces problèmes, voilà.
C.D. - Il y a dans votre œuvre des créatures féminines particulièrement séduisantes, et que vous avez rendues semble-t-il séduisantes à
plaisir. Je pense notamment à Éléa de La Nuit des temps, je pense à Griselda, des Dames à la licorne. Quel rôle les femmes jouent-elles à la fois
dans votre littérature, et dans votre existence ?
R.B. - La femme pour moi c'est l'essentiel de la création. Je crois que si j'étais DIeu, je recommencerai beaucoup de
choses, je ne recommencerai pas la femme. Parce que là, il a réussi quelque chose de sublime et de parfait. Elles nous font les pires tours, elles nous rendent
la vie impossible, mais je crois tout de même... elles sont notre raison de vivre, n'est-ce pas ? D'ailleurs le mystère de la Vie c'est ça, c'est que nous
les hommes, nous sommes projetés par une puissance incroyable à laquelle nous ne comprenons rien, vers ce phénomène charnel qu'est la femme. Tout en sachant
très bien que nous allons nous y casser les dents, que nous allons nous jeter sur des lames de rasoir, mais, en même temps, nous allons y trouver des.. la joie
que donne la rencontre de la beauté. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un corps de femme ? Rien.
J.A. - Vous êtes plutôt un être flottant ?
R.B. - Ah, flottant, non, mais pas dominateur...
N.R. - Alors ça, si, vous ne le reconnaissez pas, mais si, un peu "macho"...
J.A. - Oh là là ! Est-ce que vous êtes un peu macho ? franchement ? tâchez d'être objectif...
R.B. - Je.. je ne sais... je n'ai jamais bien compris quel était le sens de ce mot... Disons que je suis un être du genre
masculin, et que les êtres du genre féminin ont pour moi un attrait féminin... Alors c'est peut-être cela être macho ?
J.A. - Vous aimez les femmes ?
R.B. - Euh... je ne suis pas un coureur de femmes... j'aime beaucoup LA femme.
J.A. - Oui...
R.B. - J'ai un grand respect, une grande admiration pour elle.
Je disais tout à l'heure qu'acheter des livres dans les librairies d'occasion est très instructif des "réactions" de lecteurs ; ainsi au moment d'un tel achat
j'ai eu droit au commentaire de la vendeuse :
Ah, Barjavel, oui, c'est bien, mais alors, les bonnes femmes il ne les aimait pas !
Peut-on le croire ? Car enfin, il disait bien :
Il s'est expliqué sur ce point dans le reportage L'Homme en question :
A.S. - Si vous étiez Dieu, vous l'avez dit, vous ne recommenceriez pas la femme, et vous écrivez « Le corps de la femme
doit rester pour l'homme une Amérique avant Colomb. » Vous le pensez vraiment ?
R.B. - Oui. Oui, je pense qu'il faut constamment la découvrir.
A.S. - D'ailleurs elle est là pour que l'homme la découvre ?
R.B. - Non ! elle n'est pas là.. L'Amérique n'était pas là pour que Colomb la découvre. Mais la joie d'être de Colomb
c'était de découvrir l'Amérique.
A.S. - Et la joie d'être de l'Amérique ?
R.B. - Ah, c'est autre chose, ça... Mais je pense que la joie de l'homme dépend à 100% de la joie qu'il est capable de
donner à la femme.
Alors...
C.D. - Partant de cette source d'amour qui irrigue votre œuvre, vous ne traitez pas seulement du cœur, mais du
corps. Vos personnages sont de chair. Ils éclatent de sensualité, en quelque sorte. C'est bien cela, n'est-ce pas ?
R.B. - Oui, mais il faut donner au mot "sensualité" toute sa signification. Mes personnages sont sensuels par tous
leurs sens. Ce sont des morceaux de l'Univers, des morceaux de la création. Ils sont en contact avec tout le reste du monde, par tout ce que Dieu leur a donné
pour prendre contact et pour prendre conscience de ce monde. Ils regardent, ils écoutent, ils mangent, ils boivent, ils sentent. Ils sont heureux de tout ça. Et
ils font l'amour aussi, parce que c'est l'accomplissement suprême de la conscience de l'Univers.
Sa sensualité reste quand même essentiellement visuelle, et c'est l'impression qu'il transmet directement à l'esprit du lecteur - et de la
lectrice, même si l'on sait que les femmes sont davantages réceptives aux messages d'autres sens...
Il faut quand même signaler une expérience sensuelle non visuelle très forte dans Tarendol, où le lecteur peut participer de façon auditive aux émois
de Marie et Jean...
Et, alors que ces amants passionnés meurent (soit de leur passion elle-même, soit de circonstances que l'on peut qualifier de "collectives", tout le reste de
l'humanité les accompagnant, d'autres "en guérissent". Et ce sont peut-être ceux-ci les plus intéressants, et il y aurait sans doute beaucoup à analyser sur les
"mécanismes de la rédemption" chez Barjavel.
Peut-être faut_il penser que la passion, pour Barjavel, est quelque chose de trop intime ou personnel pour être mise en action dans un récit...
Barjavel n'a-t-il pas peur de choquer ? Considère-t-il que ses livres s'adressent "à tout public" ? Clairement, oui. Même aux plus jeunes, et on
peut considérer que l'une de ses devises est "le mal est dans l'œil (ou l'oreille) de celui qui le voit (ou l'entend).
Ainsi dans le La Charrette bleue, il considère :
Et, après tout, n'évoque-t-il pas, dès 1942 dans Ravage, le pouvoir stimulant des spectacles que l'on peut qualifier de "lestes" :
Et nous avons clairement vu que, même si la pensée de Barjavel demeure indubitablement déiste, tout en accompagnant ses convictions de nombreuses
interrogations, sa position vis-à-vis des Églises est pour le moins mitigée.
À noter que le premier de ces articles fut repris dans un petit livre « Le plaisir sexuel est-il un péché ? »,
regroupant des textes de divers auteurs autour de la question (Éd. Guy le Prat, Paris, 1982).
Et pour les choses de l'Amour, s'il considère sans l'ombre d'un doute que son objectif est la procréation, c'est par l'effet d'un piège de la nature, dans
lequel la religion n'a aucune part, rien à voir et surtout rien à dire. Dans La Faim du tigre, il s'interroge :
Il laisse quand même, "traditionnellement", un rôle officiel au prêtre - et de façon indépendante de la religion proprement dite - dans
l'officialisation des unions. Dans La Nuit des temps, la Désignation, organisée par le Grand Ordinateur Central, s'accompagne d'un cérémonial
quasi conjugal :
La vision des joies de l'amour physique peut être vue comme un chemin vers le Divin (plus que vers "Dieu"), mais finalement cette considération plutôt
phraséologique est superflue. Il ne peut s'agir que d'une expérience intérieure personnelle, ou plutôt trans-personnelle, bien plus qu'un sujet de discours. En
aurais-je déjà trop dit ?
À cette finalité procréatrice de l'amour, Barjavel refuse aussi - de façon conséquente et automatique - que les religions y mettent leur... grain
de sel. En particulier pour le "problème" (intensément d'actualité dans les années 1960-70) de la contraception, et même, au-delà, de l'avortement. Il ira en personnellement
à l'Assemblée Nationale assister aux débats du vote de la “loi Weil” dont il rendra fidèlement et objectivement compte dans son article au
Journal du Dimanche du 1er décembre 1974.
C'est aussi un sujet sous-jacent, mais très important, dans son œuvre. Soit comme un (gros) problème - dans Tarendol, soit comme thème
science-fictionnesque - dans La Nuit des temps, où il décrit la solution parfaite (et universelle), la Clé :
soit comme solution et problème, autrement dit élément du rebondissement de l'action - dans Le Grand Secret, et aussi dans Une Rose au
paradis.
Il peut donc bien s'attirer les suffrages féminins et féministes, bien conscient d'ailleurs que cette préoccupation n'est pas que celle des femmes mais
du couple, et que, on l'a vu à propos de ses derniers mois de jeunesse à Nyons, il y a été sensibilisé très jeune, et l'est sans doute resté plus ou moins
directement...
Son enfance fut marquée par deux événements dramatiques et décisifs : la Grande Guerre, qui fit disparaître pratiquement tous les hommes - dont son
père - au Front, pendant (au moins) quatre ans, laissant les enfants dans le meriveilleux cocon des présences féminines.
Puis la maladie, et la mort de sa mère, alors qu'il a onze ans (le 29 mai 1922). Drame donc la conséquence fut, du fait de la moindre disponibilité de son
père, et de la merceilleuse opportunité offerte par Abel Boisselier, son départ pour Cusset.
Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que le jeune enfant se soit formé une image merveilleuse de sa mère, et avec elle, de la gente féminine, dont il gardera une
image marquante : Mais bien sûr, les psychanalistes freudiens ne manqueraient pas de gloser sur "complexe d'Œdipe", "angoisse de castration", "meurtre du père"
- et les lacaniens de jargonner. Restons-en là.
Et reconnaissons aussi quand même que Barjavel a pu écrire
Alors, avant de conclure, je vais quand même proposer quelques pistes d'approfondissement pour celles et ceux qui sont intéressés par un peu de "théorie".
Mais j'espère que tous et toutes auront au moins autant de plaisir à (re) découvrir les joies des évocations amoureuses de Barjavel, et à les faire partager...
Où à rêver à Éléa, comme le fils Vignont...
La section du site consacrée aux travaux académiques (http://barjaweb.free.fr/SITE/academie)
présente un certain nombre d'études consacrées aux aspects que nous avons abordés ici. J'ai pu conseiller certains de leurs auteurs, étudiants et étudiantes
que le goût pour Barjavel avait amenés à y consacrer leur mémoire ou thèse.
Faut-il conclure ? Mon propos, vous l'avez compris, n'a pas été de démontrer quoi que ce soit selon une philosophie précisément dirigée. Parce qu'il n'y
en a pas. L'œuvre et la pensée de Barjavel présentent, nous l'avons souvent dit, de multiples facettes, comme un diamant...
Les rayons multiplement colorés qu'elles diffractent avec richesse constituent autant de pistes de réflexions, voire même de discussions, mais aussi
d'émerveillement car tous sont faits de la même lumière. Celle du ciel de Tarendol, celle que l'on redécouvre à chaque lecture, souvent comme lui revivifiante.
L'amour tient une grande place dans vos ouvrages. Pouvez-vous encore en dire quelque chose ici ?
Les documents, sources et références cités ou non ici et qui sont venus étoffer ces réflexions sont le fruit de recherches personnelles, et, pour certains, je dois à
l'amabilité et l'obligeance de plusieurs personnes de m'en avoir signalé l'existence ou de me les avoir communiqués :
et surtout, pour son extrême gentillesse et sa confiance
Car les scènes d'amour, explicitement "sensuelles", sont présentes trouvent aussi dans Le Grand Secret, Les Chemins de Katmandou, 

La jeunesse

La Faim du tigre s'en fait en partie l'écho, et Barjavel y a "sublimé" ses angoisses en questionnements vers une réponse qu'il estime inaccessible.
Trouve-t-il qu'il va lui-même devenir "trop vieux" pour les sentiments, comme il l'appliquait à Colette en 1934 ?
Ses doutes et peut-être ses errances trouveront une forme de réponse en 1969 avec le succès de La Nuit de temps qui est, nous l'avons dit, le "rebondissement" de sa
carrière et, d'une certaine façon, de sa vie. Et il l'assimilera dans l'écriture du Grand Secret où, plus que le problème de l'immortalité, c'est la
situation amoureuse complexe des deux principaux héros qui constitue la clé. Roland, resté jeune, et Jeanne, vieillie de dix-sept ans... l'âge de Jean
Tarendol lorsqu'il rencontre Marie. Un homme peut-il aimer une femme de dix-sept ans (même, et surtout, "apparents") son aînée ? Et l'inverse ? Et la
réciproque ?...

Sur la base de certains de ses écrits, soit romanesques - la position et le rôle des femmes dans son œuvre pouvant, en première lecture,
ne pas être du goût de certaines, soit journalistiques, et il se l'est vu reprocher parfois vertement. Ainsi certains propos au Journal du dimanche,
en particulier le 18 septembre 1977, « Quand vous ferez tout à notre place Mesdames », qu'il conclut



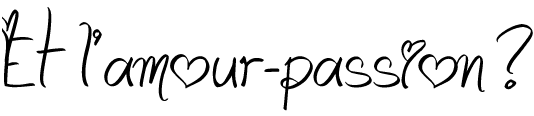
 Les
amoureux de Barjavel - des romans de Barjavel - éprouvent-ils de la passion ? Il semble que non, à de rares exceptions près.
Si l'amour d'Éléa et Païkan peut être vu comme un modèle d'intensité et de "totalité", il n'est pas vraiment pathologique comme on le comprend de
l'amour-passion "romantique". Tout au plus amène-t-il l'héroïne à des actes extrêmes et paradoxaux, tels que "s'offrir" à un garde pour obtenir la liberté
et aller retrouver Païkan. C'est un amour maximum, d'origine "platonicienne" même, réalisant la jonction de deux moitiés séparées d'un même être,
de par sa naissance éminement rationnelle du fait du mécanisme de la Désignation. Et la plupart des autres "rencontres amoureuses" de ses héros ne sont
finalement pas très compliquées, et même plutôt simples, voire simplistes - sans doute idéalisée. Dans Tarendol, lorsque Jean voit Marie le soir du
maraudage des fraises, il n'a pas besoin de long "pourparlers", de lui "sortir le grand jeu", ni de voiture de course ou de dragon à combattre. Pas de séduction
comme dans Les Liaisons dangereuses ou - horreur selon l'auteur - La Princesse de Clèves. C'est d'autant plus marquant dans le
téléfilm où elle paraît quelque peu "ingénue", du moins vue rétrospectivement plus de trente ans après.
Les choses se font, naturellement, les sentiments suivant le cours de la vie...
Les
amoureux de Barjavel - des romans de Barjavel - éprouvent-ils de la passion ? Il semble que non, à de rares exceptions près.
Si l'amour d'Éléa et Païkan peut être vu comme un modèle d'intensité et de "totalité", il n'est pas vraiment pathologique comme on le comprend de
l'amour-passion "romantique". Tout au plus amène-t-il l'héroïne à des actes extrêmes et paradoxaux, tels que "s'offrir" à un garde pour obtenir la liberté
et aller retrouver Païkan. C'est un amour maximum, d'origine "platonicienne" même, réalisant la jonction de deux moitiés séparées d'un même être,
de par sa naissance éminement rationnelle du fait du mécanisme de la Désignation. Et la plupart des autres "rencontres amoureuses" de ses héros ne sont
finalement pas très compliquées, et même plutôt simples, voire simplistes - sans doute idéalisée. Dans Tarendol, lorsque Jean voit Marie le soir du
maraudage des fraises, il n'a pas besoin de long "pourparlers", de lui "sortir le grand jeu", ni de voiture de course ou de dragon à combattre. Pas de séduction
comme dans Les Liaisons dangereuses ou - horreur selon l'auteur - La Princesse de Clèves. C'est d'autant plus marquant dans le
téléfilm où elle paraît quelque peu "ingénue", du moins vue rétrospectivement plus de trente ans après.
Les choses se font, naturellement, les sentiments suivant le cours de la vie...
Pourtant chez Barjavel les amants passionnés existent, mais ils finissent "encore plus mal"... Je citerai :
Deux exemples me viennent :

Mais là encore, le paradoxe n'est qu'apparent, et doit en fait être qualifié de dualité ou complémentarité.
Et Barjavel n'a jamais visé à être un moraliste ! Écoutons-le justement, dans L'homme en question
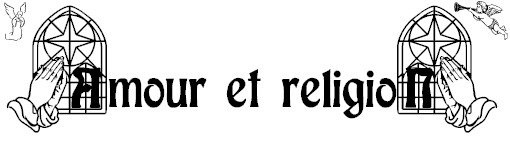
La "contestation" de l'immiscion de l'ecclésiastique dans la vie amoureuse atteindra un niveau public en 1981, lorsque Barjavel va jusqu'à s'adresser
directement au pape Jean-Paul II à propos de l'une de ses récentes déclaration, dans son article au Journal du Dimanche « « Non ce n'est pas un
péché de désirer sa propre femme ». Il lui a valu un riche échange de courriers avec ses lecteurs, auxquels
il répondit trois semaines plus tard pour conclure en quatre points, dont le dernier :
Les considérations de Barjavel n'étaient pas si polémiques que cela, des passages de son texte (j'allais dire "du Révérend Père Barjavel") étant repris
dans ses homélies par Mgr Hippolyte Simon, archevêque de Clermont-Ferrand, qui m'en a directement fait part il y a quelques années...
(citation à extraire) :
Et Freud, quand même ?...
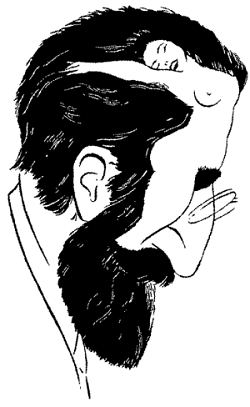
C'est dans La Charrette bleue qu'il se révèle, même s'il dira que ce livre est un recueil de souvenirs passés au filtre du presque roman, et de
"mensonges roses"...
La regrettée Madame Chamoux m'avait raconté une anecdote savoureuse et acide... Lors d'une
venue à Nyons pour dédicacer son livre, Barjavel s'était fait reprocher par une Nyonsaise « de ne pas avoir parlé de sa famille, qu'il avait dû connaître
enfant ». Et notre auteur de lui rétorquer : « Madame, c'est que dans La Charrette bleue je n'ai gardé que les bons souvenirs... »

Pour aller plus loin...

En guise de conclusion
Je ne m'en lasse pas...
Remerciements
Merci à toutes et à tous, sans oublier...




Notes
Les index correspondent aux notes de renvoi dans le texte.




 Le monde avait changé... Barjavel aussi, pendant et après cette période troublée, marquée par des événements historiques au niveau national, mondial,
mais aussi personnel : ses rencontres avec les Groupes Gurdjieff, l'assassinat de Robert Denoël. De quoi faire perdre l'intérêt, même littéraire,
pour les "petites histoires d'amour", chères à Colette... Plus tard, Barjavel dira en privé avoir peu de considération pour son tout premier livre.
Et, remplaçant la femme de lettres (par ailleurs devenue bien vieille) sur le piedestal du "meilleur écrivain", il placera, en 1951, Marcel
Aymé.
Le monde avait changé... Barjavel aussi, pendant et après cette période troublée, marquée par des événements historiques au niveau national, mondial,
mais aussi personnel : ses rencontres avec les Groupes Gurdjieff, l'assassinat de Robert Denoël. De quoi faire perdre l'intérêt, même littéraire,
pour les "petites histoires d'amour", chères à Colette... Plus tard, Barjavel dira en privé avoir peu de considération pour son tout premier livre.
Et, remplaçant la femme de lettres (par ailleurs devenue bien vieille) sur le piedestal du "meilleur écrivain", il placera, en 1951, Marcel
Aymé.