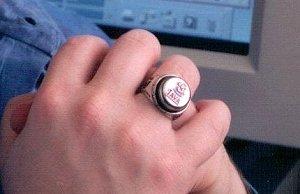Cette présentation est celle de la conférence organisée le 2 décembre 2005 à la Bibliothèque de la Ville de Paris “Port-Royal”, à l'occasion et en commémoration du vingtième anniversaire de la disparition de René Barjavel (24 novembre 1985), en présence de Madame Renée Barjavel, fille de l'auteur, qui s'était associée à cette commémoration, et de plusieurs de ses amis.

Tout d'abord, merci aux Bibliothèques de la Ville de Paris
et à  de nous accueillir ce soir, et tout particulièrement à M. Weuilly, de Port-Royal, qui a accepté ma proposition de "conférence" - c'est peut-être un bien grand mot -
et qui en a organisé la logistique, essentielle pour ce genre de manifestation.
Merci aussi, bien sûr, à vous tous qui êtes présent, certains venus d'assez loin, attiré par l'intérêt envers René
Barjavel et aussi, sans doute, la curiosité concernant l'Associaiton de ses Amis...
de nous accueillir ce soir, et tout particulièrement à M. Weuilly, de Port-Royal, qui a accepté ma proposition de "conférence" - c'est peut-être un bien grand mot -
et qui en a organisé la logistique, essentielle pour ce genre de manifestation.
Merci aussi, bien sûr, à vous tous qui êtes présent, certains venus d'assez loin, attiré par l'intérêt envers René
Barjavel et aussi, sans doute, la curiosité concernant l'Associaiton de ses Amis...
Nous sommes début décembre 2005, et il y a huit jours, le 24 novembre, nous commémorions, le plus souvent de manière
très privée, le vingtième anniversaire de la disparition de René Barjavel. Commémoration discrète, ce qui peut se comprendre
car l'attachement que lui portent un grand nombre de ses lecteurs, de tous les âges, reste généralement privé et
s'extériorise rarement par des manifestations éclatantes.
C'est que l'œuvre de Barjavel, tant celle écrite - la plus connue - que les autres, est celle du "voyage
intérieur", comme le qualifiait un journaliste de la télévision le 24 novembre 1985 lors de l'annonce de son décès.
{ voir l'extrait d'archive vidéo }
On a pu s'apercevoir que, cette année est mis à l'honneur un autre écrivain qui présente de nombreuses affinités avec Barjavel, depuis le mois
de janvier, par une effervescence de manifestations, commémorations, expositions... Je veux parler de Jules Verne auquel
les Bibliothèques de Paris, et de nombreuses autres, consacrent expositions, conférences, ateliers.
Il a paru vraiment utile d'honorer aussi le souvenir de René Barjavel, et quoi de mieux pour cela que de parler de
son œuvre, comme lui-même avait, en 1966, contribué - déjà - à la remise à l'honneur de Jules Verne,
en particulier par un article en forme d'auto-interview aux Nouvelles Littéraires (mars 1966), “Sans
lui notre siècle serait stupide”.
Ce n'est pas un hasard si c'est la Bibliothèque de Port-Royal qui nous accueille aujoud'hui : elle a, parmi les
quelques 50 bibliothèques de la Ville de Paris, la particularité d'être "dédiée" à la science-fiction, au sens
large, tant par son fond spécialisé qui nous entoure, par les revues et magazine auxquels elle est abonnée et qu'elle
permet de découvrir, que par l'intérêt bien sûr corrélatif que manifestent ses responsables pour ce domaine. Ceux et
celles qui viennent ici pour la première fois pourront donc revenir découvrir ces richesses, mais pour ce qui est des
livres de Barjavel, rien ne vaut un exemplaire bien à soi que l'on peut lire, et relire... Je recommande d'ailleurs aux
passionnés de La Nuit des temps, dont nous allons bientôt parler, la nouvelle édition parue il y a quelques
semaines aux Presses de la Cité.
Géographiquement, il se trouve que nous sommes Boulevard de Port Royal, à quelque mètres de l'Hôpital
Cochin, là même où s'éteignit René Barjavel dans la nuit du 23 au 24 novembre 1985, après avoir lui-même "conférencé"
auprès des élèves du Collège Stanislas auxquels il avait consacré sa journée.
René Barjavel, écrivain de S.-F. ?
Alors, René Barjavel, écrivain de science-fiction...? Qu'est-ce que cela veut dire ? et est-ce bien vrai ?
C'est un qualificatif considérablement "raccourci" et raccourcissant. Car s'il est vrai que quelles que soient la,
ou les définitions que l'on donne de la science-fiction - genre littéraire, état d'esprit, courant artistique et
j'en passe, que je laisse aux théoriciens et universitaires qui sont d'ailleurs souvent à la fois juges et
parties dans ce débat - on peut bien considérer que l'œuvre de Barjavel rentre dans cette "catégorie". Oui, mais...
on peut avoir un doute... D'ailleurs, que nous dit-il lui-même ?
D'abord, je déteste le terme de Science-Fiction et je ne pense pas être un auteur de S.-F.
Cette prise de recul peut paraître, à son propre égard, assez provocatrice, et il faut la pondérer par d'autres de ses avis ou opinions, par lesquels il revendique bien son "affiliation" au "genre science-fiction" - faute de mieux.
Écoutons ce qu'il disait de la science-fiction dans sa Radioscopie chez Jacques Chancel (sur France-Inter) le 11 mars 1980 :
|
- Elle a toujours existé, mais elle est en train, depuis la guerre, non, même plus tôt, ça a commencé en Amérique dans les années 35, 40, elle est devenue, je ne dirais pas un nouveau genre littéraire, mais une nouvelle littérature. Je crois... je n'appelle pas la science-fiction un genre littéraire parce qu'elle comprend tous les genres. Elle a commencé par l'épopée, comme toutes les littératures : les grands chefs-d'œuvre américains, ceux de la science-fiction, sont des épopées, formidables, et ensuite, après l'épopée vient le temps du lyrisme, puis le temps du roman, alors il y a la science-fiction lyrique, la science-fiction satirique, la science-fiction politique, la science-fiction euh... et cœtera, tous les genres sont représentés dans la science-fiction. Et également le bon et le mauvais, comme dans toutes les littératures. |
Dans une "auto-interview", pour Les Nouvelles Littéraires également, il déclarait déjà, le 11 octobre 1962 :
C'est à cause de ce tempérament dynamique, de cette large respiration de tout mon être, que je m'exprime en science-fiction. La science-fiction n'est pas un « genre inférieur », comme vous le prétendez avec votre petit sourire, ce n'est même pas un « genre » littéraire, c'est tous les genres, c'est le lyrisme, la satire, l'analyse, la morale, la métaphysique, l'épopée. Ce sont toutes les activités de l'esprit humain en action dans les horizons sans limites. C'est - évidemment - c'est le meilleur et c'est le pire. Il y a de très mauvais écrivains de science-fiction. Il y en a aussi et de bien plus nombreux, et de bien plus mauvais, dans le roman non science-fiction. Personne, pourtant n'aurait l'idée de prétendre que l'oeuvre de Balzac appartient à un genre inférieur parce qu'Eugène Sue écrivait en même temps que lui, sur les mêmes sujets et avec les mêmes personnages.
La SF n'est pas un genre littéraire. C'est une nouvelle littérature, qui comprend tous les genres : satirique, lyrique, psychologique, poétique, et surtout épique. Asimov et Van Vogt en particulier ont ressuscité l'épopée, morte depuis le Cycle d'Arthur. C'est toujours par l'épopée qu'une littérature commence.
et d'ailleurs, pour lui :
Le roman classique psychologique m'ennuie aussi bien à la lecture qu'à l'écriture. Quant au nouveau roman, mieux vaut n'en pas parler... Je crois sans aucun doute que la SF, c'est la forme littéraire de l'avenir.
|
Une caractéristique incontournable de la science-fiction est qu'elle se considère elle-même comme telle,
je veux dire que ses auteurs sont conscients que leur œuvre relève de ce "genre".
La grande erreur des auteurs de SF, c'est de décrire des êtres non-humains parce qu'ils ne peuvent pas les décrire. A moins d'être dans un état second créé par la drogue et d'avoir des visions, et encore, même ces visions là, on les fabrique avec ce que l'on a. En cela, sa propre position dans le genre est claire, puisque son œuvre, à une exception près - et encore très discrète
et qui passe souvent inaperçue - ne fait nulle part mention d'extra-terrestres et encore moins de monstres.
L'imagination est une forme de la mémoire, qui est sa limite ; donc on ne peut pas inventer quelque chose qui ne soit pas dans le cerveau ; ça n'existe pas. C'est incroyable de voir les tentatives des auteurs de SF, et des plus grands, pour essayer d'imaginer des extra-terrestres. Et donc pour lui, plus que le choix d'un genre qu'il réfute, c'est celui d'un moyen poétique et de fabulation
littéraire, comme il l'indiquait explicitement dans une interview rapportée par Jean-Louis Ezine dans Les Nouvelles
Littéraires du 3 juin 1974 “Au commencement était l'épopée”.
De quelles œuvres parlons-nous ?Mais de quels écrits de Barjavel y a-t-il lieu de parler ? DE TOUS ! Dès ses premiers articles - car il a été, bien plus qu'un romancier, et bien avant de l'être, un journaliste - en 1930, au Progrès de l'Allier, on lui trouve ce goût pour l'extrapolation historique le 13 janvier 1931, il utilise le procédé du voyage dans le futur pour présenter assez satiriquement la bonne ville de Moulins vue rétrospectivement par un historien de l'an 2169), tout autant que la poésie parfois très pure - toujours en prose. Si l'on peut voir que sa bibliographie, présentée in extenso sur les documents que l'on peut se procurer dans la salle, concerne principalement le genre romanesque, ses essais qui sont une forme "développée" du journalisme, font aussi une large place à la poésie et à la pré-vision. Prévision qui, il faut insister sur ce point, relève de la logique plus que de l'imagination, dont j'ai mentionné plus haut les limitations qu'il lui trouvait. Et l'on rapprochera à ce sujet son "mode de fonctionnement" de celui de quelques-uns de ses "confrères", tel H.G. Wells qui écrivait en 1911 dans sa préface à la seconde édition de son roman Quand le dormeur s'éveillera : Il s'agit d'une « fantaisie du possible » ; le récit choisit une grande tendance créatrice, ou un groupe de tendances, et développe ses conséquences pour l'avenir. « Supposons que ces forces continuent à s'exercer », voilà l'hypothèse de base. Barjavel, lui, déclarait : Je m'excuse, je n'ai aucune imagination. J'ai seulement les yeux ouverts et un esprit simple, et assez logique. Ravage, Le Voyageur imprudent et Le Diable l'emporte ne sont que des catalogues d'éventualités. Je n'imagine pas. Je considère ce qui est possible. et encore, avec toujours cette ambiguïté à l'égard de la "catégorisation" : Je ne me pense pas du tout auteur de science-fiction, si, avec ce mot on sous-entend étrange. Mon genre est plutôt celui du fantastique logique. Je pars toujours d'une hypothèse d'où je tire toutes les conséquences logiques qui en découlent. Elles sont toujours vraisemblables. Le Voyageur Imprudent en est l'exemple-type : un homme trouve le moyen - scientifique et non pas magique - de voyager dans le temps. Même à la fin, lorsqu'il découvre qu'au bout de tous ses voyages il existe et, qu'en même temps, il n'existe pas, la conclusion reste logique. Il préfère donc se situer dans une optique plus littéraire, se définissant lui-même comme fabuliste, voire même conteur - renouant avec l'étymologie qu'il avait trouvée pour son patronyme, mais à laquelle il est possible d'apporter une érudite réfutation, l'une n'excluant peut-être pas l'autre d'ailleurs. Le rêve, l'évasion, viennent donc après cette logique prospective. Et peut-être pas immédiatement après, mais en troisième position. Car avant cela, Barjavel se définit comme fabuliste, et se revendique une ascendance chez La Fontaine (auquel il rendra hommage dans Une Rose au Paradis, faisant de ses Fables le seul livre emmené dans l'Arche par Mr Gé., comme le Robinson Crusoë dans L'Émile de Jean-Jacques Rousseau), ou même de Turold, qui fut la source d'inspiration de son premier récit publié, Roland, le chevalier plus fier que le lion, ou de Rabelais - dont il a la nostalgie de la truculence et de la langue sonore, sonorité dont il reproche avec humour la disparition à Parmentier qui a introduit la pomme de terre dans le régime alimentaire des Français en remplacement des haricots... (là, on le sent presque admirateur de René Fallet et de sa science-fictionnesque Soupe aux choux...). Je raconte une histoire pour en tirer une moralité, comme La Fontaine, et non une morale. La Fontaine est l'un des auteurs que je préfère. J'aime par-dessus tout La cigale et la fourmi et Le coche et la mouche. Ces deux fables sont pour moi l'exemple de ce qui est écrit définitivement sans que l'on puisse y changer un mot. (voir : [ http://www.lafontaine.net/fables/1cigfour.htm ]
en distinguant bien : Je me verrais plus proche de la tradition française des fabulistes et des conteurs philosophiques : il est certain que je raconte une histoire et que j'en tire une moralité. Pas une morale, n'est-ce pas, je ne suis pas un moraliste. Une moralité, c'est un conseil pratique. Si tu es un corbeau et que tu tiens un fromage, n'ouvre pas le bec... Ses livres et articles sont pleins de ces conseils pratiques; de bons sens, et son œuvre est en cela fondamentalement différente de celle de la plupart des auteurs de space-opera américains, ou des
explorateurs de mondes et de pouvoirs extraordinaires. Il faut lui reconnaître une « humilité technique », ne
serait-ce que par rapport à Jules Verne, se traduisant par une certaine modestie, ou du moins l'absence totale
de prétention dans les assertions à caractère - ou prétentions - scientifiques : là où Jules Verne et ses
héros croient et se font les champions de la science positiviste parfois même dans ses extrapolations aventureuses, Barjavel
- mais il n'est pas le seul - reste suffisament "vague" pour ne pas imposer des pseudos-théories ou explications,
voire des dénominations de procédés tellement fumeuses qu'ils en sont invraisemblables, et dont d'autres auront tendance à abuser
(je pense à hyperespace, moteur transluminique, etc.)
Par rapport à ses contemporains, on peut le voir comme un "cousin" de son confrère américain qui était aussi un de ses amis, Ray Bradbury (on constatera aussi l'identité de leurs initiales...) qui déclarait lui aussi (dans une interview à l'Express en 1980 à l'occasion de l'adaptation au théatre de ses "Chroniques martiennes" à Paris : - Vous vous considérez donc aussi comme un fabuliste ?
Ces deux démarches, « prospective logique » et « fable à moralité », sont chez Barjavel à la fois indépendantes et étroitement imbriquées. Indépendantes a priori, mais les conclusions de l'une vont donner au lecteur, sans qu'il soit nécessaire à l'auteur de l'asséner énergiquement, les éléments de réflexion pour se faire un point de vue selon l'optique de l'autre. Et c'est peut-être là l'écueil et la source du malentendu que risque de faire naître une lecture hâtive, ou se limitant au premier degré, de certains romans : croire que les positions exprimées (ou vécues) par les héros sont au sens strict celles de l'auteur. Barjavel en avait conscience, sans toutefois juger indispensable de proclamer de trop fréquentes mises en garde, mais n'omettant pas non plus de clarifier ce point lors d'interviews, au public plus ou moins restreint (ceci est tout particulièrement important pour Ravage et Le Voyageur imprudent, d'autant plus que l'époque de leur parution a pu laisser reprocher à l'auteur quelques influences malencontreuses). Pour "enfoncer le clou" et bien montrer que Barjavel est bien un écrivain de science-fiction, je rappellerai, avec un sourire aigre-doux, qu'une raison de ne pas l'aimer de ceux, ou celles, qu'ils ne l'ont pas lu est que, justement... « Barjavel ? non, je n'aime pas la Science, technique et science-fictionDans "science-fiction", il y a "science", et les œuvres qui relèvent de ce genre ont nécessairement une
certaine approche, ou mise en action, de données scientifiques, ou plutôt techniques. Sinon, on a
affaire à un "genre" cousin, la Fantasy, le Merveilleux, etc.
Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie On serait donc presque tenté de faire entrer dans ce genre les gadgets des films de James Bond qui relèvent certes, à l'époque du tournage, d'une prospective technico-magique, mais, à peine dix ans, voire cinq, plus tard, d'une ringardise savoureuse... Alors que l'anachronique robinet de gaz que l'Enchanteur installe - par magie ? - chez Bénigne constitue un véritable pont entre le genre merveilleux et la science-fiction, avec la touche d'humour à laquelle notre auteur reste fidèle. L'interrogation de la science-fiction (je laisserai le terme techno-fiction à la disposition d'exégètes plus subtils) sur l'adéquation de la Voie de la Technique aux destinées de l'Homme date en fait de la naissance du genre. Dès ses premières œuvres, Wells la place en toile de fond de l'enchaînements des événements qui prennent naissance sous sa plume, et les suivantes, moins connues du grand public, sont celles d'un moraliste humaniste dont les préoccupations semblent avoir été voisines de celles de Barjavel (en nettement moins "enjouées" il faut le dire...). Chez Barjavel, les éléments anticipatifs se différencient de l'anticipation-type que l'on trouve chez d'autres auteurs de
science-fiction par le fait qu'ils sont intégrés au cadre de vie dans lequel ils se trouvent mis en scène
- modestement, c'est à dire qu'ils ne constituent pas une fin en soi - et réalistement :
ils y ont leur utilité, ils servent à quelque chose.
Et puisque nous en sommes à évoquer "ceux qui ne l'aiment pas" - il y en a peut-être parmi nous ce soir - à cause de reproches "anti-progressistes" voire "rétrogrades" qui ont pu être exprimés, je ne peux que les inviter à lire, ou relire, son dernier livre Demain le Paradis, dans lequel son optimisme, certes raisonné, envers la science et la technique va bien loin devant les positions actuelles... Moins publiquement, certaines interviews ou conférences dans les dernières années de sa vie, invitent chaleureusement les jeunes générations à mettre beaucoup de leurs espoirs, et de leurs forces, dans l'avancée des sciences et techniques. Science-fiction et prédiction chez René BarjavelPeut-on alors invoquer cette tendance à la prédiction comme une composante caractéristique et habituelle de la science-fiction ?
Je commencerai par Ravage, le premier de ses romans extraordinaires, qui nous offre dès les premières pages de belles descriptions visionnaires, et dont l'action se situe, rappelons-le, en 2052. Dès 1942, Barjavel y met en scène des "objets", des technologies accompagnés de problèmes et parfois de leurs solutions, difficilement concevables dans le contexte de l'époque. Il en est résulté que les lecteurs des générations suivantes ont souvent eu l'impression que le livre venait d'être écrit, et Barjavel a souvent recueilli ce témoignage des étudiants auxquels il aimait rendre visite. Il déclarait en 1977
Au tout début du roman, le voyage en train de François Deschamp, qui monte de Marseille à Paris en une heure, décrit un moyen de transport ferroviaire à très grande vitesse
que la mise en service ces dernières années du TGV Méditerranée m'a ramené avec force à la mémoire.
la ligne Nantes-Vladivostock, (dont) les plans de remplacement avaient prévu la construction, partout où ce serait possible,
de la voie aérienne sur l'emplacement même de l'ancien chemin de fer, afin d'utiliser ses ouvrages d'art.

Certes, l'aspect des rames et surtout leur moyen de motorisation ne sont pas encore tout à fait ceux de cette automotrice à suspension aérienne (...) rappelant par sa forme élancée les anciens vaisseaux sous-marins. dont le départ semble plutôt aérien : Une sirène ulula doucement, les hélices avant et arrière démarrèrent ensemble, l'automotrice décolla du quai,
accéléra, fut en trois secondes hors de la gare.

Barjavel a en fait anticipé les prototypes de monorail-aérotrain qui fut construit par Jean Bertin dans l'Essonne puis près d'Orléans à la fin des années 60 , ou, pour ce qui est de la propulsion, du Turbotrain en service sur la ligne Paris-Normandie dans les années 70. Certains traits bien caractéristiques des transports de notre époque y sont déjà, alors qu'ils étaient difficilement concevables lorsque le roman fut écrit, ne serait-ce que cette "sirène" annonçant le départ des trains, qui a commencé à sévir en France dans les transports parisiens à la fin des années 1970. Ce n'est pas seulement l'aspect ou l'utilisation du moyen de transport eux-mêmes que j'y vois annoncés, mais aussi sa "logistique" : ces lignes à grande vitesse, en passe de relier les principales capitales de l'Europe (nous n'en sommes certes pas encore à Nantes-Vladivostock, quoique...), ont eu aussi l'effet de reléguer à l'abandon les voies anciennes, car si l'on criait qu'on avait envie de remonter "dans le train" comme grand-père, on n'aurait tout de même pas accepté de s'asseoir dans une brouette poussive qui se traînait sur le ventre à trois cents kilomètres à l'heure. En revanche, là où l'auteur est quelque peu "tombé à côté", emporté par un élan de créativité féconde idéalisant certaines réalités, c'est dans les modalités de construction de la voie en trois jours et trois nuits : tâche planifiée, préparée, approvisionnée et répétée des mois à l'avance, dont le succès est le couronnement d'une organisation rigoureuse, pas tant autoritaire que sachant s'appuyer sur un enthousiasme et une participation populaire sans réserve, peut-être dans le goût de certaines aspirations de l'époque... mais assez peu plausibles au vu de la réalité sociale, et peut-être quand même sous-dimensionné par rapport aux nécessités techniques d'un tel projet Les moyens de communications, dans Ravage, ne sont pas en reste : radio et télétransmisison d'images flottantes en relief, (comme cette technique de téléprésence qui se retrouvera dans d'autres écrits, en particulier la petite nouvelle Le Travail du chapeau que j'ai redécouverte récemment), ont d'une certaine façon fait une apparition sans grand succès au début des années 90 par le concept de visiophonie (expérience de Biarritz). Les réticences des utilisateurs étaient d'ailleurs bien celles que Barjavel met en avant lorsque Blanche est surprise en tenue légère par un appel impromptu de Jérôme Seita... Comme elle s'enveloppait dans son peignoir, le téléphone bourdonna.
Il passait un doigt sur sa moustache, se caressait le bout du nez du pouce et de l'index.")
- Allô, Mademoiselle Rouget ?
Je me permets de vous déranger d'aussi bonne heure pour vous demander de remettre vraiment votre sortie avec votre ami, comment dites-vous. Deschamps? à un autre jour. Je viens d'être appelé à Melbourne. Je dois partir demain et serai absent deux jours. Je veux vous emmener ce soir dîner quelque part au frais. Vous verrez votre ami demain...
- Mais, je lui ai promis... - Une femme, voyons, n'est pas obligée de tenir une promesse...") Il sourit, se leva, s'avança de trois pas hors de la glace.
Elle n'y parvenait pas, elle continuait de le piétiner. Elle courut vers son lit, se glissa sous le drap, haletante.
- Je vous en prie, Monsieur Seita, retirez-vous! Il s'arrêta, surpris, tourna vers la gauche sa tête grosse comme une noix.
Un autre point où l'on surprend Barjavel à se tromper, comme un nombre important d'auteurs de science-fiction, sinon la quasi totalité, est dans l'"annonce" de transports aériens individuels... L'avion (ou hélicoptère, ou aéronef sphérique ou autre) personnel, que plusieurs romans mettent en œuvre pour le plus grand confort apparent des utilisateurs, se fait toujours attendre... on peut d'ailleurs ne pas le regretter en imaginant la pagaille aérienne qui pourrait en résulter. et dont, par exemple, le cinéaste Luc Besson a donné une étourdissante illustration dans Le 5ème Élément... Sortant du cadre de la technique, on trouve aussi dans Ravage cette curieuse prédiction géographique par laquelle l'auteur place, près de l'emplacement de l'ancienne gare Montparnasse... une tour, celle de la Ville Radieuse... Et, à propos de gare parisienne, ne place-t-il pas La Gare Centrale [qui], creusée au-dessous du Jardin des Tuileries et du Palais du Louvre, desservait tous les réseaux. François monta par l'ascenseur de l'arc de triomphe du Carrousel. non loin de là où l'échangeur de Châtelet-Les Halles constituera, au début des années 80, un nœud multi-réseau... à proximité de la pyramide du Louvre, Place du Carrousel, reliant le monde du dessous à la surface... Ravage contient aussi des anticipations historiques et sociales qui constituent le fond même du récit. Il n'a pas échappé à l'auteur lui-même
que la disparition totale et inexpliquée de l'électricité, élément initiateur des événements, s'est réalisée, dans une proportion considérablement moindre mais déclenchant
néanmoins un début de déroute psychologique sur la Côte Est de l'Amérique du Nord le 9 novembre 1965.
Socialement parlant, et pour en rester là sur Ravage, le modèle de société mis en place par le Patriarche François,
et sujet à de nombreuses critiques ou polémiques, est intéressant à analyser dans son ontogénèse.
Si le premier niveau de critique, insuffisament documenté ou au regard restreint, a voulu y trouver une inspiration
pétainiste, j'ai pu montrer que des fondements de concept et
d'organisation pouvaient de manière très plausible en être trouvés dans les idées de Lanza del Vasto,
qui avaient abouti à la fondation de ses Communautés de l'Arche, dont les règles de vie et le cadre de référence sont extrêmement
proches de ce que décrit Barjavel, y compris par leur formulation même.
choisir une grande tendance créatrice, ou un groupe de tendances, parmi des catalogues d'éventualités, et considèrant ce qui est possible, développer ses conséquences pour l'avenir. Passons à d'autres œuvres. Curieusement, le roman Tarendol - qui n'est nullement de science-fiction - offre aussi des manières d'anticipations géographiques… Ainsi, certains lieux de la ville fictive de Millon les Tourdres, dans laquelle on sait qu'il faut reconnaître Nyons, la ville natale de Barjavel, sont présentés non pas comme l'auteur a pu les connaître dans son enfance, mais comme ils ont été aménagés ensuite : c'est le cas en particulier des emplacements des collèges de filles et de garçons, qui donne dans le roman le point de départ de l'intrigue amoureuse... Mais je vais rester dans l'anticipation, non romanesque maintenant, avec Cinéma Total, essai sur les formes futures du cinéma qui, dès 1944 (et même plus tôt car il paru d'abord en articles dans L'Écho des Étudiants en 1942), annonçait des réalisations étonnantes : alors que le cinéma, et d'une manière générale la quasi-totalité des techniques d'images, offraient du monde une vision en noir et blanc dont les effets artistiques tenaient surtout dans la maîtrise des nuances de gris, Barjavel imaginait sans peine (p.39) que : La couleur, ivresse nouvelle, envahira d'abord les écrans. L'agonie du film gris sera brève. Il traînera quelque temps un reste de triste vie dans les cinémas de province et les très pauvres salles des banlieues lépreuses. Puis les gamins eux-mêmes ne le supporteront plus. Exercice d'imagination point trop difficile certes, mais dont la cohérence des développements mérite d'être soulignée. De l'écran, la couleur se glissera dans les albums de famille. Le nouveau-né trônera au milieu de la page, tout rose sur sa fourrure blanche. Papa fera photographier sa fille dans sa robe bleu pervenche à l'occasion de ses dix-huit ans. Et la vieille tante d'Angers répondra par quatre pages de remontrances à l'envoi de la photo accompagnée d'affectueuses pensées. Parce qu'elle aura vu que sa nièce se met du rouge aux lèvres. Pour arriver à : La photographie et le cinéma pousseront l'imprimé vers de nouveaux progrès. Le lecteur s'irritera de voir son journal publier en noir un instantané extrait des actualités en couleur. et c'est bien dans cet ordre, et avec cette gradation, que s'est progressivement établie l'arrivée de la couleur dans les images "publiées".
Et les descriptions qu'il y fait ensuite du Cinéma en relief, dans lequel il voit l'avenir du septième art,
forcent le respect par leur pertinence, surtout pour qui est allé dans une salle de ce type, en particulier au
Futuroscope de Poitiers, à la Villette ou dans plusieurs centres d'attractions. Je me suis souvent demandé pourquoi cette prémonition
ne s'est jamais trouvée saluée comme elle le mériterait... il est vrai que Cinéma Total est un ouvrage hélas, et
injustement, un peu oublié sauf des spécialistes.
(...) la caméra, dont la vitesse et l'ouverture seront réglées sur l'éclairage moyen, donnera une image sous-exposée
dans les parties sombres, et surexposée dans les parties trop éclairées. La robe rose de l'héroïne deviendra brique dans les
coins obscurs, et mauve au plein feu des projecteurs.
En cela il introduisait la nécessité d'études théoriques et le développement d'écoles de cinéma de haut niveau, qui firent leur apparition à la fin de la guerre puis se développèrent par la suite. Il anticipait aussi des techniques de traitements et manipulations d'images qui ont désormais supplanté les images naturelles... D'un point de vue formel, Cinéma total est un essai et non un roman (mais l'auteur le qualifiait de« graine de roman »), mais certaines descriptions de vie quotidienne de la société future que l'on peut y trouver relèvent néanmoins du genre romanesque, et parfois même lyrique :
salles de spectacles aux fauteuils pneumatiques (p 48), machines à laver, qui pour la ménagère de 1950, auront constitué "une affreuse corvée" en comparaison de l'utilisation de textiles plus futuristes
et des procédés de recyclage qu'envisage l'auteur et qui seront d'ailleurs récurrents dans bon nombre d'œuvres ultérieures.
Dans le domaine de l'image-spectacle, ce qui est particulièrement étonnant est l'anticipation que fait Barjavel de concepts pour le moins modernes, et difficiles à rattacher à quelque donnée que ce soit de l'époque ... Qu'on en juge : La télévision va faire des progrès rapides. Après la présente guerre, des postes récepteurs perfectionnés
seront fabriqués en grande série. Mais ils ne recevront que des spectacles médiocres.
Il faut plusieurs mois de travail, de mise au point, de choix, et un nombre considérable de millions,
pour fabriquer un film qui dure deux heures. Un studio de télévision, qui émettra ne serait ce que dix
heures par jour de spectacle renouvelé, ne pourra pas se permettre le luxe d'une telle préparation. Les
émetteurs se transformeront en succédanés de théâtres, et nous montreront toutes les vedettes et
tous les répertoires des salles subventionnées. Ils entremêleront ces spectacles poussiéreux de vues de
plein air, d'actualités sportives. Ils utiliseront tout ce qui ne coûte rien. Et, naturellement, chercheront à
projeter des films.
Tout y est !! Omniprésence de la télévision - pourtant pratiquement inconnue à l'époque - évolutions des mentalités et des loisirs, de la qualité des productions, mais aussi des techniques qui, même si Nul technicien d'aujourd'hui n'est capable de faire la moindre supposition à ce sujet, sont bien là maintenant : magnétoscope et même DVD et autres enregistrements numériques, en tout cas moyen d'enregistrement et de conservation des images n'ayant rien de commun avec le film d'aujourd'hui dans lequel la photographie ne joue aucun rôle... Surtout, on y voit aussi la télédiffusion internationale instantanée, maintenant possible grâce aux satellites, alors pas même imaginés, et, vraiment étonnante, la télévision à péage, les décodeurs-compteurs très exactement définis comme le pay-per-view actuel... On serait tenté de dire qu'il n'y manque que la carte à puce comme moyen d'abonnement ou de paiement... mais certains spécialistes
sont bien conscients de ce que cette technique et l'industrie qu'elle fait vivre doivent à notre auteur...
Et c'est à ce roman, le plus connu je pense, et qui vient d'être ré-édité par les Presses de la Cité, que l'on va
maintenant se reporter : sa remarquable construction "filmique" - et pour cause puisque le
roman dérive du scénario d'un film jamais, ou plutôt "pas encore" tourné - y donne la place à la mise en scène, et même en images,
de descriptions d'une vie future, ou incroyablement éloignée dans le passé, dans laquelle des réalisations techniques,
économiques et sociales deviennent progressivement d'actualité à présent, on point que l'on se demande parfois jusqu'où cela
va aller...
Dans La Nuit des temps, les dispositifs de transmission individuels qu'utilise Éléa pour communiquer ses souvenirs à Simon et les faire partager à la communauté internationale résistent à l'investigation des scientifiques qui tentent d'en comprendre la constitution. Non pas qu'ils soient "magiques", mais la technologie utilisée est "trop" avancée : - Faut pas s'y tromper, dit Brivaux, c'est de l'électronique moléculaire. Ce truc-là est aussi compliqué qu'un émetteur et un récepteur TV réunis et aussi simple qu'une aiguille à tricoter ! Tout est dans les molécules ! C'est formidable ! Je fais remarquer au passage que cette préoccupation de "télépathie" reste une idée essentielle de Barjavel écrivain, qui déclarait, dans sa Radioscopie :
Si en 1969 les circuits intégrés faisaient de timides apparitions - avec des dimensions énormes par rapport à leur évolution actuelle -
des concepts plus miniaturisés restaient quelque peu "fumeux" hors des laboratoires universitaires
(le premier à en parler semble être Richard Feynman dans un article de 1959, There's plenty of room at the bottom [voir http://www.its.caltech.edu/~feynman/plenty.html],
discutant des limites de la miniaturisation en prévoyant la possibilité d'arranger la disposition des atomes à notre
guise).(Richard Feynman l'évoquait en 1959.)
Les usines silencieuses et sans déchets fabriquaient tout ce dont les hommes avaient besoin. La clé était la base du système de distribution.
ou des qualités auto-réparatrices des matériaux, telle la conduite d'eau des souterrains de Gondawa qui se "cicatrise" après qu'Éléa et Païkan l'eurent percée pour s'y désaltérer dans leur fuite... il nettoya du tranchant de la main la poussière qui ouatait une sorte de cylindre courant à hauteur d'homme le long du mur, et y enfonça par deux fois une lame. Un double jet d'eau se mit à couler. Éléa, la bouche ouverte, se jeta sous la mince colonne transparente. Elle s'étrangla, toussa, éternua, rit de bonheur. Païkan buvait dans ses deux mains en coupe. Ils avaient à peine étanché leur soif quand le double jet diminua et tarit : la conduite d'eau avait réparé ses fuites. Je lisais il y a deux semaine un article de vulgarisation scientifique qui présente exactement la même chose...
Comment et Pourquoi ?Après ces présentations - forcément limitées par le temps qui nous est imparti ce soir - il convient
de revenir à la question de tenter d'expliquer dans quelle mesure, et, le cas échéant, par quel privilège, la science-fiction
et tout particulièrement l'œuvre de René Barjavel, bénéficient de cette "aptitude" à la prédiction.
Le futur est affecté par la vision que l’on en a. Ne cite-t-on pas curieusement que l'écrivain Cleve Cartmill fit les frais en 1944 de ce talent : il faillit être arrêté, convaincu d'espionnage parce qu'il décrivait minutieusement la bombe atomique dans une nouvelle, "Deadline", parue peu avant les premiers essais nucléaires ! Campbell, rédacteur en chef de la revue Astounding qui publiait Cartmill, réussit à convaincre le FBI de l'innocence de son auteur... Je suis bien conscient d'avoir introduit une échelle de valeur en précisant "les bons auteurs"... et on ne sera pas surpris que je profite de ce critère
pour y placer notre auteur qui, comme Jules Verne, se tenait minutieusement au courant de l'actualité y compris scientifique,
que son activité de journaliste l'a souvent amené à commenter en direct sur les ondes, à la radio et à la télévision.
Je me sens aussi jeune qu'elles (les enfants), plus peut-être à cause de ma curiosité et de ma joie qui sont plus grandes que les leurs. Elles vivent. Moi je sais que je vis. Il m'a fallu beaucoup de temps pour l'apprendre. Et je voudrais savoir tout le reste. A moins d'être Dieu, le temps tout entier n'y suffirait pas. pour certains de ses contemporans et amis, tels Jean Cocteau : Son regard se portait sur le monde futur avec les yeux illuminés d'un Gaulois des cavernes, raccourci un peu saississant (surtout l'idée de Gaulois des cavernes, iconoclastes par rapport aux huttes en bois déjà plus "civilisées"…), mais anonçant curieusement la sensibilité celtique qui marquera Barjavel dans les dernières années de sa vie. Lui-même, en fait, avait bien consicence de l'influence de ses racines familiales sur sa vision du monde. Si dans La Charrette bleue il remercie son père Cher père, je crois que mes romans de science-fiction te doivent quelque chose... Il s'analyse, dans le reportage L'Homme en question :
A-t-il aussi "fait fausse route", non pas dans ses prévisions, mais ses enthousiasmes ? Un exemple assez marquant, et pratiquement inconnu, est celui de son opinion
sur Le Corbusier. Sa vision des monds futurs n'a pu manquer de développer des considérations sur l'architecture (et
d'ailleurs plusieurs étudiants architectes ont choisi ce thème pour leur mémoire de fin d'étude), appuyée nécessairement
sur une sérieuse documentaiton concernant les tendances de l'époque, et leus evolutions; En 1936, Barjavel qui était
chef de fabrication chez Denoël et écrivait des articles pour la revue Micromégas, avait découvert les idées et
prévisions de Le Corbusier qui revenait de son voyage aux États-Unis (là même où il avait déclaré aux journalistes
“Vos gratte-ciel ? Ils sont trop petits !”) et publiait Quand les cathédrales étaient
blanches. Alors, pas de doute, le futur des villes était vers le haut, le très haut même...
Mais, après tout, il y a bien des gens qui prennent Godard pour un génie. Moi, je trouve que c'est un sinistre emmerdeur. C'est ce que la Suisse nous a envoyé de pire avec Le Corbusier. Cet exemple méritait selon moi d'être présenté, il montre bien que les accusations de rigidité d'esprit" envers notre auteur sont plutôt infondées... De telles aptitudes sont-elles innées, acquises "naturellement", ou le résultat d'une "initiation" plus ou moins ésotérique... ? On peut émettre les hyposthèses que l'on veut. Dans le cas de notre auteur, ses origines ancrées dans un terroir réaliste, ajoutées à une enfance et une éducation laissant aussi la place à l'imaginaire et à de nombreuses lectures, ne pouvaient que constituer un terrain favorable. Il ne faut pas oublier non plus que, vers la trentaine, l'auteur a suivi l'Enseignement de Gurdjieff auprès de Madame de Salzmann et de son ami Philippe Lavastine, et que, au delà de toutes considérations "ésotériques" ou "initiatiques", les exercices de concentration peu conventionnels pour l'époque qui y étaient pratiqués avaient bien pour but de développer des capacités de réflexion objective, de logique non polluée par les a priori, qui peuvent aussi aider à comprendre certaines parts de la démarche d'écriture de Barjavel. Lui-même se confiait sur ce sujet dans des interviews privées, rapportées dans quelques éditions en collection "Club" maintenant peu courantes, et dans le livre de Louis Pauwels "Monsieur Gurdjieff". D'autres explications, d'un sérieux plus contestable (mais sait-on jamais…), et applicables tant à certains écrivains de science-fiction qu'à un bon nombre de "visionnaires" plus scientifiques,
ont été proposées... Celles en faisant des voyageurs venus du futur ou des extra-terrestres déguisés ne manquent pas de saveur, et, pris avec détachement,
peuvent nourrir une inspiration littéraire au second degré produisant de petites perles d'écriture.
Non, René Barjavel n'était pas un extra-terrestre ! Son attachement à la vie sur notre planète est toujours resté pour lui une source d'émerveillement. Et dans ce qu'il voyait de l'avenir avec les yeux du cœur, il est une prédiction que nous vérifions chaque année, et qui l'a toujours ébahi :
~ Merci ~Notes et référencesLes index correspondent aux notes de renvoi dans le texte.
Corpus
On pourra bien sûr se livrer avec intérêt à une (re-)lecture de l'ensemble des œuvres de l'auteur en portant une attention particulière aux anticipations et "prophéties" que l'on y rencontrera. Le présent exposé s'est principalement référé aux œuvres suivantes :
|